
Claude TAULEIGNE
Nikon D70 & D70s
VERSION INTERNET OFFERTE
Licence de Librairie Libre
Vous pouvez librement copier, stocker, diffuser ou citer cette
oeuvre, sous quelque forme que ce soit, à condition de res-
pecter :
- son auteur : Vous devez citer l’auteur de l’oeuvre ;
- sa gratuité : Vous ne pouvez utiliser cette oeuvre à des fins
commerciales ;
- sa neutralité : Vous ne pouvez utiliser l’oeuvre à des fins de
propagande (y compris contre son auteur) ;
- son intégrité : Vous ne pouvez modifier l’oeuvre.
Par ailleurs, vous devez impérativement joindre cette licence
sans modification et, en particulier, sans addition de clauses,
à l’oeuvre lors de toute copie ou distribution.
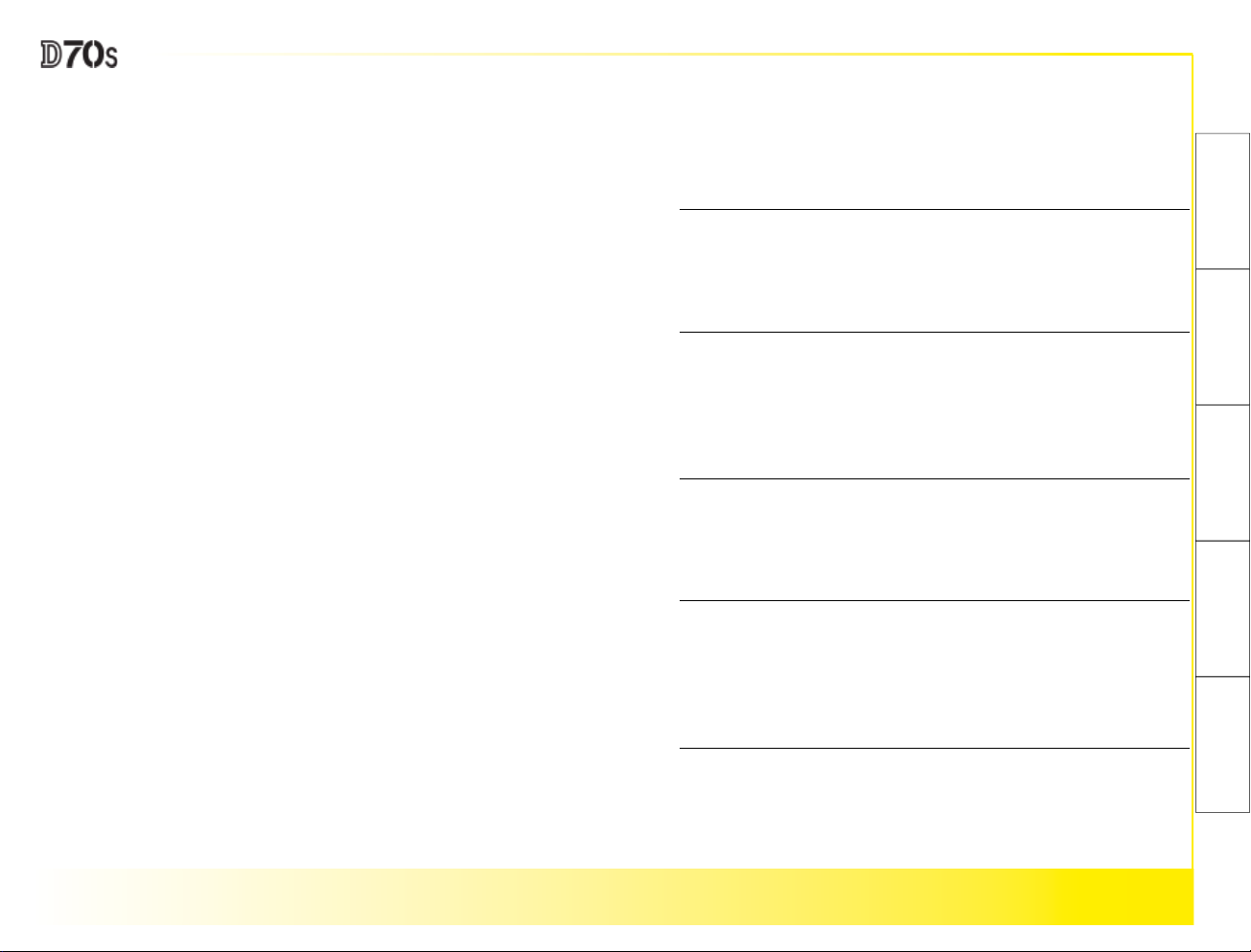
7
236993121
Sommaire
PRÉSENTATION
NUMÉRIQUE
TECHNOLOGIE
ACCESSOIRES
GLOSSAIRE
Remerciements :
Bernard DENEVI et Thomas MAQUAIRE (Nikon
France),
Hariba (modèle),
Jean-Claude TAULEIGNE (relecture astronomique et
conseils astronomiques aussi).
© Droits réservés :
Claude TAULEIGNE (textes, photographies et mise en
page) & Nikon (illustrations produits), tous pays y compris la
Télémétrie occidentale.
Toute reproduction intégrale ou partielle, par quelque procédé
– existant ou à venir –
que ce soit, des pages, textes,
photos, illustrations ou erreurs publiées dans cet ouvrage, faite sans l’autorisation écrite de l’auteur, est illicite et
constitue une contrefaçon selon les termes de la loi du 11
mars 1957.
ISBN : 2-9520198-3-5
Dépot légal : 4e trimestre 2005
❏
❏
❏
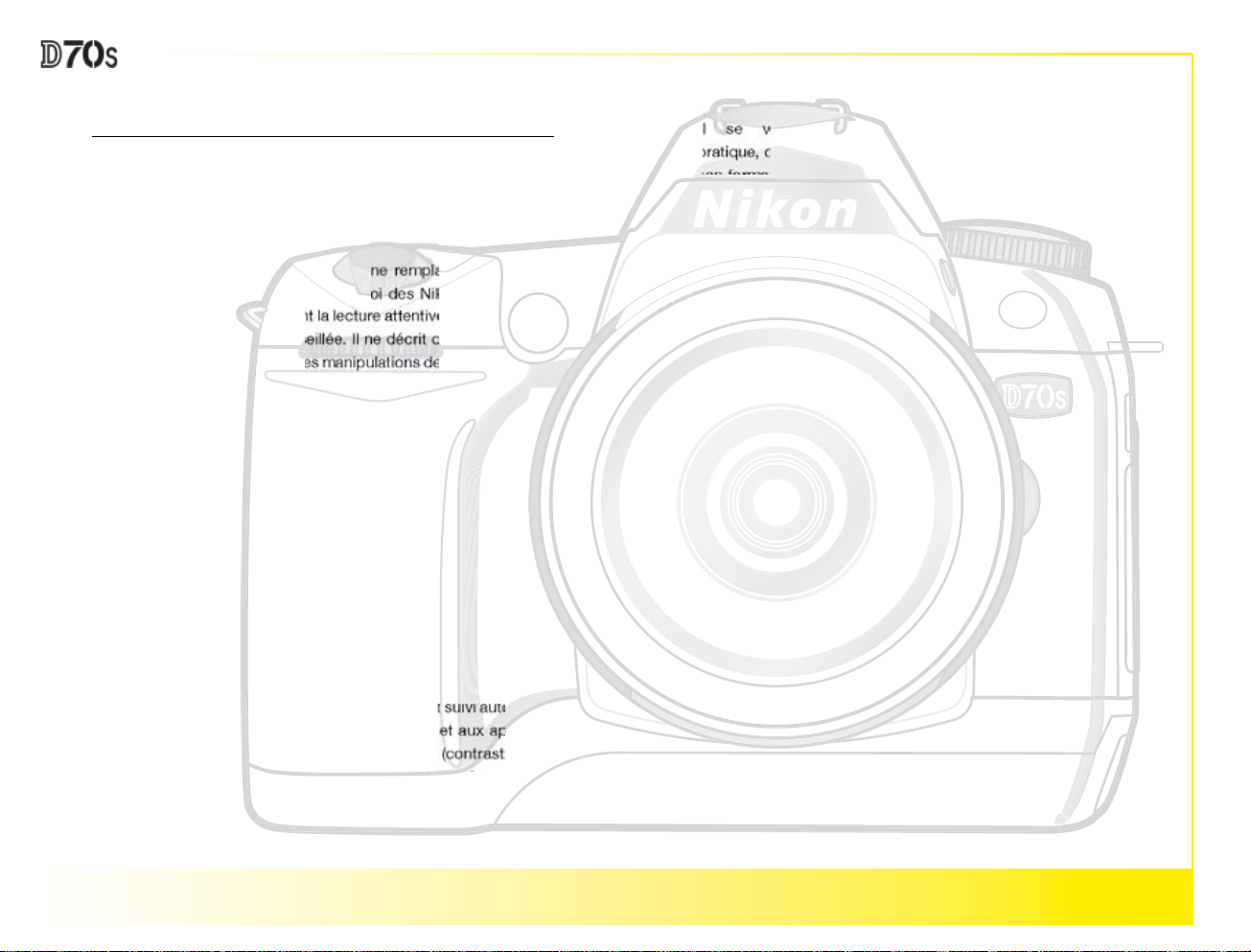
Site internet : http:
//
c.tauleigne.free.fr
Ce livre ne remplace pas les mo-
des d’emploi des Nikon D70 et D70s
dont la lecture attentive reste fortement
conseillée. Il ne décrit donc absolument
pas les manipulations de base de ces ap-
pareils (mise au point, déclenchement...),
ni l’accès à leurs différentes fonctions. Il
ne constitue pas un cours de photographie : les notions techniques essentielles comme l’ouverture de diaphragme,
la vitesse d’obturation ou la sensibilité
sont ici considérées comme acquises.
Enfin, cet ouvrage n’est pas non plus
un catalogue. Seuls les accessoires
utiles, compte-tenu de la spécificité numérique des appareils, seront cités. De
la même façon, au niveau technique, seu-
les les caractéristiques particulières aux
reflex Nikon (mesure couleur 3D de l’ex-
position, mode de zone et suivi autofocus,
gestion i-TTL du flash...) et aux appareils
numériques en général (contraste, net-
teté, saturation, température de couleur...)
seront ici abordées.
Il se veut
pratique, ce qui explique
son format de poche et ses
nombreuses illustrations qui
s’appuient sur des situations de
prise de vue réelles.
Précisons
que les mots bleus
ne renvoient pas à
la discographie
de Christophe
mais bien au
g l o s s a i r e
situé en fin
d’ouvrage.
S i g n al o n s
enfin que cet
ouvrage est
dédié au D70
et au D70s. Les
e x pl i c at i on s
sont données
pour les deux boî-
tiers, qui seront donc
indifféremment nom-
més «Nikon D70s» au fil
des pages. Lorsque le Nikon
D70 est désigné, cela signifie que le
paragraphe est consacré à une de ses spécificités.
AVANT PROPOS
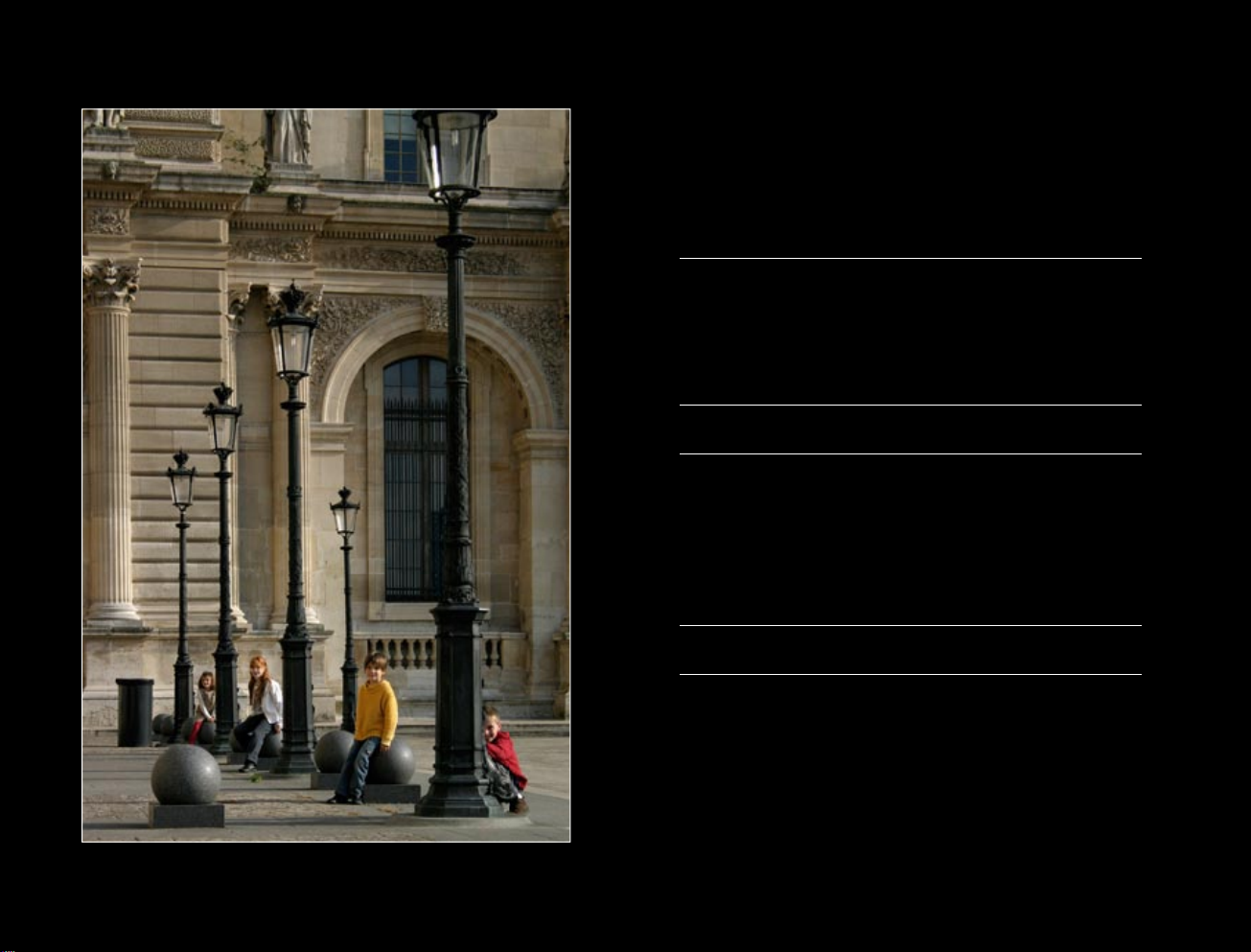
7
HISTORIQUE NIKON
Une lignée de reflex .........................................8
L’aventure numérique.......................................9
Le Nikon D70 ................................................. 11
Le Nikon D70s ............................................... 12
POINTS CLEFS DU NIKON D70S
Qualité d’image .............................................. 13
Rapidité de fonctionnement .......................... 14
Autofocus dynamique à plage large .............. 15
Mesure matricielle couleur 3D ....................... 16
Système i-TTL au flash .................................. 17
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Présentation
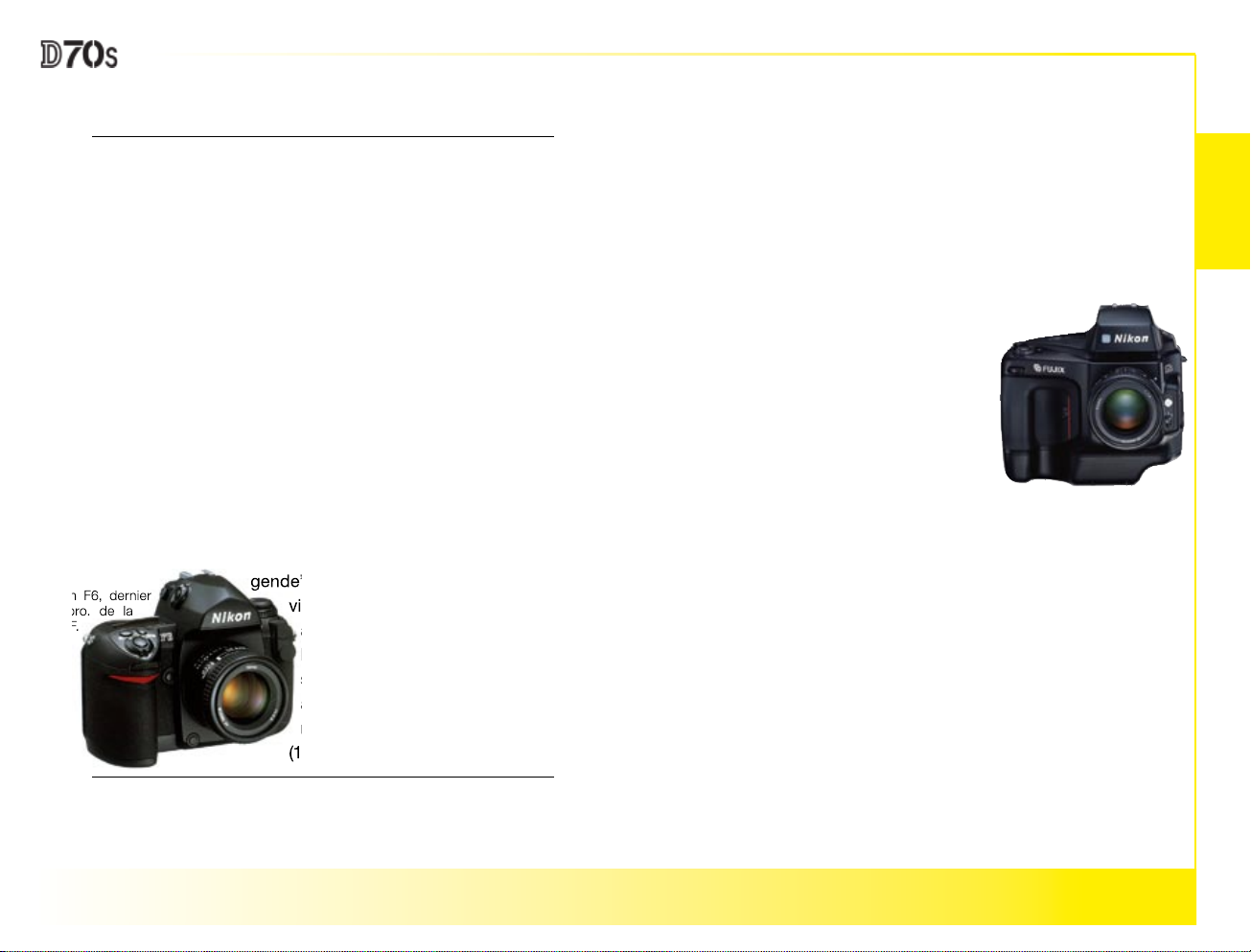
9
Présentation
HISTORIQUE NIKON
Créée en 1917 de la fusion de trois entreprises d’optiques
japonaises, Nippon Kogaku Kabushiki Kaisha (L’Optique
Japonaise, Société par Actions*) – contracté depuis en
“Nikon” –, a débuté ses activités en produisant des optiques
pour l’industrie et l’instrumentation scientifique.
A la fin de la seconde guerre mondiale, Nikon décide de
produire son propre boîtier et, en 1948, apparaît le Nikon 1,
appareil télémétrique au format 24 x 32. Mais il a fallu attendre
1957, date à laquelle les boîtiers Nikon commencent à être
importés aux USA, pour que la marque entre véritablement
dans le cœur des photographes : le Nikon SP devient un
boîtier “mythique”. Il possède un obturateur qui sera réalisé
en titane dès 1959, atteignant le 1/1000 s et une motorisation
à 3 images/s.
Une lignée de reflex
Côté reflex, c’est en 1959 que le Nikon F va créer la “lé-
gende” du photo-reporter. Prisme et
viseur interchangeables, cellule
au CdS, gamme de 13 optiques :
l’appareil est résolument professionnel. Les boîtiers pro. vont
alors se succéder à un rythme
régulier : F2 (1971), F3 (1980), F4
(1988), F5 (1996) et F6 (2004).
* Kogaku est ici utilisé dans son acception usuelle : “l’optique”
car sa traduction littérale est : “Science de la Lumière”. Merci à
Bernard Denevi pour cette précision linguistique capitale !
Parallèlement, Nikon produit des appareils semiprofessionnels qui conservent l’orientation “haut de gamme”
chère à la marque. Nous citerons par exemple les Nikon FA
(1983), F801 (1988, décliné en F801s en 1991), F100 (1998)
et F80 (2000, dont le D70s utilise la carcasse). Ces boîtiers
amateurs bénéficient très souvent des innovations intégrées
dans les reflex professionnels.
L’aventure numérique
Les reflex professionnels
En 1989, alors que le mot “numérique”
est encore étranger au monde de la
photographie, Nikon présente le QV1000C, reflex pro. équipé d’un capteur
à... 380 000 pixels. Préhistorique ! Le
premier appareil “sérieux” est produit
en 1996 : le Nikon E2 (et sa variante
E2s plus rapide), avec ses quelques
1,2 millions de pixels, est destiné
aux photographes de presse. Il accepte, avec quelques
réserves, l’ensemble de la gamme optique de la marque.
Le premier reflex numérique répondant aux critères
de qualité actuels est présenté en 1999 : le Nikon D1,
architecturé autour du F5 argentique, va rapidement devenir
incontournable grâce à sa qualité d’image exceptionnelle.
Avec seulement 2,74 millions de pixels, les images qu’il
produit supportent en effet, sans problème, l’impression
“pleine page” dans les magazines de qualité. La preuve de
l’importance du traitement logiciel des données issues du
CCD est faite !
Ascendants célèbres
Le Nikon F6, dernier
boîtier pro. de la
gamme F.
Le Nikon E2s possédait une
optique de reprise interne pour
conserver l’angle de champ
des optiques Nikkor.
gende” du photo-reporter. Prisme et
viseur interchangeables, cellule
au CdS, gamme de 13 optiques :
l’appareil est résolument profes-
sionnel. Les boîtiers pro. vont
alors se succéder à un rythme
régulier : F2 (1971), F3 (1980), F4
(1988), F5 (1996) et F6 (2004).
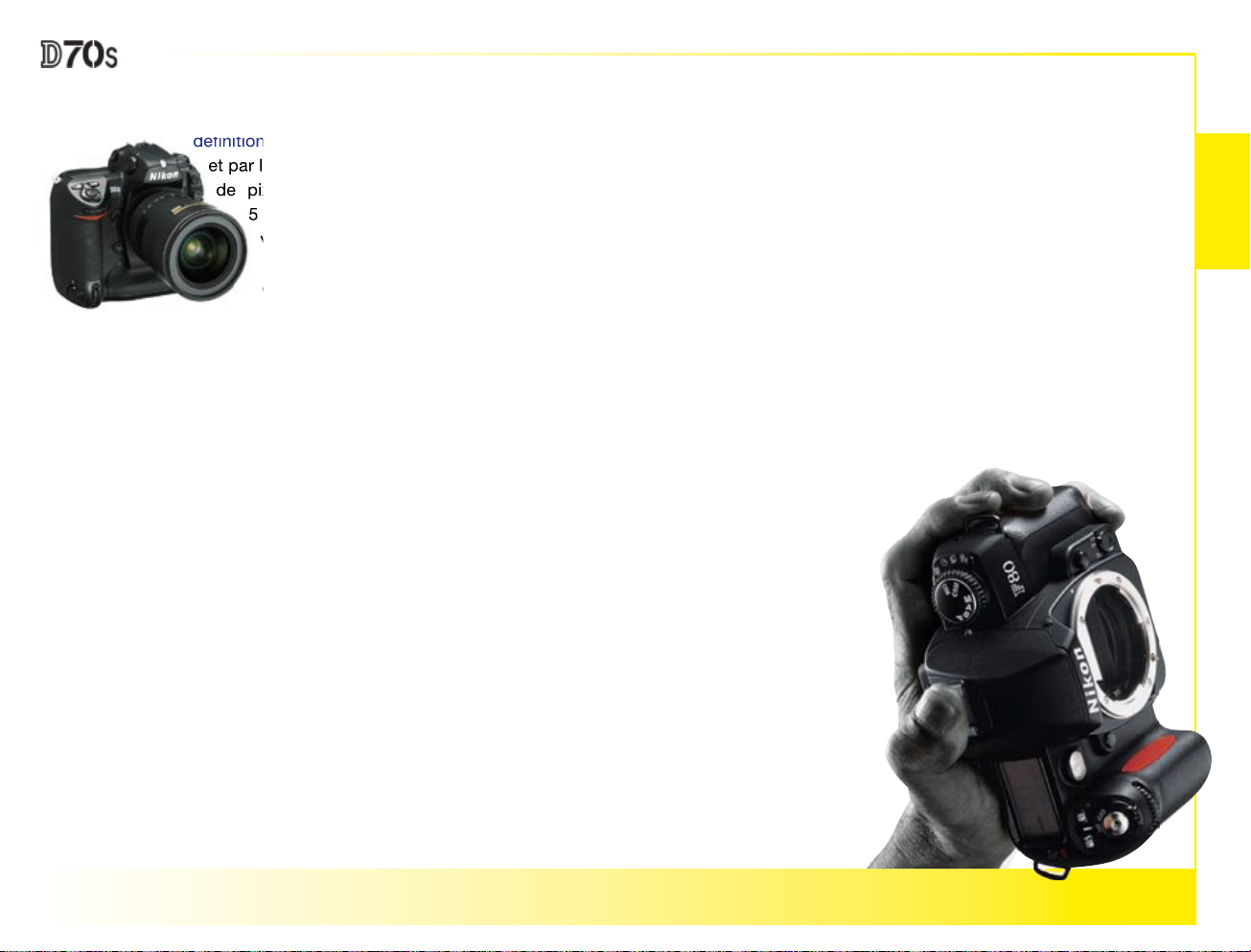
11
Présentation
Dès 2001, le D1 sera remplacé par le D1X, qui double sa
définition globale avec 5,47 millions de pixels,
et par le D1H, qui conserve ses 2,74 millions
de pixels mais dont le cadencement à
5 images par seconde – jusqu’à 40
vues maximum – le destine plus
particulièrement aux photographes
de sport. Trois ans plus tard apparaît
le D2H qui, doté d’un nouveau capteur
JFET LBCAST à 4,1 millions de pixels
développé par Nikon, améliore encore
la cadence de prise de vue : 8 images
par seconde, toujours sur 40 vues !
Fin 2004, le D2X crée l’évènement en
triplant le nombre de pixels (12,4 millions) du D2H. Il reprend
à ce dernier son système AF sur onze zones, mais intègre
un nouvel algorithme de traitement d’image optimisant
encore la qualité. La mesure matricielle couleur 3D a, en
outre, encore été améliorée par l’adjonction de nouveaux
cas-types. Le retard au déclenchement reste, malgré tout,
ultra-court : temps de réaction égal à 37 ms, identique à
celui du modèle “sportif”.
La gamme “experte”
Parallèlement à ces reflex professionnels, Nikon développe
des scanners films (LS-3510AF en 1991, puis la série des
CoolScan) pour les fidèles à l’argentique qui souhaitent
numériser leurs films, ainsi que des appareils photo
numériques compacts (les CoolPix) pour les photographes
amateurs. Entre ces deux pôles, les photographes “experts”
vont trouver leur bonheur avec, en 2002, le Nikon D100.
Le boîtier argentique sur lequel Nikon, après modification
mécanique, a “greffé” l’électronique nécessaire à la prise
de vues numériques est le boîtier pour photographes
passionnés le plus abouti de la gamme : le Nikon F80.
Paradoxalement, malgré son orientation amateur, son
capteur CCD possède une définition de 6,1 millions de
pixels, plus élevée que celle des modèles pro. de la marque
présents au catalogue lors de sa sortie. Mais, comme on l’a
vu, le nombre de pixels ne fait pas tout : les modèles haut de
gamme conservent l’avantage de leur construction à toute
épreuve et de leur traitement de l’information optimisés.
Le Nikon D70
Le Nikon D70, sorti deux ans plus tard, reprend en grande
partie, et en les améliorant, les caractéristiques du D100. L’amélioration la plus spectaculaire
reste l’adoption de la
mesure de la lumière
couleur 3D, issue des
modèles pro. Pour
autant, la vocation amateur est soulignée par
la résurgence des modes d’exposition “variprogrammes”.
Les reflex numériques professionnels Nikon fonctionnent par
paire : un modèle “X” – ici le récent D2X – conçu pour la haute
définition épaule un modèle “H”
orienté reportage et sport, pour
s’adapter aux activités de tous les
professionnels de l’image.
L’arrivée du D70
Le boîtier argentique F80,
qui a lui aussi connu un
immense suc cès, a se rvi de
base “mécanique” aux reflex
numériques D100, D70 et D70s.
définition
et par le D1H, qui conserve ses 2,74 millions
de pixels mais dont le cadencement à
5 images par seconde – jusqu’à 40
vues maximum – le destine plus
de sport. Trois ans plus tard apparaît
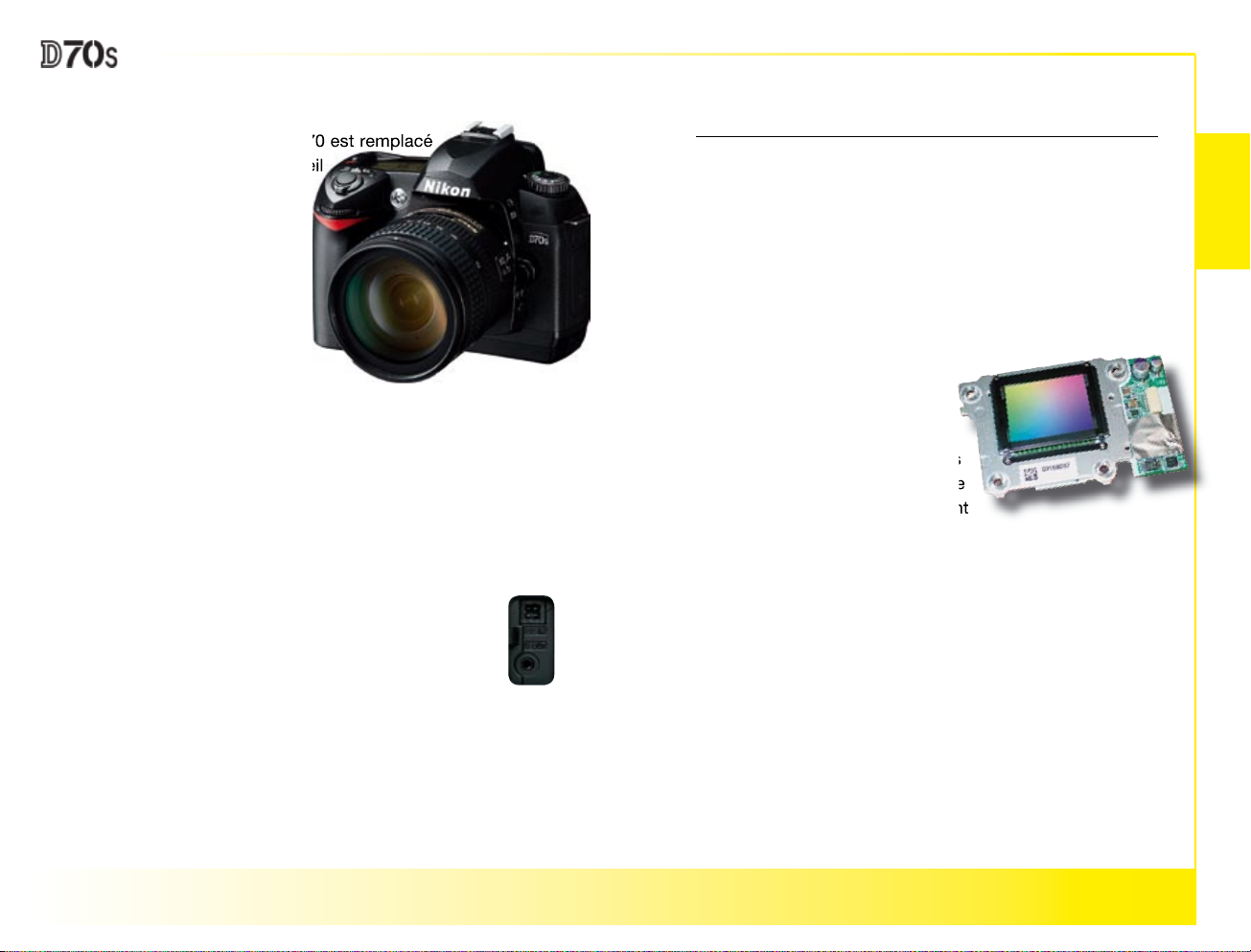
13
Présentation
POINTS CLEFS DU NIKON D70S
Les points forts du D70s concernent bien entendu ses caractéristiques et performances numériques : capteur CCD
à 6,1 millions de pixels, algorithmes et processeur de traitement d’image évolués, balance des blancs ultra-précise...
Mais son système photographique “traditionnel” (autofocus
et analyse de la lumière dérivés des boîtiers pro., gestion du
flash ultra-perfectionnée...) ne doit pas être négligé.
Qualité d’image
Le capteur CCD du Nikon D70s
possède au total 3 008 x 2 000
pixels effectifs, ce qui permet
d’envisager des agrandissements
de grandes dimensions sans perte
de qualité. Il possède un excellent
rapport signal sur bruit et une plage
dynamique élevée. Grâce à l’importante surface des pixels
qui le composent, sa plage de sensibilité s’étend de 200 à
1 600 ISO et reste pleinement utilisable sans montée excessive du bruit en haute sensibilité. Ce capteur est par ailleurs
épaulé par deux systèmes qui assurent aux images une très
haute définition :
le nouveau processeur d’image numérique intègre
des algorithmes de nouvelle génération qui gèrent toutes
les étapes du traitement de l’image et optimisent leur
qualité. Il gère également la balance des blancs, contrôle
les tons et les couleurs et traite le bruit numérique,
toujours possible lors des expositions de longue durée,
❏
D70 et D70s
Le CCD du D70s est au cœur
du système.
Le Nikon D70s
Un an plus tard, le Nikon D70 est remplacé
par le Nikon D70s. L’appareil
est quasiment identique à
son aîné. Extérieurement,
seul l’écran ACL arrière est
plus grand (2’’ au lieu de
1,8’’). Les menus s’y affichent d’ailleurs avec un graphisme plus lisible. D’autres
améliorations fonctionnelles
séduiront l’amateur :
la couverture angulaire du flash intégré passe de
20 mm à 18 mm, ce qui le rend compatible avec les derniers zooms Nikon DX (en évitant le léger vignetage parfois constaté avec l’AF-S DX 18-70 mm f:3,5-4,5G ED),
la capacité de la batterie (EN-EL3a) passe à 1500 mAh
ce qui augmente l’autonomie de prise de vues. La
batterie EN-EL3 (1400 mAh) du D70 reste compatible
avec le D70s,
le D70s bénéficie d’une prise pour
télécommande filaire MC-DC1 alors que le D70
n’avait accès qu’à une télécommande infrarouge
ML-L3,
le logiciel interne a été modifié pour optimiser l’autofocus, le piqué et le bruit des images.
Notons qu’une nouvelle version de ce firmware (voir la
procédure de mise à jour page 116) permet également au
D70 de bénéficier du nouveau graphisme des menus et des
améliorations logicielles du D70s.
❏
❏
❏
❏
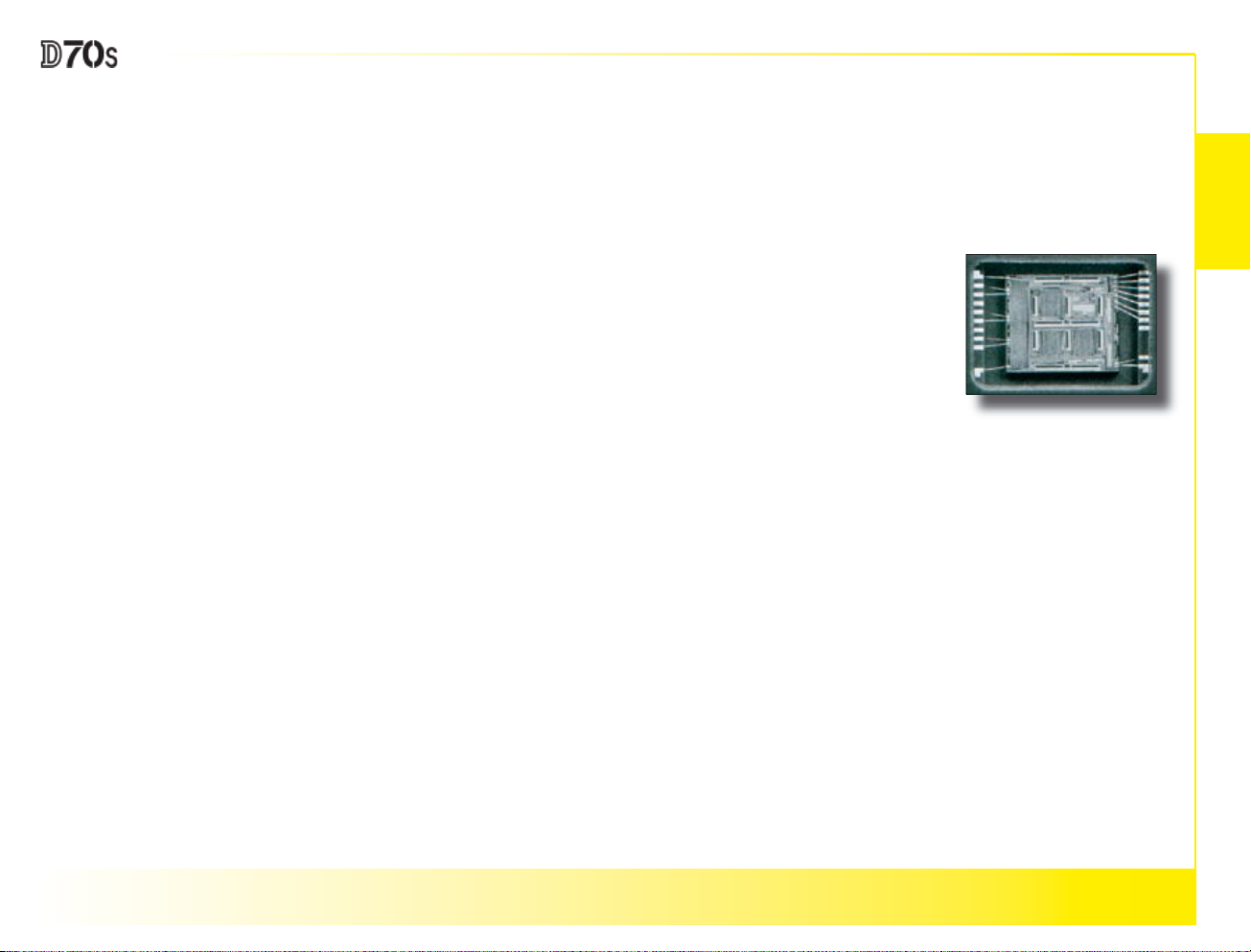
15
Présentation
le posemètre matriciel à 1 005 photosites fournit deux
informations déterminantes pour la qualité des images.
Il mesure tout d’abord avec précision la luminance de
la scène photographiée (mesure matricielle couleur
3D, voir plus loin). Il fournit ensuite une estimation très
précise de la température de couleur, quelles que soient
les conditions d’éclairage.
Rapidité de fonctionnement
Dès sa mise sous tension, le Nikon D70s est prêt à
déclencher : c’est un avantage considérable lorsqu’il s’agit
de réagir rapidement face à une situation imprévue. Son
temps de réponse au déclenchement est en outre ultracourt : la parallaxe de temps est réduite au minimum.
Son circuit LSI à hautes performances fait également appel
à des algorithmes de nouvelle génération afin d’accélérer
les opérations de traitement de l’image et d’écriture : les
temps d’enregistrement des fichiers RAW ont par exemple
été considérablement réduits par rapport au D100.
Citons également quelques caractéristiques qui concourent à faire du D70s un appareil extrêmement rapide :
Prise de vues en rafale à 3 vues par seconde
jusqu’à 12 images consécutives en JPEG FINE (20 vues
consécutives en JPEG NORMAL) grâce à une gestion
élaborée de la mémoire tampon et un transfert accéléré
sur la carte mémoire,
Enregistrement très rapide compatible avec les formats de fichier FAT16 et FAT32,
Vitesses d’obturation très élevées : jusqu’à 1/8 000 s
et synchronisation au flash pouvant atteindre 1/500 s.
❏
❏
❏
❏
Autofocus dynamique à plage large
Le module de détection autofocus “Multi-CAM900” du Nikon
D70s, comprenant 900 éléments de détection CCD, possède
5 capteurs disposés en réseau, couvrant une surface très
importante au centre du champ de visée. Le système AF
qui exploite les mesures de ce module possède un double
mode de fonctionnement :
sélectif et dynamique. En mode
sélectif, on peut sélectionner
individuellement un des cinq
collimateurs pour effectuer la
mise au point n’importe où dans
l’image. En mode dynamique
par contre, le D70s “accroche”
automatiquement le sujet et suit
son déplacement sur ses cinq
collimateurs. Cette localisation
dans le champ visé se double d’un
suivi prédictif en distance et s’appuie sur la technologie LockOn™. Ce système permet d’éviter de faire la mise au point
sur un élément perturbateur qui pourrait momentanément
s’interposer entre le sujet pisté et l’appareil.
Dernier point fort du système autofocus du D70s : sa
rapidité de mise au point. Grâce à l’utilisation de moteurs
coreless, sans inertie, et du fait également de l’algorithme
de traitement des informations de mise au point par les
calculateurs intégrés, celle-ci est quasi-instantanée avec
des optiques AF “classiques”, sans moteur intégré. Equipé
d’une des optiques Nikkor à moteur Silent-Wave (AF-S), elle
est encore plus rapide !
Le module Multi-Cam9 00 de
détection autofocus du Nikon
D70s possède 900 pixels
répar tis sur cinq collimateurs
disposés en croix au centre du
champ visé. Il est identique au
module utilisé dans le F80.
Rapide !
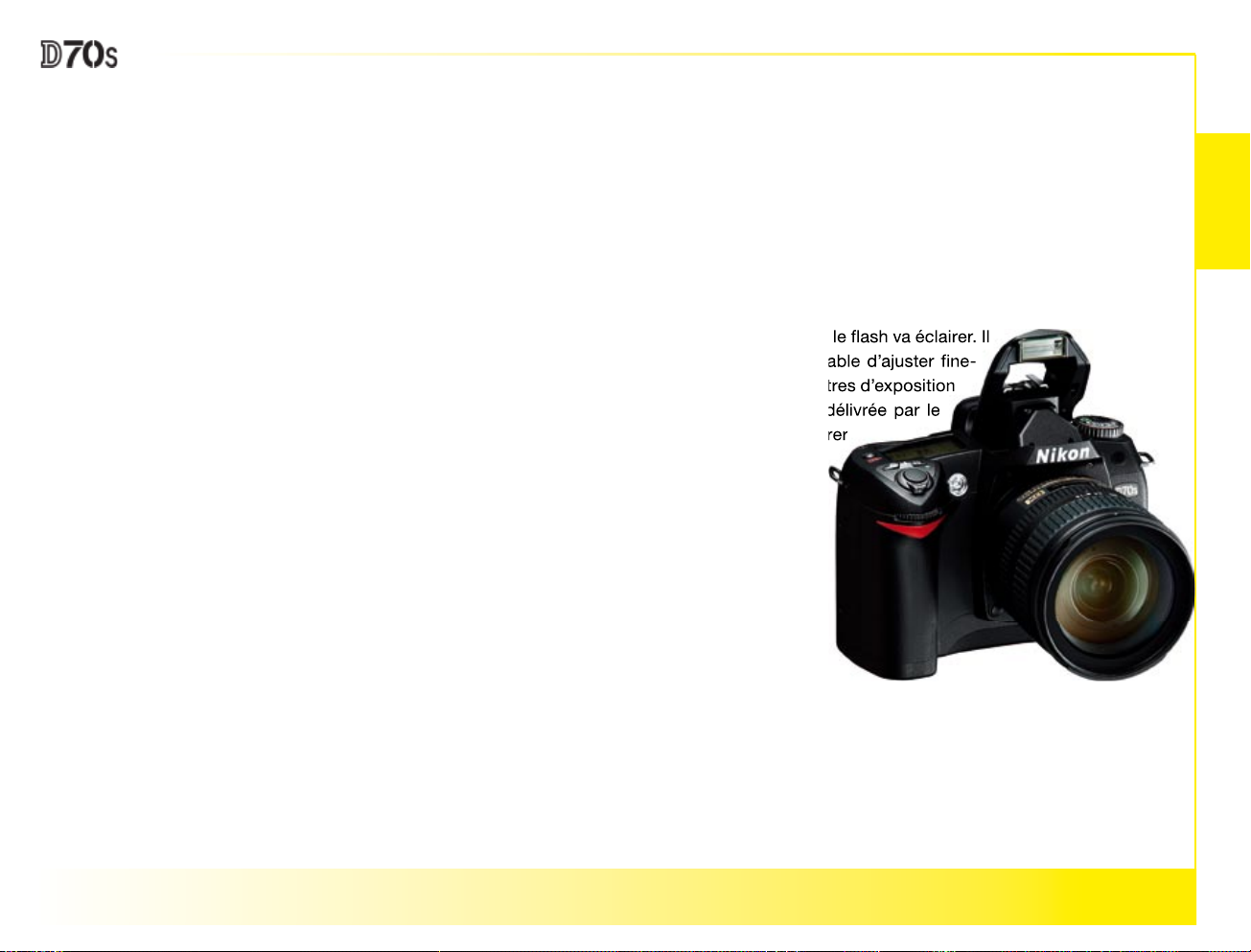
17
Présentation
Mesure matricielle couleur 3D
Le système de mesure de l’exposition du D70s est identique
à celui du Nikon F5. Au lieu d’une classique cellule au silicium,
il utilise un minuscule capteur CCD à 1 005 photosites,
recouverts d’une mosaïque de micro-filtres rouges, verts
et bleus, qui lui fournit une “imagette couleur” de la scène
visée.
Le posemètre effectue alors une synthèse de toutes les informations dont il dispose :
luminance des différentes zones de la scène,
contraste entre ces différentes zones,
localisation spatiale du sujet (à partir du capteur de
mise au point sélectionné),
distance du sujet (avec un objectif de type D ou G),
couleur dominante du sujet,
puis les compare à une base de données riche d’une
compilation de plus de 30 000 cas- types pour déterminer le
temps de pose et l’ouverture de diaphragme les plus adaptés
à la situation photométrique vue à travers l’objectif.
Grâce au nombre record de zones d’analyse de la scène, le
Nikon D70s a une idée très précise de la répartition spatiale
des luminances (masses claires et sombres) dans l’image,
et notamment de celles qui concernent le sujet principal,
localisé grâce au capteur autofocus actif. Il analyse donc
la scène photographiée de façon très pertinente. De plus,
grâce à l’information “couleur”, l’exposition est finement
corrigée pour un meilleur rendu de l’image, en l’adaptant
aux caractéristiques spectrales du CCD de prise de vue.
Bien entendu, ce mini-CCD sert également à déterminer la
température de couleur de la scène.
❏
❏
❏
❏
❏
Système i-TTL au flash
Le flash intégré au Nikon D70s est au centre d’un nouveau
système flash Nikon appelé CLS (Creative Lighting System,
système d’éclairage créatif) inauguré avec le D2H.
Comme sur ce reflex professionnel, le D70s utilise sa cellule
matricielle couleur à 1 005 photosites pour évaluer le niveau
de lumière ambiante et mesurer l’éclair du flash. Pour cela,
le D70s émet, juste avant le déclenchement, une salve de
deux petits éclairs imperceptibles qui lui permettent d’évaluer la scène que le flash va éclairer. Il
est dès lors capable d’ajuster fine-
ment les paramètres d’exposition
et la puissance délivrée par le
flash pour équilibrer
pa r fa it em en t
les images.
Mieux : ce système, appelé
i-TTL, fonctionne même avec
plusieurs flashes
type SB-800 ou
SB-600, sans
que ceux-ci
soient connectés au D70s via
un câble (pilotage i-TTL sans
cordon) : le flash intégré peut ainsi piloter des flashes déportés grâce à un code intégré aux pré-éclairs.
Le petit flash intégré du Nikon D70s n’est pas très
puissant (nombre-guide de 15 m à 200 ISO) mais il est
particulièreme nt complet : il peut piloter en i-TTL des flashes
complémentaires sans cordon et possède une fonction de
mémorisation de la puissance de l’éclair.
Mesure de la lumière
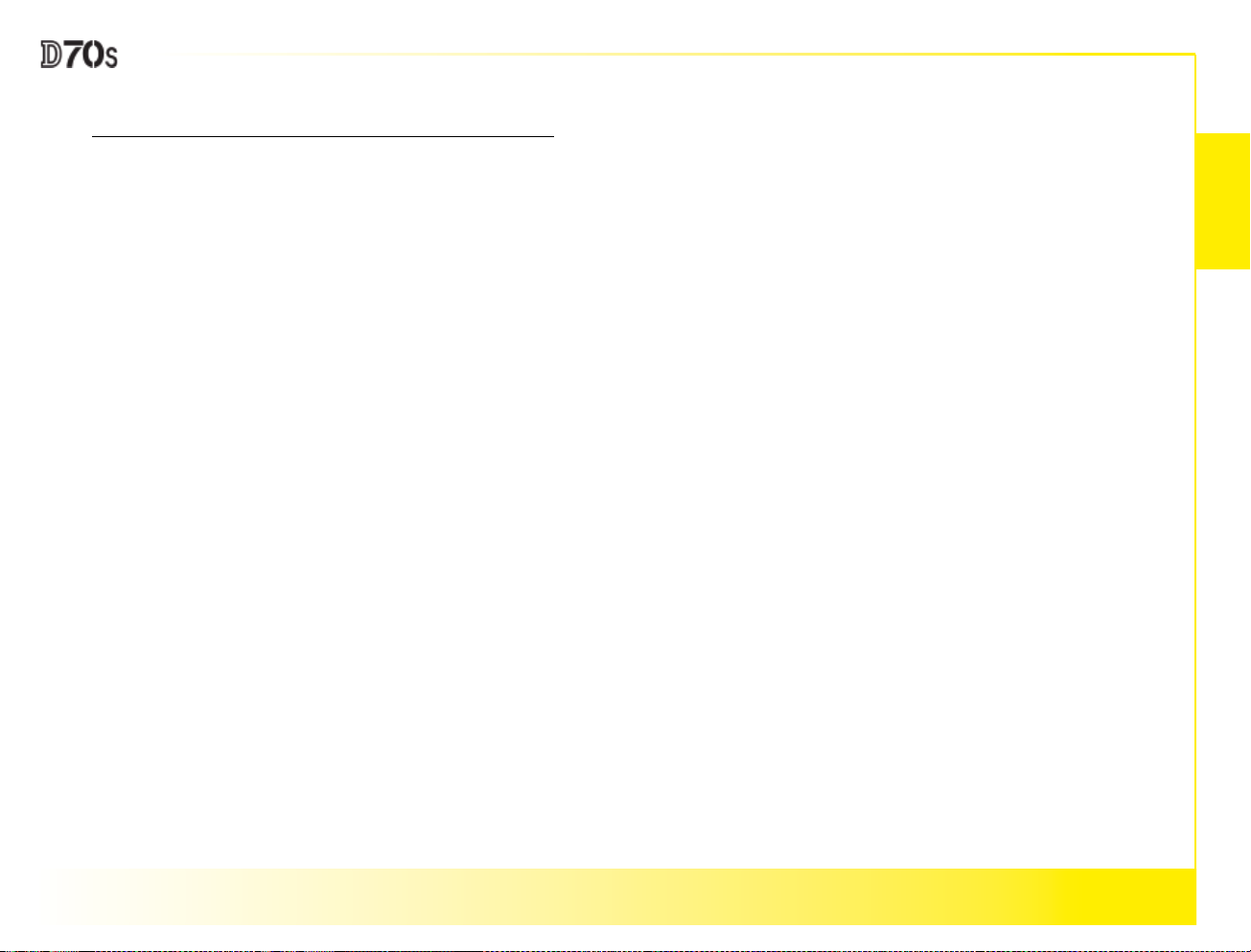
19
Présentation
Fiche technique
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type Reflex numérique à monture Nikon F.
Capteur CCD 23,7 x 15,6 mm (coefficient de focale x1,52
par rapport au format 135) à 6,15 millions de pixels.
Définition maxi : 3 008 x 2 000 pixels.
Viseur Correcteur dioptrique (-1,6 à +0,5 dioptries).
Dégagement oculaire : 18 mm à -1 dioptrie.
Couverture : 95 % environ.
Grossissement : 0,75x avec un 50 mm réglé sur
l’infini.
Verre de visée BriteView de type B avec collimateurs de mise au point et quadrillage.
Mise au
point
Autofocus passif à détection de phase (module
Nikon Multi-CAM900 à 5 collimateurs).
Sensibilité : IL-1 à IL19 (équivalent 100 ISO).
Mode sélectif, dynamique et dynamique avec
priorité au sujet le plus proche.
Suivi ponctuel (S) ou continu (C) avec suivi de mise
au point activé automatiquement si le sujet se déplace. Mise au point manuelle (M).
Exposition Gamme de sensibilité : 200 à 1 600 ISO.
Mesure matricielle couleur 3D (avec objectifs G ou
D) par capteur RVB à 1 005 photosites.
Mesure pondérée centrale (75% de la sensibilité
dans un cercle de 6, 8, 10 ou 12 mm).
Mesure spot (diamètre 2,3 mm, soit 1% du cadre
de visée) sur capteur AF actif.
Bracketing sur 2 ou 3 vues par 1/2 ou 1/3 IL.
Modes
d’exposition
Auto, Auto programmé (P), Auto à priorité à l’ouverture (A), Auto à priorité vitesse (S), Manuel (M) et
6 Vari-programmes.
Correcteur d’exposition -5 à +5 IL.
Obturateur Mécanique et électronique DTC, de 30 s à 1/8 000 s
et pose B.
Balance
des blancs
Automatique, 6 modes préprogrammés et manuel.
Ajustement fin et bracketing possible.
Flash Flash intégré NG 15 m à 200 ISO.
Contrôle TTL par capteur RVB à 1 005 photosites.
Dosage automatique flash/ambiance i-TTL ou
flash standard i-TTL avec flash intégré, SB-600
ou SB-800. Mode manuel à priorité distance avec
SB-800.
Synchro lente ou normale sur le premier ou le second rideau.
Système anti yeux-rouges.
Correction de puissance -3 à +1 IL.
Système d’éclairage créatif avec SB-600 et SB-
800.
Synchronisation jusqu’à 1/500 s.
Enregistrement
Carte CompactFlash type I ou II et Microdrive.
Conforme à l’architecture DCF 2.0 et DPOF.
Compatible FAT16 et FAT32.
Fichiers NEF (RAW, sans perte sur 12 bits RVB) et
JPEG (compression sur 3 niveaux - 8 bits RVB).
Interface USB 2.0.
Vidéo NTSC ou PAL.
Moniteur ACL TFT polysilicium basse température 2’’
(D70s), 1,8’’ (D70). 130 000 pixels.
Luminosité réglable.
Alimentation
Batterie Li-Ion rechargeable.
Trois piles CR2 avec porte-pile MS-D70s.
Adaptateur secteur optionnel.
Divers Testeur de profondeur de champ.
Retardateur : 2 à 20 s.
Griffe porte-accessoire standard ISO.
Firmware pouvant être mis à jour.
Prise pour télécommande (D70s uniquement)
Dimensions 140 x 111 x 78 mm.
Masse 595 g.
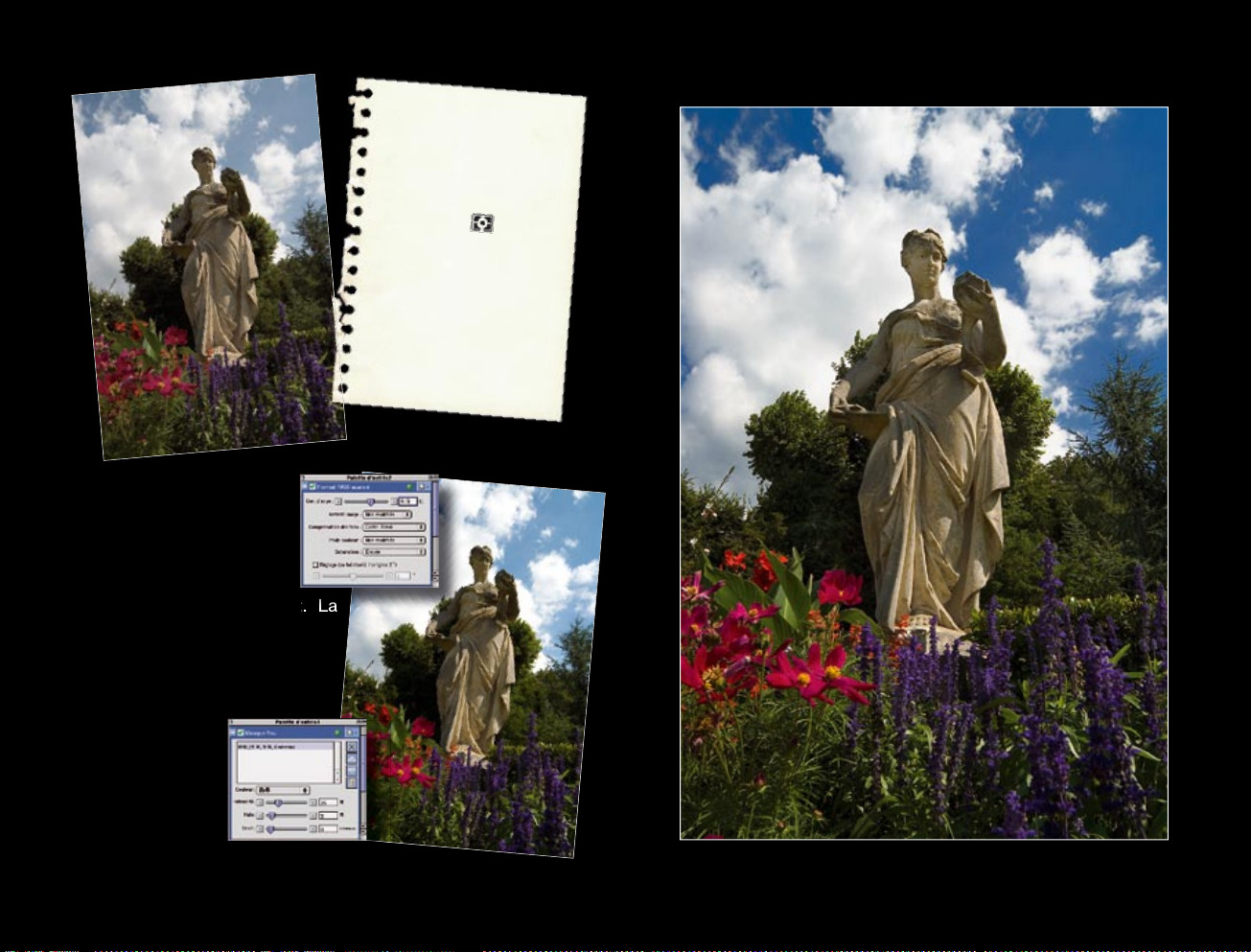
Le soleil est légèrement
voilé et l’image manque
de contraste. Avec Nikon
Capture, l’exposition, le
contraste et la saturation
sont améliorés rapidement. La
netteté est également augmentée de 25%. Les retouches finales, sous Photoshop, ont permis
d’assombrir le ciel en préservant la luminosité
des nuages. Les
pétales des fleurs
ont été éclaircies
une à une.
Prise de vue : Travail des fi chiers RAW
Objectif
20 mm f:2,8D
Vitesse
1/500 s
Ouverture
f:11
Sensibilité
200 ISO
Mode Expo
A
Mesure Expo
Mode AF
AF-S
Bal. blancs
Auto
Mode couleur
Adobe RVB
Format
RAW
Netteté
Normale
Comp. Tons
Aucune
Réduc. bruit
Désactivée
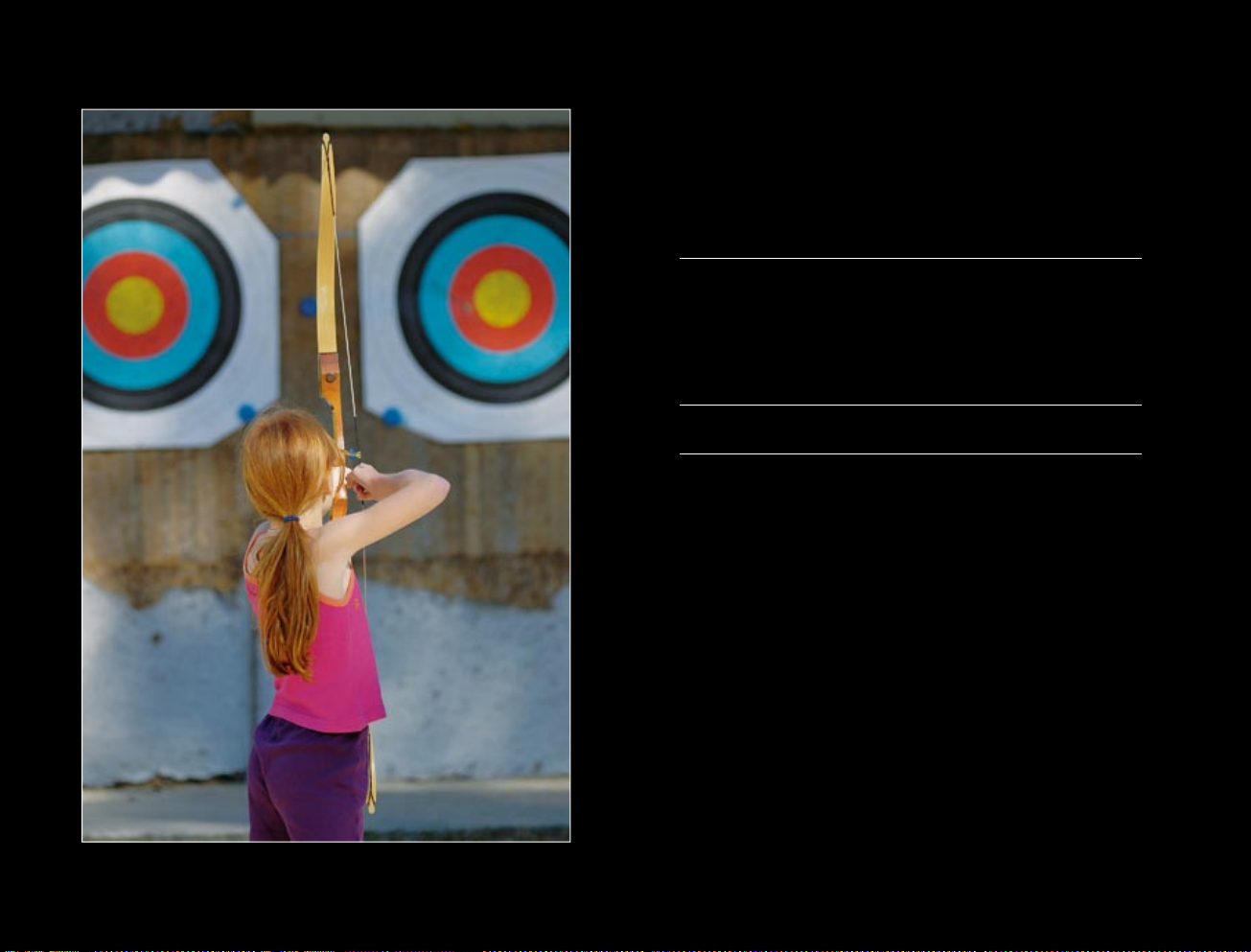
23
LE CAPTEUR CCD DU NIKON D70S
Formation de l’image .....................................26
Matrice de Bayer ........................................... 28
Filtre anti-aliasing ..........................................29
Réseau de micro-lentilles .............................. 32
TRAITEMENT DES DONNÉES
Conversion Analogique/Numérique ..............34
Procédé de recomposition ............................ 35
Balance des blancs ....................................... 38
Amélioration de la netteté..............................46
Compensation des tons ................................50
Réglage de la teinte .......................................56
Réglage de la saturation ................................56
Choix d’un espace colorimétrique................. 58
Optimisation automatique ............................. 59
Enregistrement des images ........................... 60
Numérique
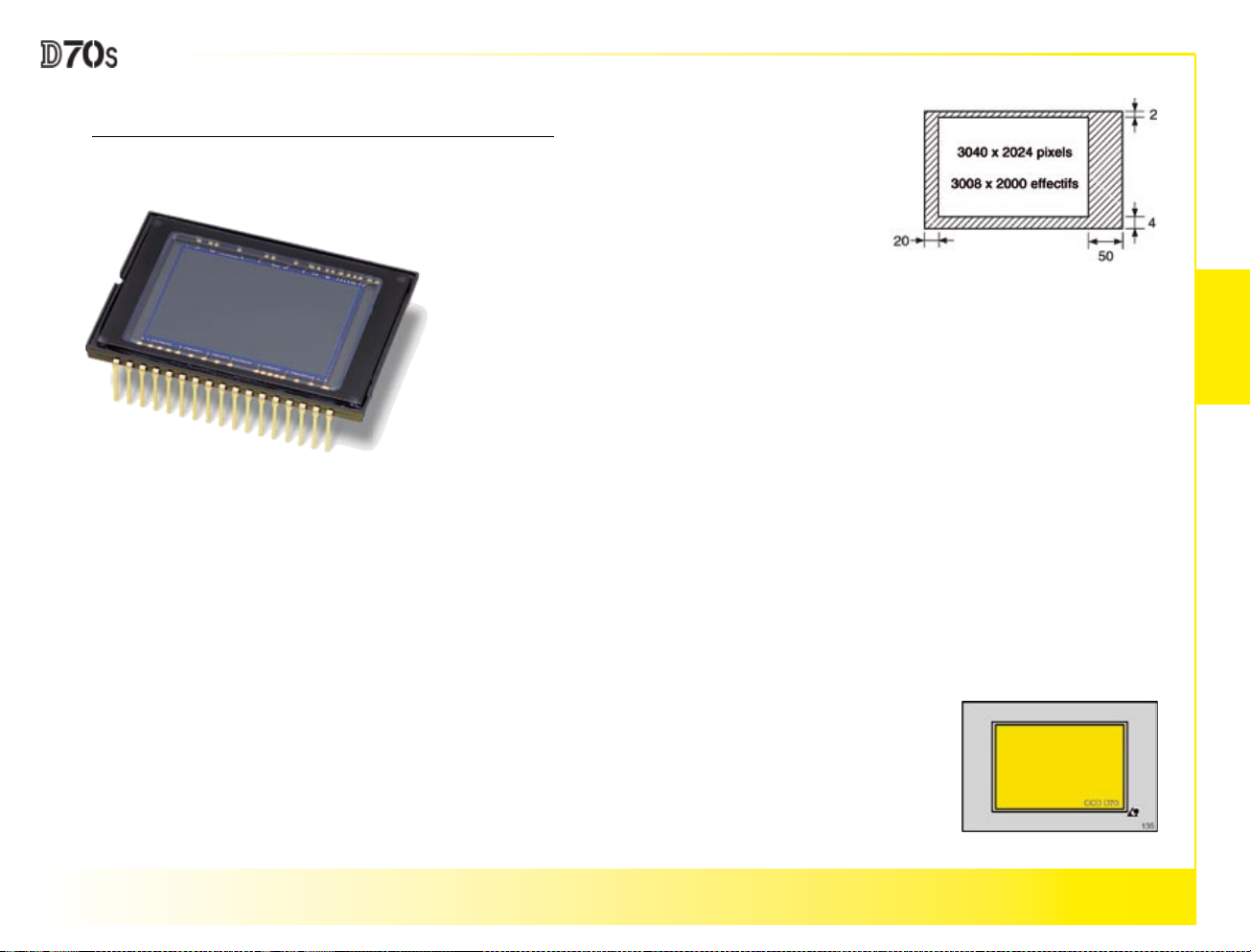
25
Numérique
En réalité, le capteur
CCD du D70s possède
un nombre de pixels
plus important que
celui qui correspond
réellement à l’image
générée, mais certains
sont masqués (“noirs”)
pour mesurer le bruit
thermique propre à
chaque prise de vue.
Certains autres sont
actifs (ils sont sensibles à la lumière qu’ils reçoivent) mais
sont seulement utilisés pour des calculs et ne servent donc
pas à l’image finale.
Le capteur CCD du Nikon D70s mesure 25,10 x 17,64 mm
(dimensions du circuit électronique) et sa surface sensible
utile est de 23,70 x 15,60 mm. Celle-ci est donc 2,3 fois plus
faible que celle du format 135 (24x36 mm). En référence
à l’autre système argentique – que la photo numérique a
aujourd’hui enterré – la taille du CCD du D70s, comme celui d’autres reflex numériques utilisant un capteur de même
taille, est souvent qualifié d’APS-C (Advanced Photo Sys-
tem-Classic), dont le format est proche (25,00 x 16,70 mm).
Le schéma ci-contre montre, à
taille réelle, le format de ces différents standards. On verra plus
loin que Nikon a dû développer
une gamme d’objectifs spécifiques pour ce format de capteur.
LE CAPTEUR CCD DU NIKON D70S
La surface sensible du Nikon D70s est un circuit électronique appelé CCD qui convertit l’énergie lumineuse qu’il re-
çoit en courant électrique proportionnel.
Les CCD ont été inventés au
début des an-
nées 70 par des
c h e r c h e u r s
du laboratoire
Bell. La fabri-
cation d’un cap-
teur CCD s’effec-
tue à partir de fines
plaques de silicium
traitées optiquement afin
de définir différentes fonctions au circuit. Le CCD “Super
HADTM” du D70s est, à quelques améliorations près, le
même que celui utilisé sur le Nikon D100.
Contrairement à une émulsion argentique dont les particules
photosensibles (halogénures d’argent) sont réparties
aléatoirement sur toute la surface, les éléments sensibles,
appelés photosites, d’un CCD forment un carroyage régulier.
Le CCD du D70s est ainsi composé de 3 008 lignes de 2 000
photosites. Chaque photosite est carré et mesure 7,80 µm
de côté. Les images produites par le Nikon D70s comptent
donc 6,016 millions de pixels effectifs.
Par souci de simplification, on assimilera par la suite les
photosites (qui sont les micro-unités de capture d’image) et
les pixels (qui sont les éléments de l’image).
L e
c a p t e u r
CCD du D70s est fabriqué par Sony mais le traitement
de ses données est propre à Nikon.
Un certain nombre de photosites e st
recouvert d’un masque les insensibilisant à
la lumière. Ils servent à mesurer le courant
(appelé “courant d’obscurité”) délivré par
les photosites en l’absence de sollicitation
lumineuse. Ce “bruit”, qui est fortement lié
à la température, sera soustrait du signal
délivré par le s photosites “effectifs”.
Six millions de pixels
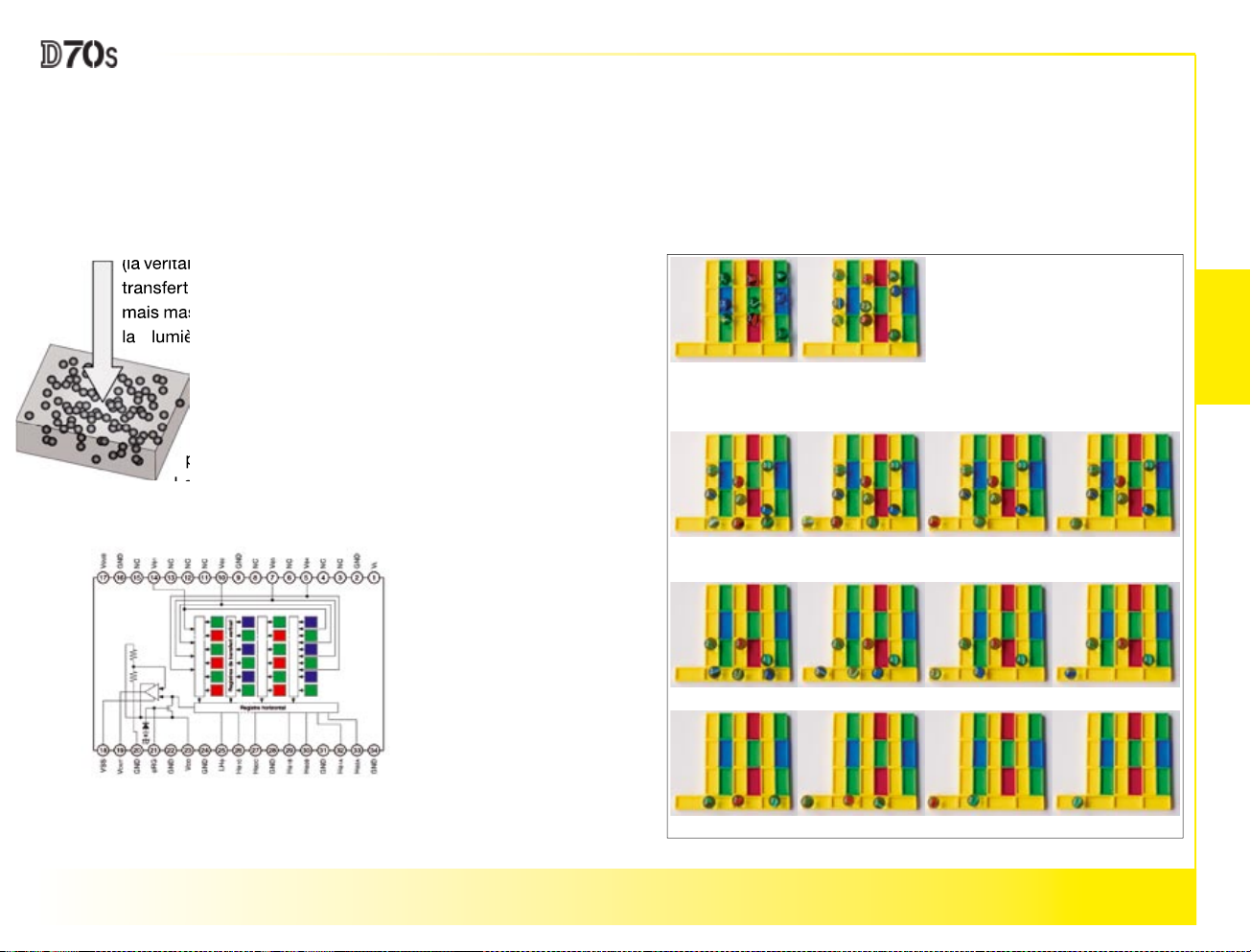
27
Numérique
Formation de l’image
Sans entrer trop en détail dans le fonctionnement
électronique d’un CCD, on peut schématiser assez
simplement la formation de l’image et son transfert vers les
calculateurs de l’appareil.
Chaque photosite est en fait composé d’un photodétecteur
(la véritable partie “sensible” du pixel) et d’une cellule de
transfert identique, dans sa structure, au photodétecteur
mais masquée à la lumière. Le photodétecteur convertit
la lumière qu’il reçoit (les photons transportant
l’énergie lumineuse) en électrons, qui s’y
accumulent alors comme dans une cuvette.
La charge électrique totale, c’est-à-dire le
nombre d’électrons dans le photosite, est
proportionnelle à l’intensité lumineuse reçue.
Lorsque l’exposition est terminée, le Nikon D70s
donne l’ordre au CCD de transférer toutes les charges
accumulées dans les photodétecteurs vers les cellules
de transfert,
regroupées en
registres verticaux.
Une série de signaux périodiques
permet ensuite de
transférer verticalement les charges
de cellule en cellule, jusqu’au registre
de transfert horizontal.
Les charges sont ensuite décalées, selon le même
processus, jusqu’à la sortie dans ce registre horizontal.
Les illustrations ci-dessous schématisent les différents
transferts permettant la lecture de toutes les charges
accumulées dans le CCD. Cette architecture particulière
est appelée “CCD à transfert interligne” (CCD-IT).
Diagramme de câblage électronique
du CCD utilisé par le Nikon D70s
(D’après document Sony).
Fonctionnement du CCD
Les charges sont
accumulées dans
les photosites
Décalage des
charges vers les
registres verticaux
adjacents aux
photosites
Décalage des
charges vers le
registre horizontal
Décalage des charges dans le registre horizontal puis
extraction du signal de sortie
Même processus pour la ligne suivante
Même processus pour la ligne suivante
(la véritable partie “sensible” du pixel) et d’une cellule de
transfert identique, dans sa structure, au photodétecteur
mais masquée à la lumière. Le photodétecteur convertit
la lumière qu’il reçoit (les photons transportant
proportionnelle à l’intensité lumineuse reçue.
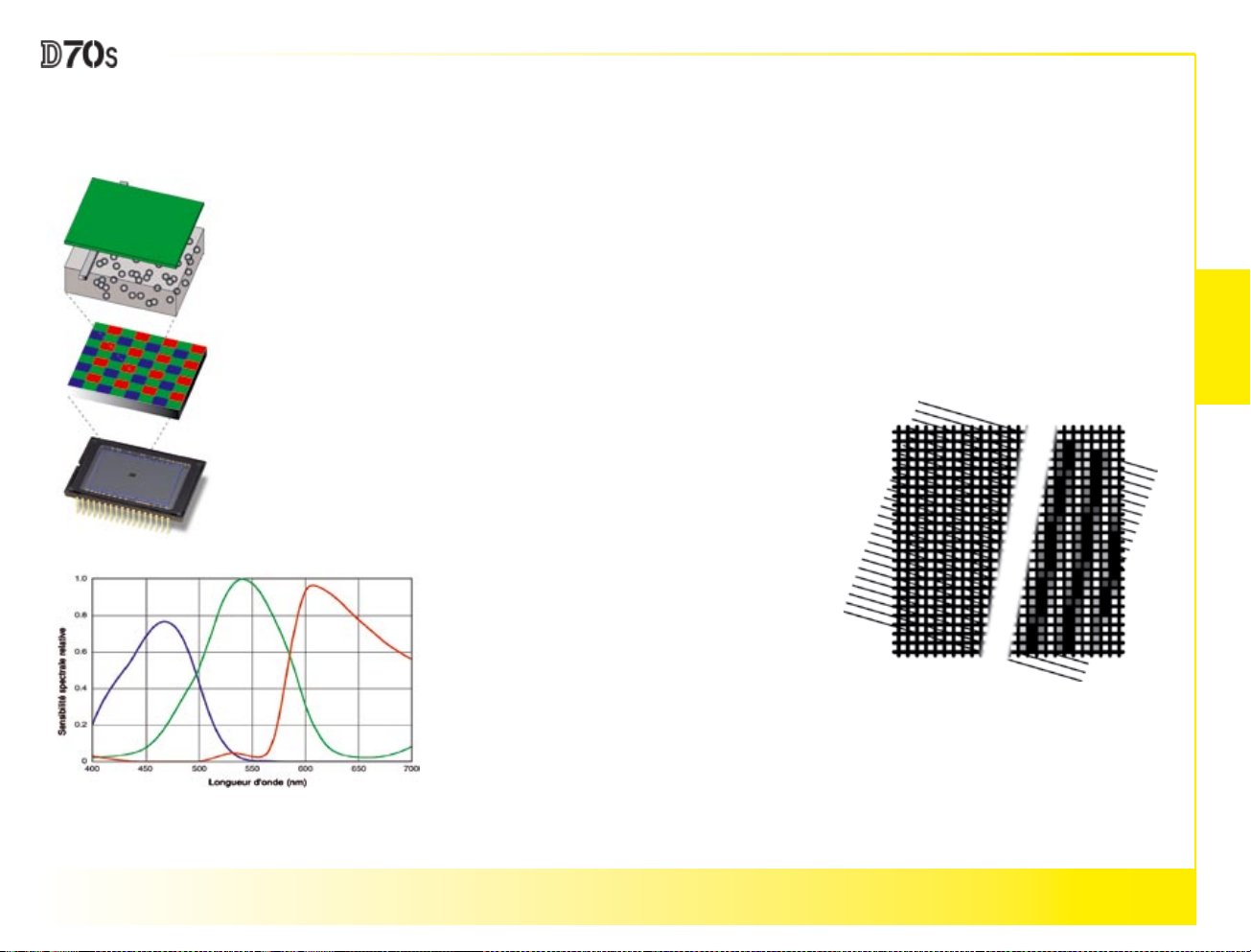
29
Numérique
Trichromie
Matrice de Bayer
Les photosites, comme les grains d’argent, réagissent à
l’intensité lumineuse qu’ils reçoivent : ils “voient” donc en
noir et blanc. Comme dans un film couleur, il faut donc leur adjoindre des filtres
colorés pour sélectionner une partie du
spectre lumineux qui les atteint et simuler
la couleur par synthèse trichrome. Chaque photosite est donc coiffé d’un microfiltre rouge, vert ou bleu. Pour respecter la
vision humaine qui est plus sensible dans
les jaune-vert, le nombre de photosites filtrés en vert est deux fois plus important
que celui des photosites filtrés en bleu ou
en rouge. L’ensemble des micro-filtres et
sa géométrie du type “1:2:1” – faisant référence aux proportions de filtres rouge, vert
et bleu – s’appelle la matrice de Bayer.
Les filtres sont bien entendu parfaitement adaptés en
couleur pour
r e c o n s t i tu er
le spectre le
plus étendu
possible, même
si la gamme de
couleurs est,
év i de m me n t,
moins large que
celle de l’œil
humain.
Courbes de sensibilité spectrale des filtres de la matrice
de Bayer du CCD du Nikon D70s (d’après doc. Sony).
Filtre anti-aliasing
Le capteur CCD du Nikon D70s est coiffé d’un filtre optique
passe-bas (dit filtre “anti-aliasing”) au niobate de lithium
(LiNbO3) dont le rôle principal est – cela peut sembler
paradoxal – de réduire légèrement la netteté des détails en
provenance de l’objectif.
Sans entrer dans le détail du théorème de Nyquist, nous
pouvons simplement parfois constater que l’observation
d’un phénomène cyclique par un système également répétitif peut conduire à des enregistrements étranges. Nous
avons, par exemple, tous en mémoire l’image des roues des
diligences qui semblent parfois tourner à l’envers, dans les
westerns. Cela
est lié au fait
que la fréquence
de capture des
images (24 images/s au cinéma)
est proche de
celle de rotation
des rayons des
roues.
En photo numérique, des
p h é n o m è n e s
identiques peuvent parfois survenir lorsque la taille de certains détails géométriques répétitifs avoisine la moitié de la taille des
photosites.
Le schéma ci-de ssus montre comment une série de
lignes parallèles est vue à travers un maillage ré gulier... et donc perçue par les photosites d’un CCD.
Un phénomène d’aliasing “en luminance” s’est cré é.
Aucun post-traitement ne permet d’y remédier.

31
Numérique
Par ailleurs, le filtre de Bayer peut tromper le CCD et créer
un aliasing “en chrominance”. Imaginons, par exemple, un
très fin faisceau de lumière blanche, dont le diamètre est
inférieur à la taille d’un pixel, parvenant sur le CCD (sur un
filtre rouge par exemple). L’appareil interprétera ce détail
de couleur blanche, qui ne recouvre pas entièrement le
quadruplet RVVB, comme un faisceau rouge pur.
Le filtre passe-bas, en diffusant le fin faisceau sur les quatre pixels du quadruplet, va rétablir l’équilibre chromatique :
par synthèse trichrome, il “verra” bien un signal blanc.
Notons que le filtre passe-bas possède également la propriété de rejeter les rayonnements infrarouges auxquels les
CCD sont très sensibles. Cela permet de caler le spectre
enregistrable par le D70s sur celui de l’œil humain.
Sous-échantillonnage
La mince couche de LiNbO3, collée au dessus du filtre de
Bayer du CCD du D70s, ne peut toutefois pas être trop
diffusante, sous peine de trop dégrader les fins détails de
l’image. Il faut en effet éviter de noyer ceux-ci dans le flou,
comme si un filtre “soft-focus” était utilisé devant l’objectif.
Aussi Nikon, comme tous les fabricants d’appareils photo
numériques, a-t-il dû jongler pour maximiser la netteté, tout
en limitant au maximum le risque de moiré. Mais le résultat
n’est forcément n’est qu’un compromis : le phénomène de
moiré peut donc, malgré tout, survenir dans certaines situations particulières. Rarement toutefois : pour l’illustrer, nous
avons dû créer de toute pièce une image particulière.
On peut, bien sûr, conseiller de changer légèrement de point
de vue pour annuler le phénomène. Mais comme on ne s’en
aperçoit que lors du traitement sur ordinateur (le moiré est
invisible sur l’écran ACL du D70s – et si l’on en distingue
un... c’est celui de l’écran lui-même !), ce conseil n’est pas
vraiment applicable en prise de vue. Seule l’utilisation de
Nikon Capture permet, a for tiori, de réduire le moiré.
La structure
répétitive du
vêtement a généré un aliasin
sur l’image. La
“Réduction de
l’effet de moiré” de Nikon
Capture permet d’éliminer
le phénomène.
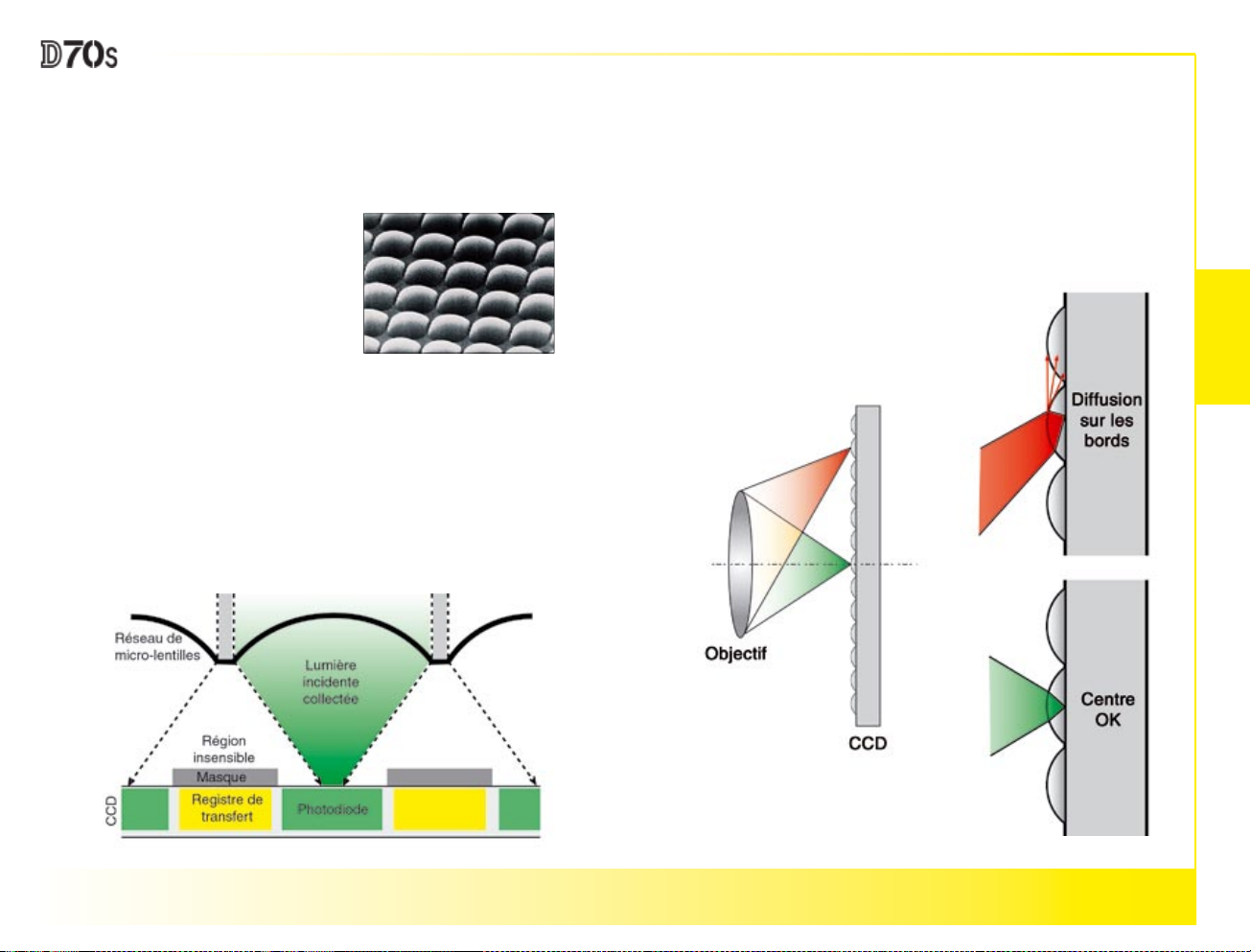
33
Numérique
Amélioration de la sensibilité
Réseau de micro-lentilles
Du fait de son architecture à transfert interligne, le CCD perd
une partie non négligeable de sa surface sensible. En effet,
une portion de chaque photosite est consacrée au transfert
des charges (registre de transfert, voir page 26) et est donc recouverte d’un masque afin qu’elle
ne se charge pas pendant l’exposition. Cette lumière perdue se
traduit par une baisse importante
de la sensibilité du capteur. Pour
récupérer en partie cette lumière,
le CCD et sa matrice de Bayer sont coiffés d’un réseau de
micro-lentilles, situé en dessous du filtre anti-aliasing.
Au dessus de chaque pixel, la micro-lentille va faire converger la lumière sur la partie sensible (la photodiode). Le gain
en sensibilité peut atteindre 40%. Evidemment, la fabrication d’un tel réseau – chaque micro-lentille mesurant moins
de huit millièmes de millimètre – est complexe, tout comme
son centrage sur le CCD !
Réseau de micro-le ntilles vu au
microscope. Doc. Sony.
L’inconvénient de ce système est que lorsque les rayons
incidents possèdent une forte inclinaison, il peut se produire
une diffusion de la lumière entre les pixels : certains de
ces rayons peuvent en effet se réfléchir sur la surface du
réseau de micro-lentilles. Cela se traduit par une baisse de
la netteté de l’image. Ce phénomène est surtout sensible
avec les grands-angles, dans les bords de l’image.
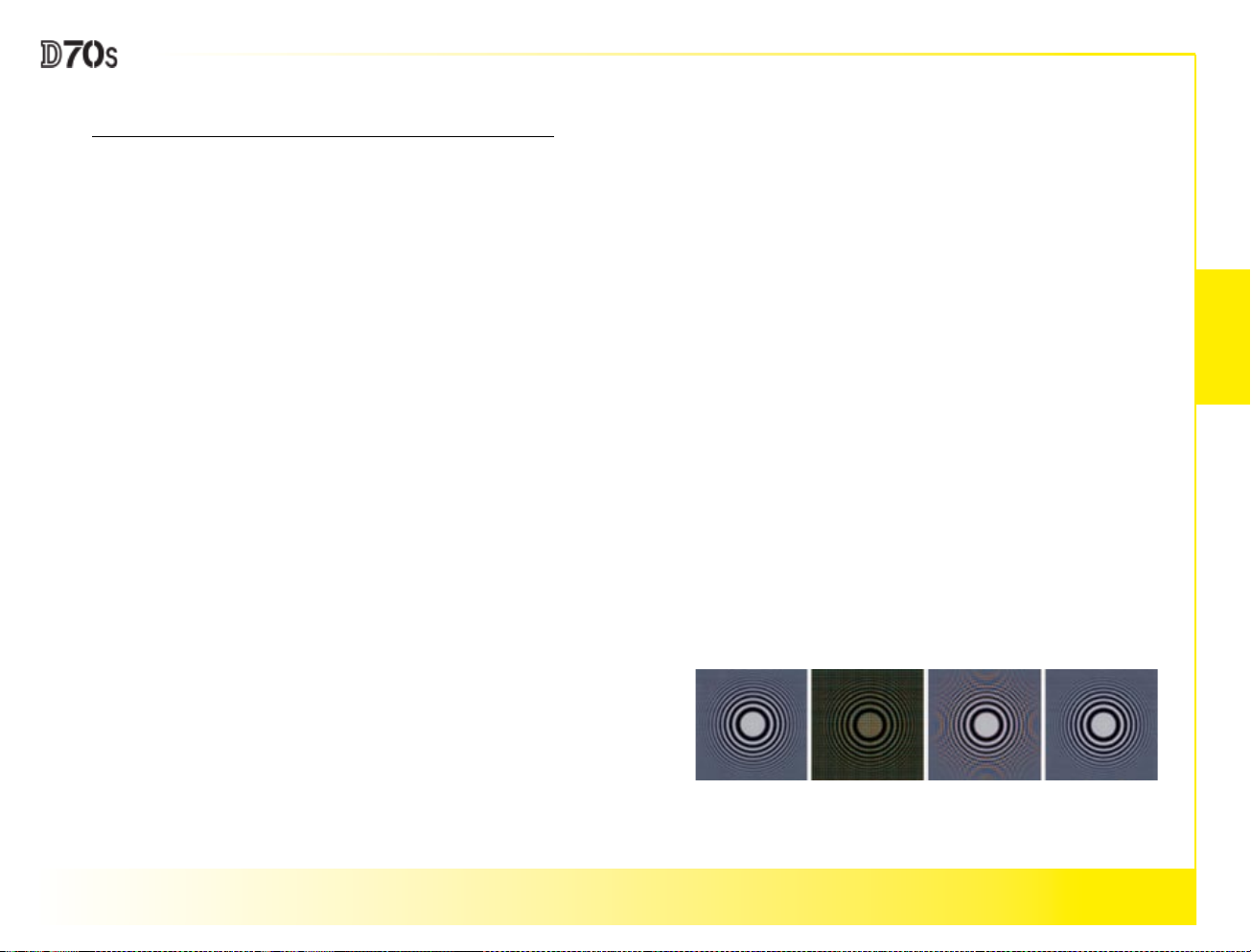
35
Numérique
TRAITEMENT DES DONNÉES
Conversion analogique/numérique
Les charges électriques collectées en sortie de CCD
sont tout d’abord converties en tension (900 millivolts
au maximum pour le CCD du D70s), filtrées et amplifiées
puis transformées en signal numérique au moyen d’un
Convertisseur Analogique/Numérique (CAN). Ce circuit
électronique va transformer les tensions, proportionnelles
à l’intensité lumineuse reçue par les photosites. Le CAN
du D70s fonctionnant sur 12 bits, les valeurs numériques
pourront prendre 212 = 4 096 valeurs. Ainsi, chaque pixel
est affecté d’une valeur, proportionnelle à la quantité de
lumière qu’il a reçue, comprise entre 0 et 4 095. La valeur 0
correspond au noir absolu et 4 095 au blanc pur.
Le Nikon D70s va alors procéder à divers traitements
d’optimisation puis, si l’on a choisi le format d’enregistrement
brut (fichier “RAW” – brut en anglais – avec extension NEF :
Nikon Electronic image Format), sauvegarder le fichier dans
la carte mémoire. Ces fichiers ne sont pas exploitables
directement (ils ne possèdent aucune information colorée
par exemple) par les logiciels classiques de traitement
d’image. Ils nécessitent un logiciel “décodeur” comme Nikon
Capture ou autre, pour post-traiter l’image sur ordinateur.
Si l’on a, en revanche, choisi un format d’enregistrement
JPEG, le D70s va effectuer une séquence de traitements
pour que l’image soit directement exploitable par tout
ordinateur, voire par les imprimantes (impression directe
sur les imprimantes compatibles PictBridge).
Procédé de recomposition
On a vu que les photosites étaient regroupés par quatre :
le D70s dispose ainsi d’une information en rouge, de deux
en vert et d’une en bleu sur la composition de la lumière
qui a atteint chaque quadruplet. Mais il va devoir calculer,
pour chaque pixel de ce quadruplet, les deux informations
colorées qui lui manquent. Pour cela, le Nikon D70s fait appel
à une matrice de 8 pixels de côté pour interpoler chaque
valeur inconnue. La valeur calculée des composantes RVB
de chaque pixel est donc liée aux 63 pixels de son voisinage
immédiat. Schématiquement, le Nikon D70s établit
localement une “cartographie des courbes de niveaux” à
partir des valeurs qu’il connaît et en déduit l’intensité, pour
la couche R, V ou B considérée, du pixel en son centre.
Le D70s va commencer par calculer toutes les composantes
vertes car les données sont deux fois plus nombreuses du
fait de la structure de la matrice de Bayer. L’interpolation
dans cette couche est donc très précise et le Nikon D70s
s’en servira donc comme “référence”. Il est désormais
capable de différentier les zones à fort contraste local
– qui correspondent au contour d’un détail – et celles à
faible gradient (dégradés et aplats). Il peut ainsi affiner son
interpolation pour les couches rouges et bleues en évitant
Le procédé de dématriçage : sujet photographié, fichier brut (avec coloration
factice pour visualiser la matrice de Bayer), fichier dématricé de manière
classique, fichier dématricé avec algorithme Nikon et filtre passe-bas.
Algorithmes de traitement

37
Numérique
Dématriçage
par exemple de “lisser” les valeurs lorsqu’il a détecté un
contour. Ceux-ci seront donc plus nets, sans qu’il y ait
besoin d’augmenter artificiellement l’accentuation en posttraitement.
Le schéma de la page ci-contre explique le fonctionnement
de l’algorithme de dématriçage :
❶ Formation de l’image sur le CCD : chaque photosite
ne perçoit qu’une seule composante (R, V ou B) de la
lumière qu’il reçoit du fait de la présence du filtre de
Bayer.
❷ Séparation des couches R, V et B : le logiciel interne
au D70s dispose de données colorimétriques partielles
pour chaque couche.
❸ Interpolation des pixels absents : dans chaque
couche (rouge, verte et bleue), le D70s va calculer les
données qui lui manque par interpolation à partir des
intensités numériques connues. L’algorithme de recons-
titution est particulièrement complexe et précis (technique bicubique utilisant les informations horizontales,
verticales et colorimétriques).
❹ Reconstitution des couleurs : il ne reste plus au Nikon
D70s qu’à superposer les trois couches “dématricées”
pour recréer l’image. Chaque pixel possède maintenant
trois composantes colorimétriques : R, V et B. L’image
est prête à être traitée puis enregistrée en JPEG.
Ces traitements lourds impliquent évidemment de longs
temps de calcul. Aussi un circuit spécifique leur est-il dédié.
Notons que pour les pixels situés à la périphérie de l’image,
le D70s utilise les valeurs mesurées des pixels actifs mais
non utilisés pour l’image, sur les bords du CCD.
Les dif férentes étapes du procédé de dématriçage Nikon. Le fichier final, dont
les couleurs sont simulées dans le schéma ci-dessus, comporte trois couches
R, V et B. Dans cet exemple, le Nikon D70s va détecter des dégradés da ns les
couches R et V et un aplat dans la couche B.
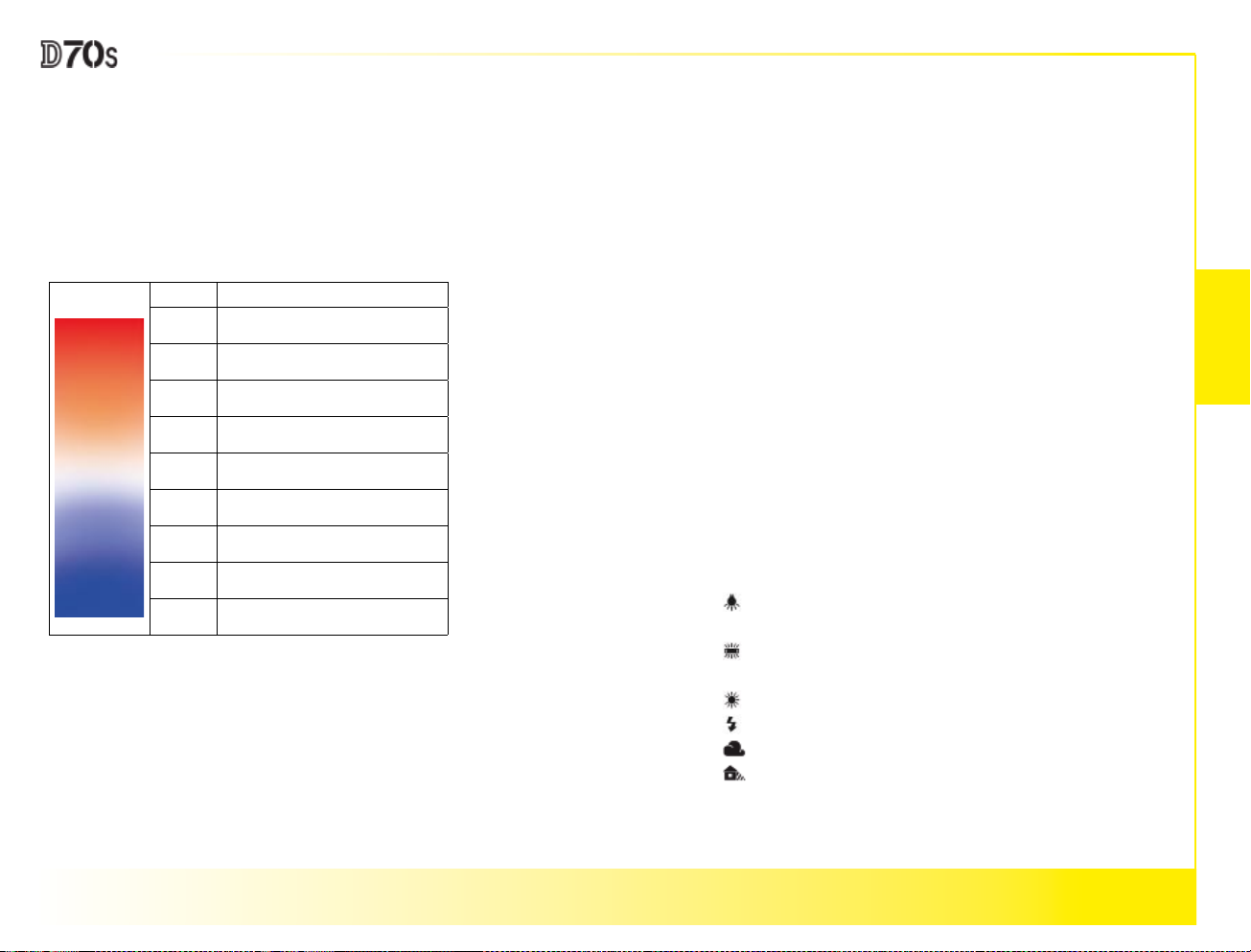
39
Numérique
Le Nikon D70s va alors optimiser les valeurs de ce fichier
“dématricé” pour obtenir la meilleure qualité d’image possible. Tous les traitements décrits ci-après sont paramétrables, via le menu de configuration de l’appareil.
Balance de blancs
On sait que la lumière qui éclaire un sujet varie en qualité :
elle peut
être, par
e xe mp le ,
plus ou
m o i n s
c h a u d e
selon le
moment de
la journée.
Le cerveau
corrigeant
la vision
pour rendre
toute scène
n e u t r e
colorimétriquement, on ne perçoit plus que des légères
dominantes. Mais une surface photosensible reproduit par
contre fidèlement les variations de la couleur de la lumière.
On mesure la couleur de la lumière par sa “température de
couleur” (TC) qui s’exprime en Kelvin (K).
En modifiant les intensités numériques des couches R, V
et B, le D70s peut redonner à chaque image sa neutralité.
Ainsi, pour une photo réalisée à l’ombre (à dominante bleue
puisque la source de lumière est le seul ciel... bleu), le D70s va
baisser le niveau de la couche bleue pour rétablir l’équilibre.
Bien entendu, la dominante de certaines scènes ne doit
psychologiquement pas être corrigée. C’est par exemple le
cas des couchers de soleil qui doivent rester “chauds” !
L’opération de réglage de la neutralité de l’image, appelée
“balance des blancs”, est effectuée automatiquement par le
D70s. Le principe est très simple et assez efficace : il lui suffit de chercher la zone de plus haute lumière dans l’image et
de rendre égales les trois composantes R, V et B de cette
zone (pour obtenir une couleur neutre). La mesure est bien
entendue effectuée par le capteur RVB à 1 005 photosites
qui sert également à la mesure de l’exposition.
Cet algorithme n’est toutefois pas infaillible : il peut être mis
en défaut lorsqu’on photographie un sujet naturellement coloré et il est, de plus, limité à la gamme de TC allant de 3 500
à 8 000 K. On peut heureusement effectuer manuellement
la balance des blancs, en visant une plage neutre. Le D70s
possède également plusieurs types de balance des blancs
pré-programmés pour les éclairages les plus courants :
Lumière incandescente de type ampoule halogène
dont la TC avoisine 3 000 K... quand elle est neuve,
Tubes fluorescents – souvent appelés “néons” (bien
qu’ils n’en soient pas !) – de TC équivalente à 4 200 K,
Soleil, lumière du jour à 5 200 K,
Éclair de flash – légèrement bleuté – à 5 400 K,
Ciel nuageux à 6 000 K,
Ombre à 8 000 K.
La page suivante montre l’effet du choix de ces différentes
balances des blancs en fonction du type de lumière.
TC Source
2 000 K Bougie
2 500 K Éclairage tungstène domestique
3 000 K Coucher de soleil
3 200 K Éclairage halogène
4 200 K Tube fluorescent
5 200 K Lumière solaire moyenne
6 000 K Ciel couvert
8 000 K Ombre
10 000 K Ciel bleu
Température de couleur
 Loading...
Loading...