Page 1

Université Paris I - Panthéon - Sorbonne
U.F.R de Sciences Économiques
Année 2005 Numéro attribué par la bibliothèque
|2|0|0|5|P|A|0|1|0|0|5|2|
Les unions monétaires et leurs effets sur
les échanges et les investissements
internationaux
présentée et soutenue publiquement le 30 novembre 2005 par
Monsieur Gérard
Monsieur Paul
Monsieur Gérard
Monsieur Lionel
Madame Mathilde
Monsieur Thierry
De Grauwe
Thèse de Doctorat ès Sciences Économiques
(arrêté du 30 mars 1992)
Julie LOCHARD
Directeur de recherche :
Duchêne
Fontagné
Maurel
Mayer
Duchêne
Composition du Jury :
(rapporteur), Professeur à l'Université Catholique de Louvain
, Professeur à l'Université Paris XII
, Professeur à l'Université Paris I
, Chargée de recherche CNRS, Université Paris I
(rapporteur), Professeur à l'Université Paris-Sud
, Professeur à l'Université Paris XII
Page 2
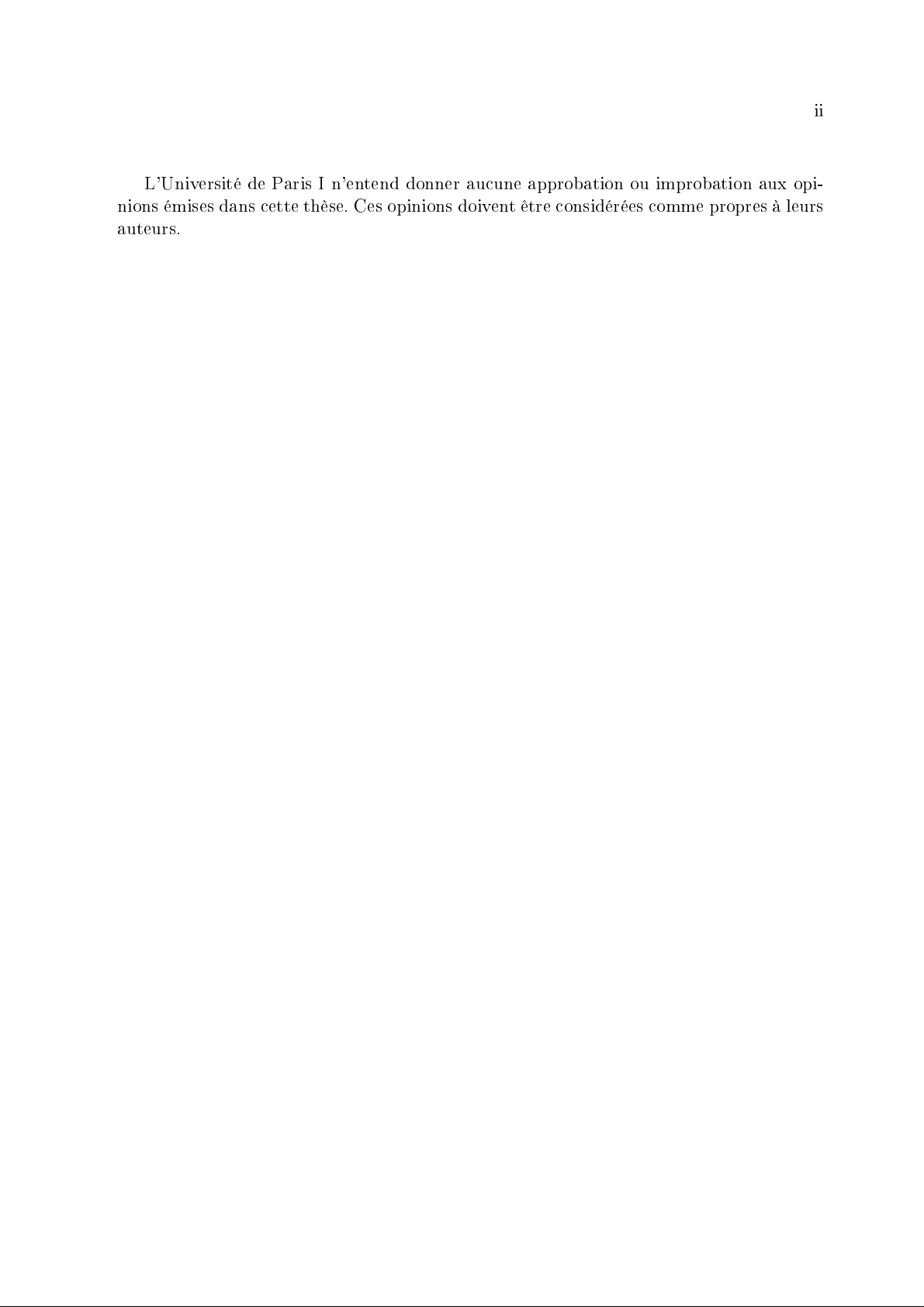
L'Université de Paris I n'entend donner aucune approbation ou improbation aux opi-
nions émises dans cette thèse. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs
auteurs.
ii
Page 3
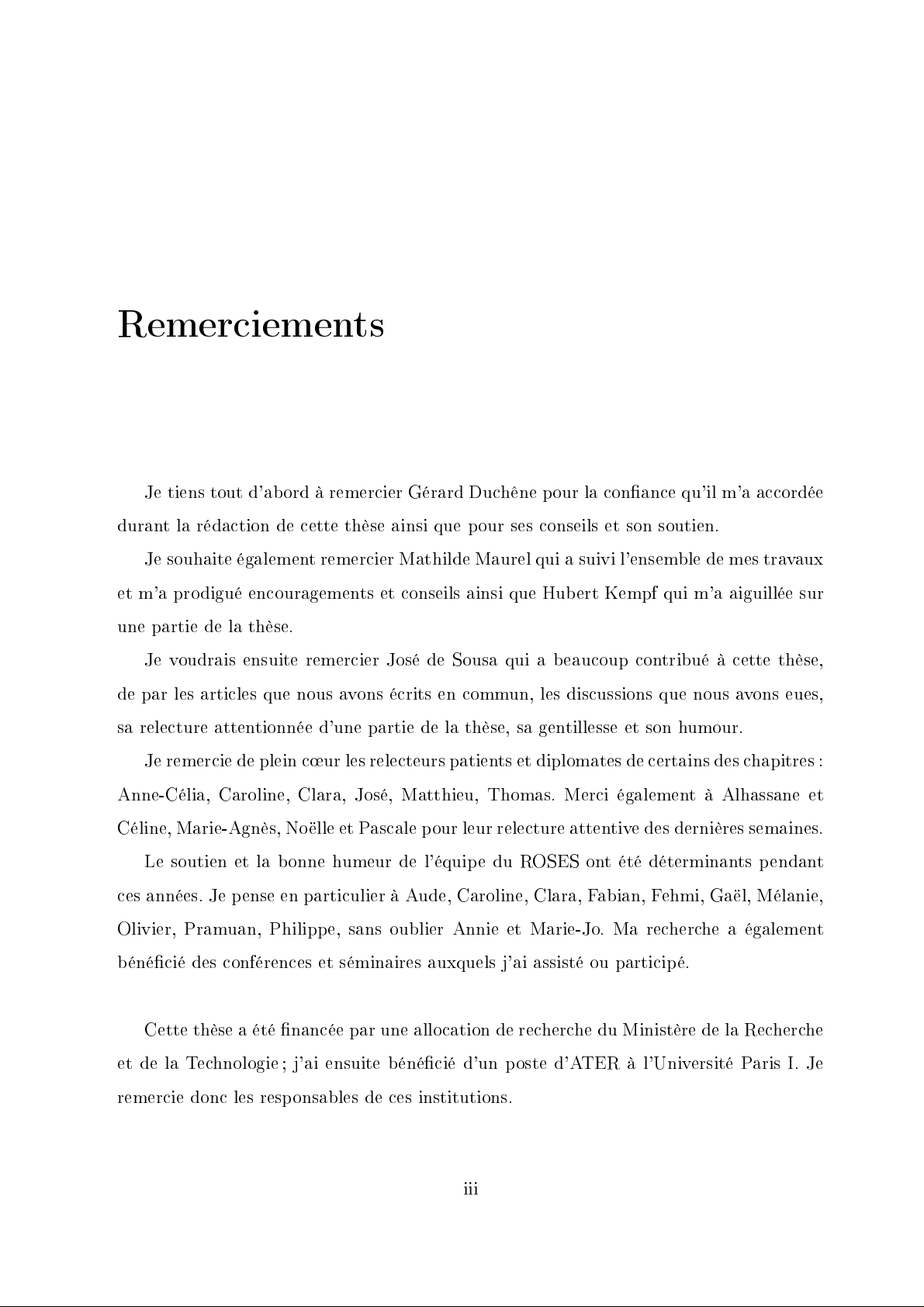
Remerciements
Je tiens tout d'abord à remercier Gérard Duchêne pour la conance qu'il m'a accordée
durant la rédaction de cette thèse ainsi que pour ses conseils et son soutien.
Je souhaite également remercier Mathilde Maurel qui a suivi l'ensemble de mes travaux
et m'a prodigué encouragements et conseils ainsi que Hubert Kempf qui m'a aiguillée sur
une partie de la thèse.
Je voudrais ensuite remercier José de Sousa qui a beaucoup contribué à cette thèse,
de par les articles que nous avons écrits en commun, les discussions que nous avons eues,
sa relecture attentionnée d'une partie de la thèse, sa gentillesse et son humour.
Je remercie de plein c÷ur les relecteurs patients et diplomates de certains des chapitres :
Anne-Célia, Caroline, Clara, José, Matthieu, Thomas. Merci également à Alhassane et
Céline, Marie-Agnès, Noëlle et Pascale pour leur relecture attentive des dernières semaines.
Le soutien et la bonne humeur de l'équipe du ROSES ont été déterminants pendant
ces années. Je pense en particulier à Aude, Caroline, Clara, Fabian, Fehmi, Gaël, Mélanie,
Olivier, Pramuan, Philippe, sans oublier Annie et Marie-Jo. Ma recherche a également
bénécié des conférences et séminaires auxquels j'ai assisté ou participé.
Cette thèse a été nancée par une allocation de recherche du Ministère de la Recherche
et de la Technologie ; j'ai ensuite bénécié d'un poste d'ATER à l'Université Paris I. Je
remercie donc les responsables de ces institutions.
iii
Page 4

Table des matières
Remerciements iii
Introduction générale x
Chapitre préliminaire : l'optimalité et la stabilité de l'union monétaire 1
1.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 La théorie des ZMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2.1 Le c÷ur de la théorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2.2 Les prolongements empiriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3 Le réexamen de la théorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.3.1 Un cadre non unié et trop restrictif . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.3.2 L'endogénéité des critères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.3.3 L'alternative de l'union monétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.4 La stabilité de l'union monétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.4.1 La coordination internationale des politiques . . . . . . . . . . . . . 31
1.4.2 La formation endogène des coalitions . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
1.5 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
1.6 Annexe : la stabilité dans un modèle théorique simple . . . . . . . . . . . . 45
I
Unions monétaires et commerce
Introduction de la première partie 64
iv
63
Page 5
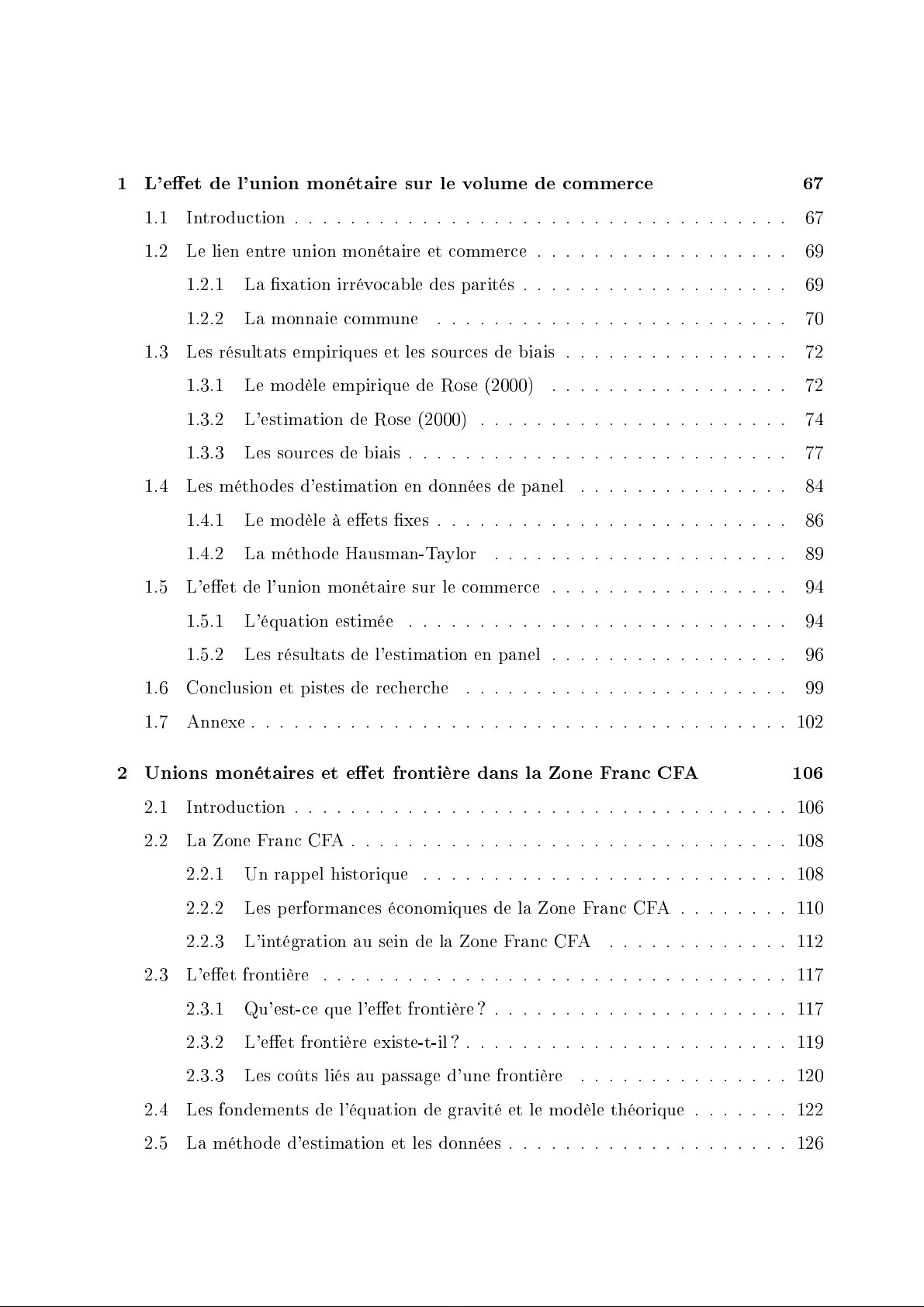
1 L'eet de l'union monétaire sur le volume de commerce 67
1.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
1.2 Le lien entre union monétaire et commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
1.2.1 La xation irrévocable des parités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
1.2.2 La monnaie commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
1.3 Les résultats empiriques et les sources de biais . . . . . . . . . . . . . . . . 72
1.3.1 Le modèle empirique de Rose (2000) . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
1.3.2 L'estimation de Rose (2000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
1.3.3 Les sources de biais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
1.4 Les méthodes d'estimation en données de panel . . . . . . . . . . . . . . . 84
1.4.1 Le modèle à eets xes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
1.4.2 La méthode Hausman-Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
1.5 L'eet de l'union monétaire sur le commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
1.5.1 L'équation estimée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
1.5.2 Les résultats de l'estimation en panel . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
1.6 Conclusion et pistes de recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
1.7 Annexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
2 Unions monétaires et eet frontière dans la Zone Franc CFA 106
2.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
2.2 La Zone Franc CFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
2.2.1 Un rappel historique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
2.2.2 Les performances économiques de la Zone Franc CFA . . . . . . . . 110
2.2.3 L'intégration au sein de la Zone Franc CFA . . . . . . . . . . . . . 112
2.3 L'eet frontière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
2.3.1 Qu'est-ce que l'eet frontière? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
2.3.2 L'eet frontière existe-t-il ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
2.3.3 Les coûts liés au passage d'une frontière . . . . . . . . . . . . . . . 120
2.4 Les fondements de l'équation de gravité et le modèle théorique . . . . . . . 122
2.5 La méthode d'estimation et les données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Page 6
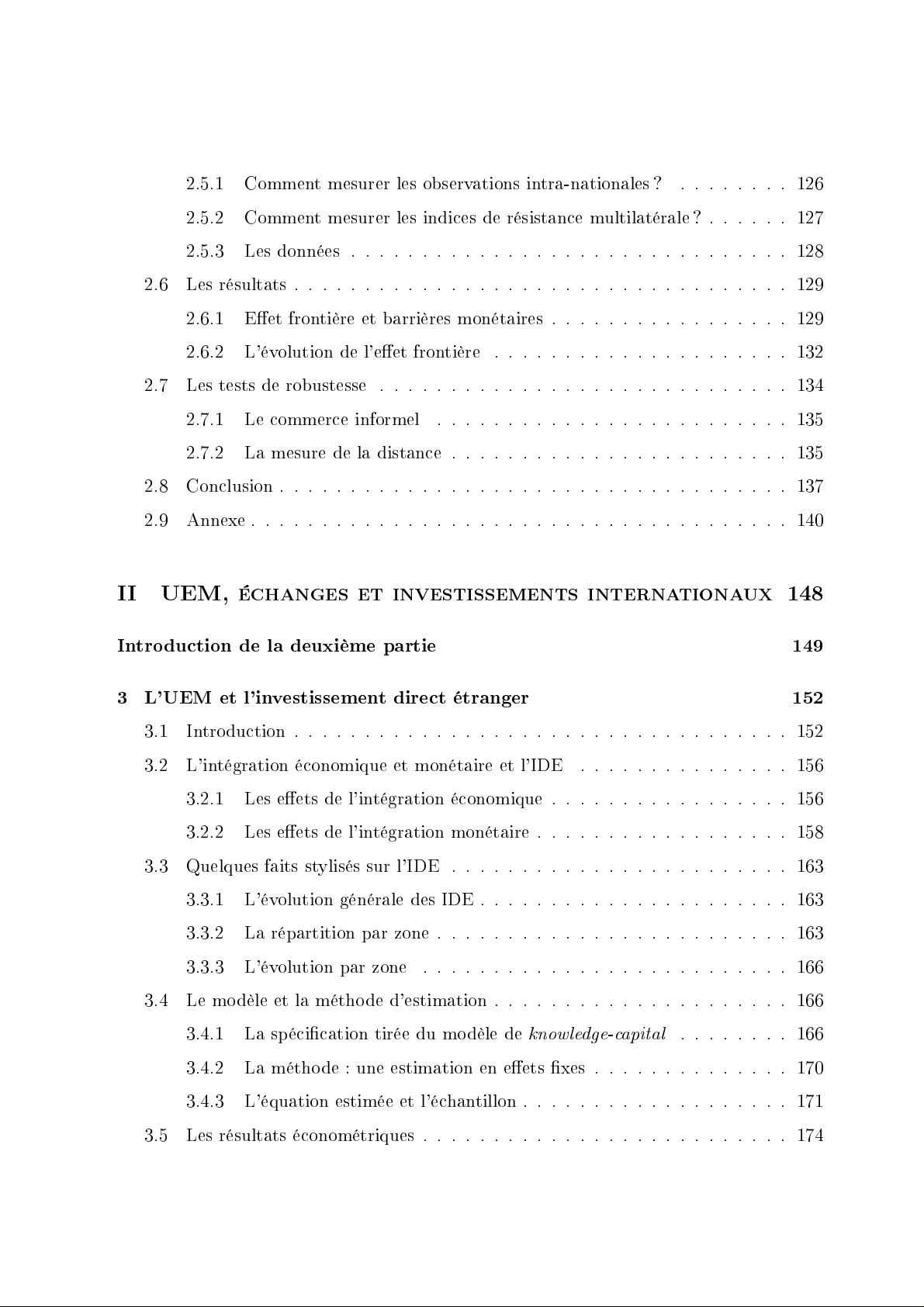
2.5.1 Comment mesurer les observations intra-nationales? . . . . . . . . 126
2.5.2 Comment mesurer les indices de résistance multilatérale? . . . . . . 127
2.5.3 Les données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
2.6 Les résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
2.6.1 Eet frontière et barrières monétaires . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
2.6.2 L'évolution de l'eet frontière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
2.7 Les tests de robustesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
2.7.1 Le commerce informel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
2.7.2 La mesure de la distance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
2.8 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
2.9 Annexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
II
UEM, échanges et investissements internationaux
148
Introduction de la deuxième partie 149
3 L'UEM et l'investissement direct étranger 152
3.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
3.2 L'intégration économique et monétaire et l'IDE . . . . . . . . . . . . . . . 156
3.2.1 Les eets de l'intégration économique . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
3.2.2 Les eets de l'intégration monétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
3.3 Quelques faits stylisés sur l'IDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
3.3.1 L'évolution générale des IDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
3.3.2 La répartition par zone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
3.3.3 L'évolution par zone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
3.4 Le modèle et la méthode d'estimation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
3.4.1 La spécication tirée du modèle de
3.4.2 La méthode : une estimation en eets xes . . . . . . . . . . . . . . 170
knowledge-capital
. . . . . . . . 166
3.4.3 L'équation estimée et l'échantillon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
3.5 Les résultats économétriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Page 7

3.5.1 L'eet de l'UEM sur l'IDE intra-zone . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
3.5.2 L'eet de l'UEM sur les relations extra-zone et pour les pays de l'UE
non-membres de la zone euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
3.6 Les tests de robustesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
3.6.1 Une spécication alternative : l'équation de gravité . . . . . . . . . 183
3.6.2 Les tests de sensibilité sur l'échantillon . . . . . . . . . . . . . . . . 189
3.7 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
3.8 Annexe statistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
4 L'eet indirect de l'UEM sur le commerce 198
4.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
4.2 Un lien indirect entre union monétaire et commerce . . . . . . . . . . . . . 200
4.2.1 L'eet de l'UEM sur le commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
4.2.2 L'eet de l'UEM sur l'IDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
4.2.3 Les liens entre commerce et IDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
4.3 Le modèle empirique et l'échantillon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
4.4 Les résultats économétriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
4.4.1 L'estimation en coupe transversale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
4.4.2 L'estimation en panel avec la méthode des variables instrumentales 214
4.4.3 Les relations entre les pays membres et les pays non-membres . . . 223
4.5 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
4.6 Annexe statistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Conclusion générale 230
Bibliographie 237
A Les unions monétaires dans le monde : un état des lieux 1
A.1 Les unions monétaires passées, présentes ou en projet . . . . . . . . . . . . 1
A.2 La naissance de l'Union économique et monétaire . . . . . . . . . . . . . . 3
A.3 Les unions monétaires unilatérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Page 8
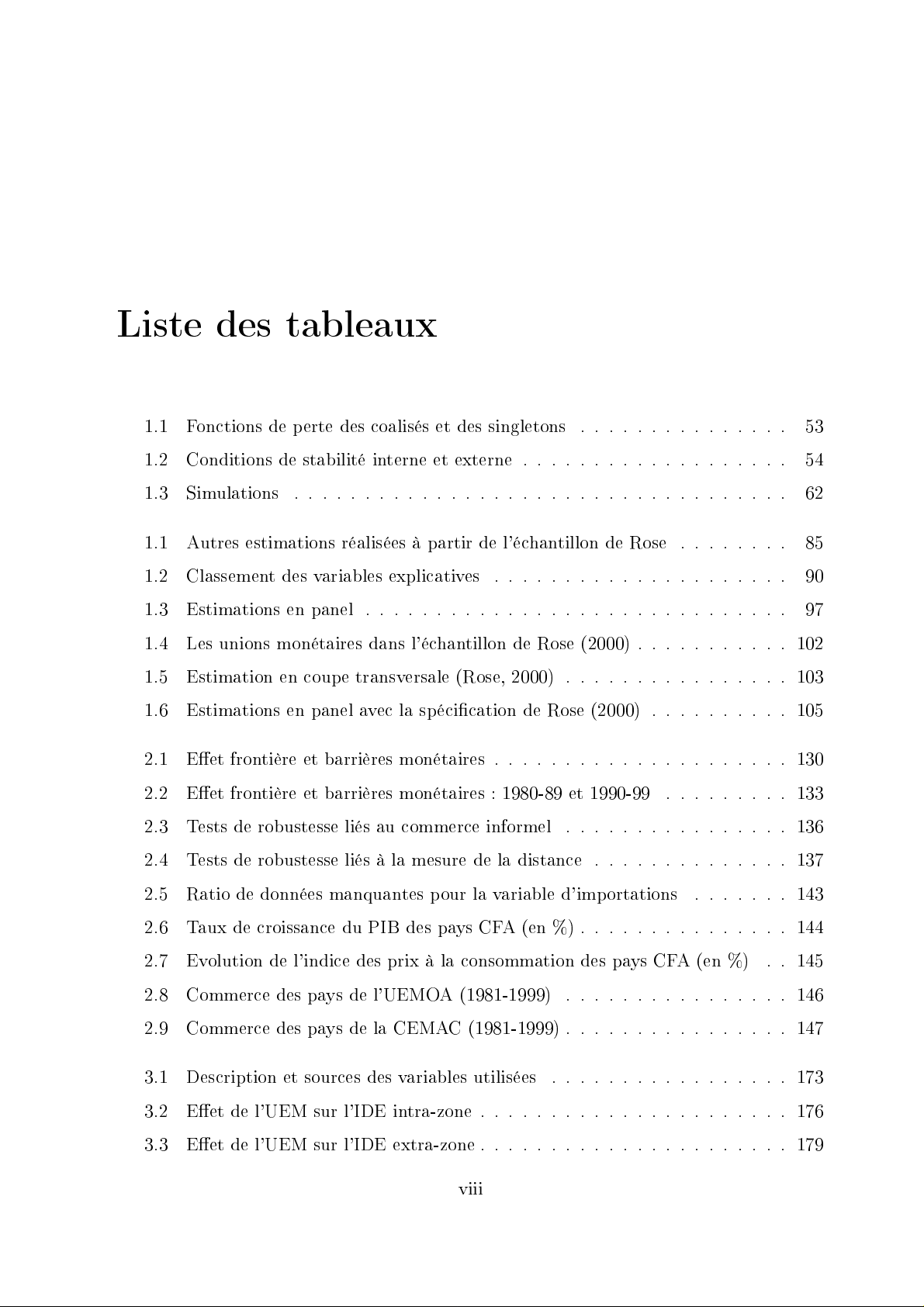
Liste des tableaux
1.1 Fonctions de perte des coalisés et des singletons . . . . . . . . . . . . . . . 53
1.2 Conditions de stabilité interne et externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
1.3 Simulations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
1.1 Autres estimations réalisées à partir de l'échantillon de Rose . . . . . . . . 85
1.2 Classement des variables explicatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
1.3 Estimations en panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
1.4 Les unions monétaires dans l'échantillon de Rose (2000) . . . . . . . . . . . 102
1.5 Estimation en coupe transversale (Rose, 2000) . . . . . . . . . . . . . . . . 103
1.6 Estimations en panel avec la spécication de Rose (2000) . . . . . . . . . . 105
2.1 Eet frontière et barrières monétaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
2.2 Eet frontière et barrières monétaires : 1980-89 et 1990-99 . . . . . . . . . 133
2.3 Tests de robustesse liés au commerce informel . . . . . . . . . . . . . . . . 136
2.4 Tests de robustesse liés à la mesure de la distance . . . . . . . . . . . . . . 137
2.5 Ratio de données manquantes pour la variable d'importations . . . . . . . 143
2.6 Taux de croissance du PIB des pays CFA (en %) . . . . . . . . . . . . . . . 144
2.7 Evolution de l'indice des prix à la consommation des pays CFA (en %) . . 145
2.8 Commerce des pays de l'UEMOA (1981-1999) . . . . . . . . . . . . . . . . 146
2.9 Commerce des pays de la CEMAC (1981-1999) . . . . . . . . . . . . . . . . 147
3.1 Description et sources des variables utilisées . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
3.2 Eet de l'UEM sur l'IDE intra-zone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
3.3 Eet de l'UEM sur l'IDE extra-zone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
viii
Page 9

3.4 Description et sources des variables de gravité . . . . . . . . . . . . . . . . 186
3.5 Robustesse relative à la spécication : l'équation de gravité . . . . . . . . . 188
3.6 Eet de l'UEM sur l'IDE extra-zone (équation de gravité) . . . . . . . . . 190
3.7 Tests de robustesse relatifs à l'échantillon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
3.8 Statistiques descriptives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
3.9 Indices de centralité (2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
3.10 Ratio de données manquantes pour les stocks et les ux d'IDE . . . . . . . 197
4.1 Littérature empirique relative à l'eet de l'UEM sur le commerce . . . . . 202
4.2 Eet de l'UEM sur le commerce et l'IDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
4.3 Description et sources des variables utilisées . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
4.4 Eet indirect de l'UEM sur le commerce (MCO) . . . . . . . . . . . . . . . 212
4.5 Première étape : UEM et IDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
4.6 Seconde étape : UEM et commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
4.7 Estimation en eets xes avec la méthode des moments généralisés . . . . . 224
4.8 Eet de l'UEM sur l'IDE extra-zone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
4.9 Eet de l'UEM sur le commerce extra-zone . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
4.10 Statistiques descriptives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
4.11 Matrice des coecients de corrélation des variables explicatives . . . . . . . 229
Page 10
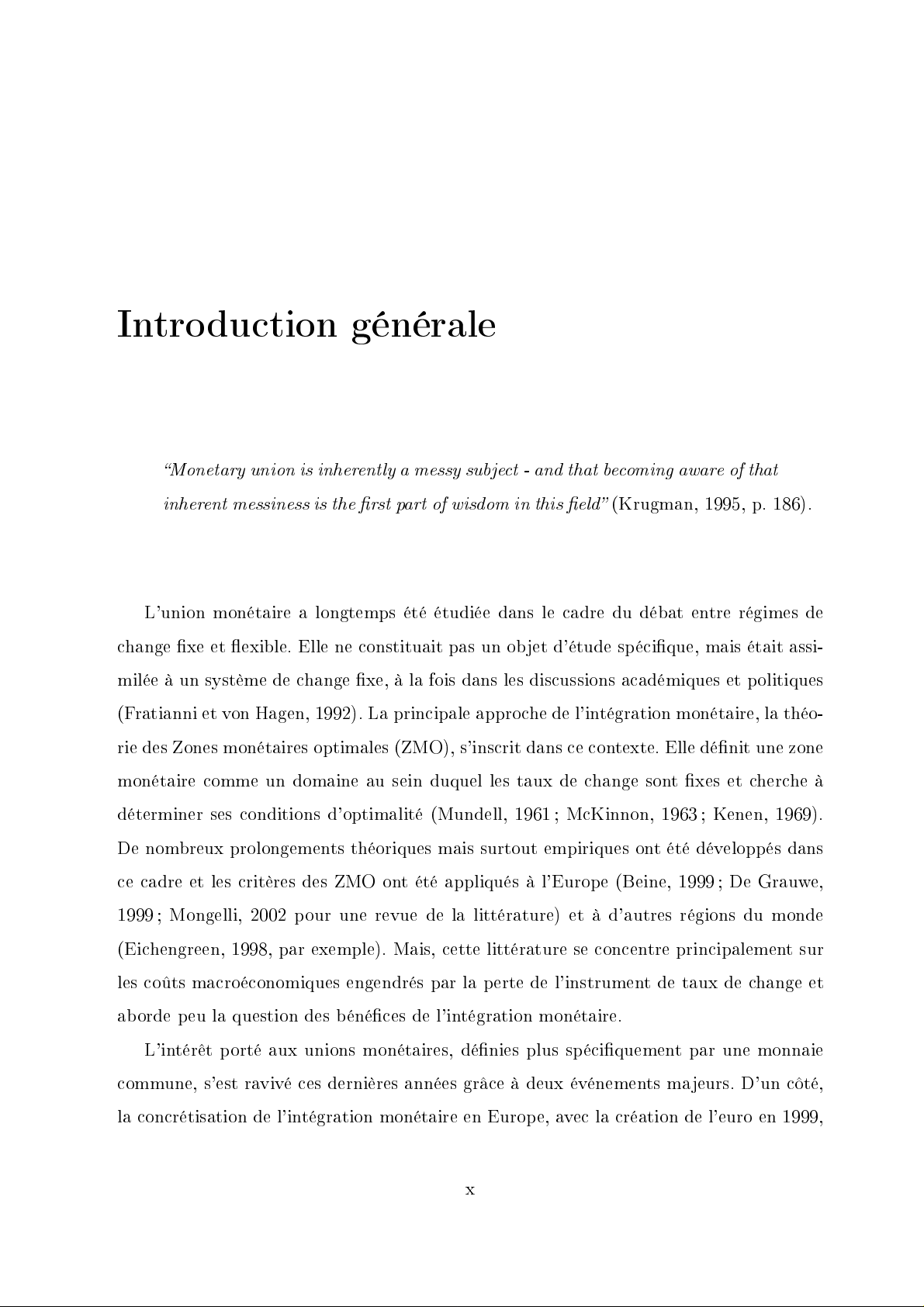
Introduction générale
Monetary union is inherently a messy subject - and that becoming aware of that
inherent messiness is the rst part of wisdom in this eld
L'union monétaire a longtemps été étudiée dans le cadre du débat entre régimes de
change xe et exible. Elle ne constituait pas un objet d'étude spécique, mais était assi-
milée à un système de change xe, à la fois dans les discussions académiques et politiques
(Fratianni et von Hagen, 1992). La principale approche de l'intégration monétaire, la théo-
rie des Zones monétaires optimales (ZMO), s'inscrit dans ce contexte. Elle dénit une zone
monétaire comme un domaine au sein duquel les taux de change sont xes et cherche à
déterminer ses conditions d'optimalité (Mundell, 1961 ; McKinnon, 1963 ; Kenen, 1969).
De nombreux prolongements théoriques mais surtout empiriques ont été développés dans
ce cadre et les critères des ZMO ont été appliqués à l'Europe (Beine, 1999 ; De Grauwe,
1999 ; Mongelli, 2002 pour une revue de la littérature) et à d'autres régions du monde
(Eichengreen, 1998, par exemple). Mais, cette littérature se concentre principalement sur
(Krugman, 1995, p. 186).
les coûts macroéconomiques engendrés par la perte de l'instrument de taux de change et
aborde peu la question des bénéces de l'intégration monétaire.
L'intérêt porté aux unions monétaires, dénies plus spéciquement par une monnaie
commune, s'est ravivé ces dernières années grâce à deux événements majeurs. D'un côté,
la concrétisation de l'intégration monétaire en Europe, avec la création de l'euro en 1999,
x
Page 11

INTRODUCTION GÉNÉRALE
a montré que la constitution d'une union monétaire était réalisable alors que la théorie
des ZMO était assez pessimiste sur les chances de succès d'une telle union. La création
de l'Union économique et monétaire (UEM) représente un enjeu majeur, non seulement
pour les pays membres, mais aussi pour les pays d'Europe centrale et orientale (PECO)
qui pourraient la rejoindre prochainement et pour les pays non-membres, principaux par-
tenaires de l'union. D'un autre côté, les crises nancières qui se sont multipliées dans
les années 19901ont conduit de nombreux économistes à défendre les régimes de change
extrêmes, tels que la caisse d'émission (
currency board
) ou l'union monétaire (dollarisa-
tion), considérés comme étant les seuls viables avec le système de change exible (voir par
exemple Obstfeld et Rogo, 1995a ; Eichengreen, 1998 ; Fischer, 2001).
Ces deux événements ont contribué à stimuler et à élargir les débats dans le domaine
de la recherche académique, à la fois en limitant la portée de la théorie des ZMO et en
ouvrant de nouvelles pistes de recherche. L'expérience européenne procure de nouvelles
données permettant d'analyser empiriquement les eets de l'union monétaire, et non plus
seulement ses conditions d'optimalité. Elle pourrait montrer que les critères mis en avant
par la théorie des ZMO sont endogènes; l'union monétaire serait viable
ne l'est pas
ex ante
. Par ailleurs, la littérature sur les crises de change tend à réhabiliter
ex post
même si elle
l'union monétaire par rapport aux régimes de change xe traditionnels. La théorie des
ZMO pourrait également surestimer le rôle du taux de change dans l'ajustement aux chocs
et par conséquent le principal coût de l'union monétaire. Des travaux récents montrent
ainsi que le taux de change est peu utilisé comme instrument d'ajustement dans les pays
émergents ou en développement par peur du ottement (Calvo et Reinhart, 2002).
Ces événements font référence à deux types d'unions monétaires qu'il convient de dis-
tinguer : les unions monétaires
multilatéralesetunilatérales
. Dans les deux cas, il y a un
abandon de la monnaie nationale au prot d'une monnaie commune (ce qui constitue la
dénition généralement admise de l'union monétaire). Mais dans le cas de l'union moné-
taire multilatérale, la souveraineté monétaire est partagée entre les membres de l'union,
alors que dans une union monétaire unilatérale (dollarisation ou euroisation), elle est
1
On peut citer en particulier la crise du Système monétaire européen en 1992-1993, la crise mexicaine
en 1994-1995, asiatique en 1997-1998, russe en 1998 et brésilienne en 1999.
xi
Page 12
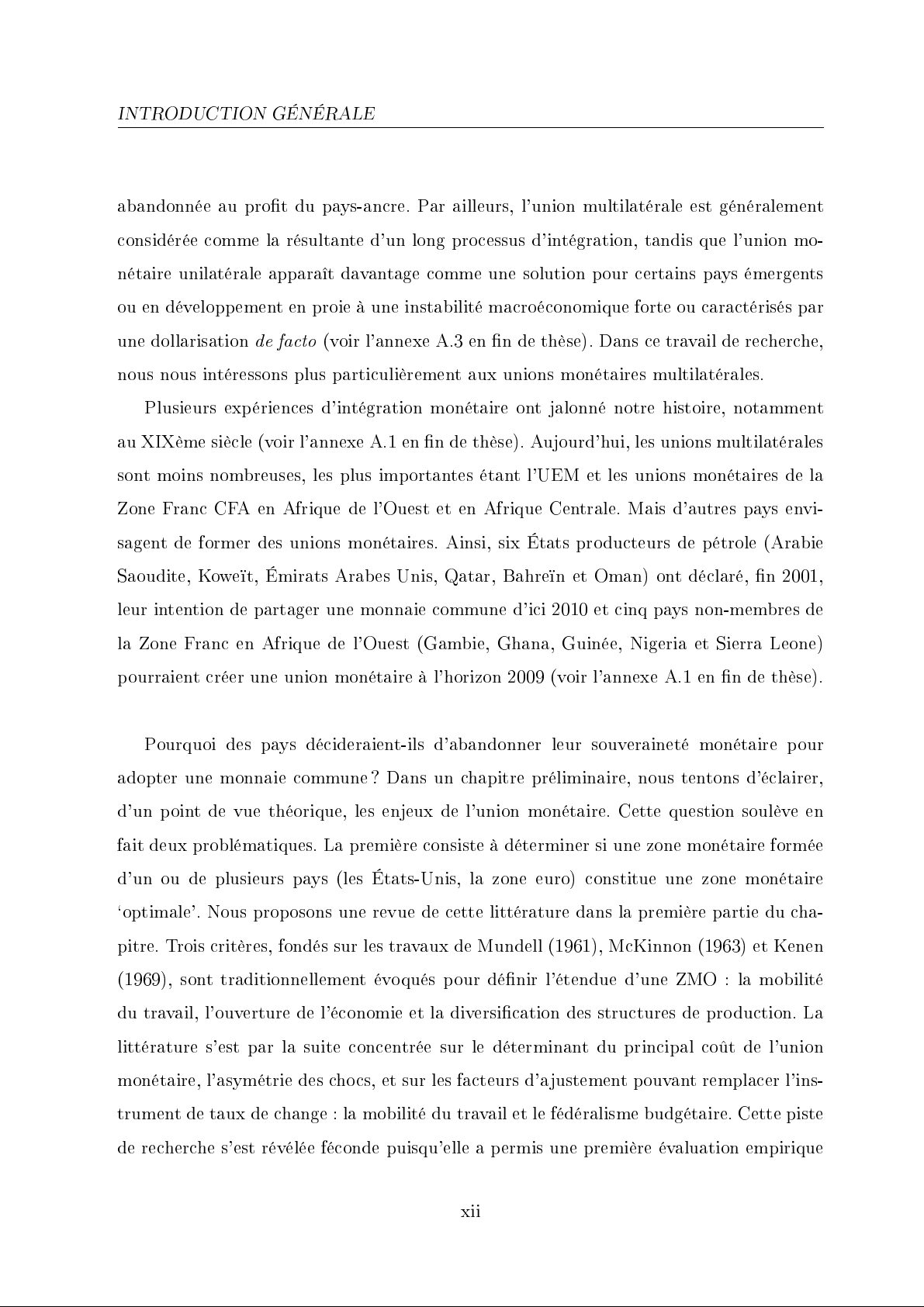
INTRODUCTION GÉNÉRALE
abandonnée au prot du pays-ancre. Par ailleurs, l'union multilatérale est généralement
considérée comme la résultante d'un long processus d'intégration, tandis que l'union mo-
nétaire unilatérale apparaît davantage comme une solution pour certains pays émergents
ou en développement en proie à une instabilité macroéconomique forte ou caractérisés par
une dollarisation
nous nous intéressons plus particulièrement aux unions monétaires multilatérales.
Plusieurs expériences d'intégration monétaire ont jalonné notre histoire, notamment
au XIXème siècle (voir l'annexe A.1 en n de thèse). Aujourd'hui, les unions multilatérales
sont moins nombreuses, les plus importantes étant l'UEM et les unions monétaires de la
Zone Franc CFA en Afrique de l'Ouest et en Afrique Centrale. Mais d'autres pays envi-
sagent de former des unions monétaires. Ainsi, six États producteurs de pétrole (Arabie
Saoudite, Koweït, Émirats Arabes Unis, Qatar, Bahreïn et Oman) ont déclaré, n 2001,
leur intention de partager une monnaie commune d'ici 2010 et cinq pays non-membres de
la Zone Franc en Afrique de l'Ouest (Gambie, Ghana, Guinée, Nigeria et Sierra Leone)
pourraient créer une union monétaire à l'horizon 2009 (voir l'annexe A.1 en n de thèse).
Pourquoi des pays décideraient-ils d'abandonner leur souveraineté monétaire pour
adopter une monnaie commune? Dans un chapitre préliminaire, nous tentons d'éclairer,
de facto
(voir l'annexe A.3 en n de thèse). Dans ce travail de recherche,
d'un point de vue théorique, les enjeux de l'union monétaire. Cette question soulève en
fait deux problématiques. La première consiste à déterminer si une zone monétaire formée
d'un ou de plusieurs pays (les États-Unis, la zone euro) constitue une zone monétaire
`optimale'. Nous proposons une revue de cette littérature dans la première partie du cha-
pitre. Trois critères, fondés sur les travaux de Mundell (1961), McKinnon (1963) et Kenen
(1969), sont traditionnellement évoqués pour dénir l'étendue d'une ZMO : la mobilité
du travail, l'ouverture de l'économie et la diversication des structures de production. La
littérature s'est par la suite concentrée sur le déterminant du principal coût de l'union
monétaire, l'asymétrie des chocs, et sur les facteurs d'ajustement pouvant remplacer l'ins-
trument de taux de change : la mobilité du travail et le fédéralisme budgétaire. Cette piste
de recherche s'est révélée féconde puisqu'elle a permis une première évaluation empirique
xii
Page 13

INTRODUCTION GÉNÉRALE
de la désirabilité d'une union monétaire dans diérentes régions du monde. Mais elle a
aussi montré ses limites, notamment parce qu'elle s'est concentrée sur les coûts de l'union
monétaire (Kenen, 2003c) et a négligé la dimension dynamique et plusieurs questions im-
portantes, liées aux interdépendances entre l'union monétaire et ses partenaires extérieurs
(Ricci, 1997).
La seconde problématique consiste à déterminer si un pays a, ou non, intérêt à inté-
grer une union monétaire existante. Cette question a trait à l'élargissement optimal de la
zone monétaire (
renvoie plus généralement à l'étude de la stabilité des unions monétaires. Le cadre d'ana-
lyse retenu pour étudier cette question est la théorie de la formation des coalitions. Cette
littérature examine la formation endogène des coalitions en dénissant des conditions de
stabilité à partir de concepts empruntés à la théorie des cartels. La première condition - la
stabilité interne - stipule que les pays membres de la coalition n'ont pas intérêt à en sortir,
tandis que la seconde - la stabilité externe - assure que les pays non-membres n'ont pas
intérêt à y entrer. Ce cadre théorique permet de montrer que la formation d'une union mo-
nétaire peut exercer des externalités positives sur les pays non-membres, engendrant alors
des comportements de passagers clandestins susceptibles de remettre en cause la stabilité
de l'union monétaire. Dans l'annexe de ce chapitre, nous appliquons ce cadre d'analyse
au modèle de Martin (1996) que nous étendons à quatre pays identiques an d'étudier
plus précisément le cas où il existe une union monétaire et plusieurs pays non-membres.
Ce modèle semble plus pertinent que les modèles traditionnels de coordination de la poli-
the optimum enlargement of the currency area
, Mélitz, 1995, p. 496) et
tique monétaire (Canzoneri et Henderson, 1991 ; Kohler, 2002) dans la mesure où il intègre
les problèmes de crédibilité qui paraissent déterminants pour les motifs de formation des
unions monétaires (Gros et Thygesen, 1998). Il apparaît alors que lorsque les
sont plus nombreux, les bénéces qu'ils tirent d'une politique contre-cyclique se réduisent
et ils peuvent être incités à rejoindre l'union monétaire ou à former une seconde union
monétaire suivant l'importance relative du biais inationniste et de la variance des chocs.
Ces approches permettent de mieux comprendre certains des enjeux de l'union moné-
xiii
outsiders
Page 14

INTRODUCTION GÉNÉRALE
taire, mais elles révèlent également que ses coûts et bénéces sont diciles à prendre en
compte conjointement. Dans la suite de la thèse, nous étudions les unions monétaires à
travers leurs
Dans le
monétaire sur le commerce, résumons les principaux problèmes méthodologiques qui se
posent et proposons une méthode d'estimation appropriée. Cette littérature est marquée
par la contribution d'Andrew Rose (2000) qui évalue empiriquement, pour la première fois,
l'impact global de l'union monétaire sur le commerce. En s'appuyant sur une équation de
gravité et un échantillon de plus de 180 pays, il montre que deux pays qui partagent une
monnaie commercent en moyenne trois fois plus que des pays avec des monnaies dié-
rentes, toutes choses égales par ailleurs. De plus, l'élimination de la volatilité du taux de
change aurait un eet bien moindre sur le commerce, ce qui implique que l'on ne pourrait
plus assimiler les unions monétaires aux régimes de change xe, comme on l'a fait gé-
néralement par le passé. Ces résultats sont contestés, notamment du fait de l'échantillon
très hétérogène qui comprend diérents types d'unions monétaires souvent unilatérales,
eets sur le commerce et l'investissement direct étranger
chapitre 1
, nous présentons la littérature empirique relative à l'eet de l'union
.
regroupant, qui plus est, des pays généralement petits et pauvres (Levy Yeyati, 2003; Pers-
son, 2001 ; Nitsch, 2002). Les spécicités en grande partie inobservables qui caractérisent
ces unions monétaires peuvent alors créer un biais d'endogénéité et conduire à suresti-
mer l'eet de l'union monétaire si elles sont corrélées positivement au commerce. Pour
remédier à ce biais, deux méthodes sont utilisées : le modèle à eets xes et la méthode
proposée par Hausman et Taylor (1981). Cette dernière se rapproche d'une méthode des
variables instrumentales mais elle a l'avantage d'utiliser des instruments internes, c'est-à-
dire directement extraits de l'ensemble des variables explicatives. Elle ne pose donc pas les
problèmes habituels de dénition d'instruments pertinents extérieurs au modèle, d'autant
plus importants dans ce cas qu'il n'existe pas réellement de consensus sur les déterminants
de l'union monétaire. Par ailleurs, elle est plus eciente que le modèle à eets xes dans
la mesure où elle prend en compte la dimension en coupe transversale des données. L'ap-
plication de cette méthode sur l'échantillon de Rose (2000) ne permet pas de mettre en
xiv
Page 15

INTRODUCTION GÉNÉRALE
évidence un surcroît de commerce lié à l'existence d'une monnaie commune.
Dans le
Zone Franc CFA en Afrique sub-saharienne) et étudions le rôle de l'union monétaire dans
la réduction des obstacles au commerce. Le choix de cette zone se justie pour plusieurs
raisons. Tout d'abord, celle-ci comprend deux unions monétaires (l'UEMOA et la CE-
MAC) et constitue l'une des principales et des plus anciennes expériences d'intégration
monétaire multilatérale existant à l'heure actuelle. Ensuite, l'eet de la monnaie com-
mune est plus aisément dissociable de l'intégration économique car les unions monétaires
ont précédé la mise en place d'une union douanière et d'un marché commun. La métho-
dologie de `l'eet frontière' qui est utilisée permet d'évaluer le niveau d'intégration au
sein d'une zone en le comparant au niveau d'intégration qui existe à l'intérieur d'un pays
(représentant
1996 ; Helliwell, 1998). Elle présente un intérêt majeur pour analyser les eets de l'union
monétaire, puisqu'elle donne une mesure directe de l'ensemble des obstacles aux échanges
et permet donc d'estimer le poids relatif des barrières monétaires. D'autres déterminants
chapitre 2
a priori
, nous nous intéressons à une zone géographique en particulier (la
l'espace le plus intégré) (voir par exemple McCallum, 1995 ; Wei,
de l'eet frontière ont été évalués empiriquement, comme les réseaux sociaux et réseaux
d'aaires (Combes, Lafourcade et Mayer, 2004) ou les diérences de cadre juridique (De
Sousa et Disdier, 2006), mais le lien entre eet frontière et union monétaire n'a jamais
été testé formellement. Dans ce chapitre, nous construisons un modèle théorique simple,
fondé sur les travaux d'Anderson et van Wincoop (2003), qui introduit, en plus des coûts
de transaction traditionnels, une nouvelle barrière aux échanges liée à l'existence de mon-
naies diérentes. Ce modèle nous permet de dériver une équation de gravité qui peut être
directement estimée. Nous montrons alors que l'eet frontière reste élevé même au sein
des unions monétaires régionales et que les barrières monétaires représentent entre 17% et
28% de l'ensemble des obstacles au commerce. L'eet frontière pourrait donc être princi-
palement le résultat de barrières non monétaires au commerce : barrières tarifaires et non
tarifaires, absence d'infrastructures ou instabilité politique par exemple. Les résultats de
ce chapitre ont fait l'objet d'un article co-écrit avec José de Sousa et publié dans
Review
xv
Page 16

INTRODUCTION GÉNÉRALE
of World Economics/Weltwirtschaftliches Archiv
La
partie 2
monétaire sur les investissements directs étrangers (IDE) et les ux de commerce. L'impact
de l'UEM sur le commerce fait désormais l'objet d'une littérature empirique relativement
importante (voir par exemple Flam et Nordström, 2003 ; Micco, Stein et Ordoñez, 2003)
mais son inuence sur l'IDE reste peu explorée. Dans cette partie, nous nous intéressons
aux conséquences de la formation de cette union monétaire pour les pays membres, mais
aussi pour les pays non-membres, et en particulier pour les pays de l'Union européenne
(UE) qui participent au Marché unique tout en conservant leur souveraineté monétaire.
Dans le
cruciaux du débat sur les avantages et les coûts de l'union monétaire dans certains pays
européens non-membres de l'union monétaire porte sur la localisation des investissements
est consacrée plus particulièrement à l'UEM et porte sur les eets de l'union
chapitre 3
, nous étudions l'impact de l'UEM sur l'IDE. L'un des aspects
.
directs étrangers. Au Royaume-Uni en particulier, d'aucuns insistent sur le risque que les
investisseurs étrangers délaissent ce pays au prot de la zone euro, alors que tradition-
nellement il est celui qui attire le plus d'IDE en Europe (HM Treasury, 2003c). On peut
dès lors se demander dans quelle mesure la mise en place de l'union monétaire incite les
investisseurs à s'implanter dans les pays membres, éventuellement au détriment des pays
tiers. Pour comprendre l'inuence de l'union monétaire, il convient de distinguer les IDE
intra-zone (entre pays membres) et extra-zone (des pays membres dans les pays tiers ou
des pays tiers au sein de l'union monétaire). Dans le premier cas, la mise en place d'une
monnaie commune élimine certains coûts que doivent supporter les rmes qui s'implantent
dans la zone (coûts de conversion liés aux ux de commerce inhérents à l'IDE ou au ra-
patriement des prots par exemple) et, plus généralement, réduit l'incertitude portant
sur la situation macroéconomique ainsi que sur les règles et politiques adoptées. Mais elle
peut également, en diminuant le coût des échanges commerciaux, favoriser le commerce
au détriment de l'IDE si l'objectif des rmes est de vendre sur le marché local. L'impact
de l'union monétaire sur l'IDE extra-zone est également indéterminé
xvi
a priori
.
Page 17

INTRODUCTION GÉNÉRALE
Pour étudier ces questions, nous recourons à la spécication empirique élaborée par
Carr, Markusen et Maskus (2001) à partir du modèle théorique de
knowledge capital
qui permet de prendre en compte les principaux déterminants de l'IDE. En utilisant une
méthode d'estimation en panel à eets xes an de limiter le risque de biais d'endogénéité
lié à la variable d'union monétaire, nous montrons que l'UEM a pour eet d'accroître les
IDE au sein de la zone euro et que ces investissements supplémentaires ne sont pas réalisés
au détriment des pays tiers (le Royaume-Uni, le Danemark et la Suède en particulier). Par
contre, les investisseurs de pays tiers seraient sensibles à l'intégration économique, mais ne
paraissent pas privilégier les pays de la zone euro au détriment des autres pays. Enn, nos
résultats corroborent l'observation statistique montrant que le Royaume-Uni attire moins
de ux d'IDE depuis le lancement de l'UEM. Ces conclusions sont robustes à des tests
de sensibilité sur l'échantillon et à l'utilisation d'une spécication empirique alternative
fondée sur l'équation de gravité.
Dans le
chapitre 4
, nous relions les thèmes abordés dans les chapitres précédents et
proposons une explication originale de l'impact de l'union monétaire sur le commerce.
Les arguments, déjà évoqués dans le chapitre 1, qui sont traditionnellement avancés dans
la littérature pour rendre compte de cet eet (réduction des coûts de transaction et de
l'incertitude liée au taux de change) ne semblent pas réellement convaincants. Nous propo-
sons ici une nouvelle explication fondée sur les résultats du chapitre précédent : si l'union
monétaire renforce les investissements étrangers des pays membres, ceux-ci pourraient, à
leur tour, inuencer les ux de commerce de biens nals ou intermédiaires. Les décisions
de commerce et d'IDE sont étroitement liées, et cette corrélation peut être négative (eet
de substitution) ou positive (eet de complémentarité) suivant le motif de l'IDE (respec-
tivement horizontal ou vertical2). Mais la plupart des études empiriques concluent à une
relation de complémentarité, qui pourrait également s'expliquer par des échanges de biens
intermédiaires (Head et Ries, 2001). Dans ce chapitre, nous testons l'hypothèse d'un eet
2
L'IDE horizontal vise à dupliquer les biens produits an de pénétrer un marché local, tandis que dans
le cas vertical, le processus productif est fragmenté dans diérents pays an de tirer prot des diérences
de coûts.
xvii
Page 18
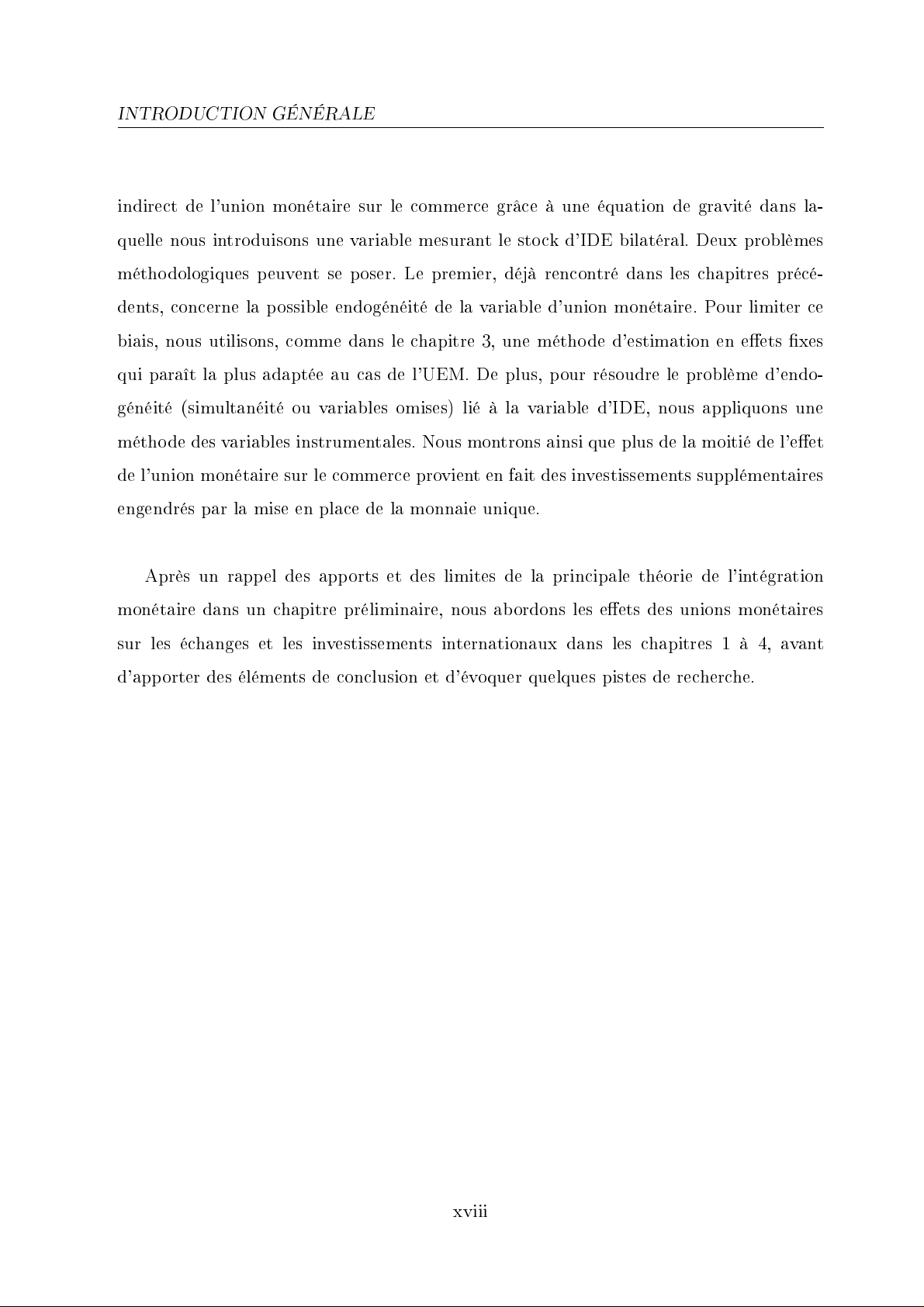
INTRODUCTION GÉNÉRALE
indirect de l'union monétaire sur le commerce grâce à une équation de gravité dans la-
quelle nous introduisons une variable mesurant le stock d'IDE bilatéral. Deux problèmes
méthodologiques peuvent se poser. Le premier, déjà rencontré dans les chapitres précé-
dents, concerne la possible endogénéité de la variable d'union monétaire. Pour limiter ce
biais, nous utilisons, comme dans le chapitre 3, une méthode d'estimation en eets xes
qui paraît la plus adaptée au cas de l'UEM. De plus, pour résoudre le problème d'endo-
généité (simultanéité ou variables omises) lié à la variable d'IDE, nous appliquons une
méthode des variables instrumentales. Nous montrons ainsi que plus de la moitié de l'eet
de l'union monétaire sur le commerce provient en fait des investissements supplémentaires
engendrés par la mise en place de la monnaie unique.
Après un rappel des apports et des limites de la principale théorie de l'intégration
monétaire dans un chapitre préliminaire, nous abordons les eets des unions monétaires
sur les échanges et les investissements internationaux dans les chapitres 1 à 4, avant
d'apporter des éléments de conclusion et d'évoquer quelques pistes de recherche.
xviii
Page 19
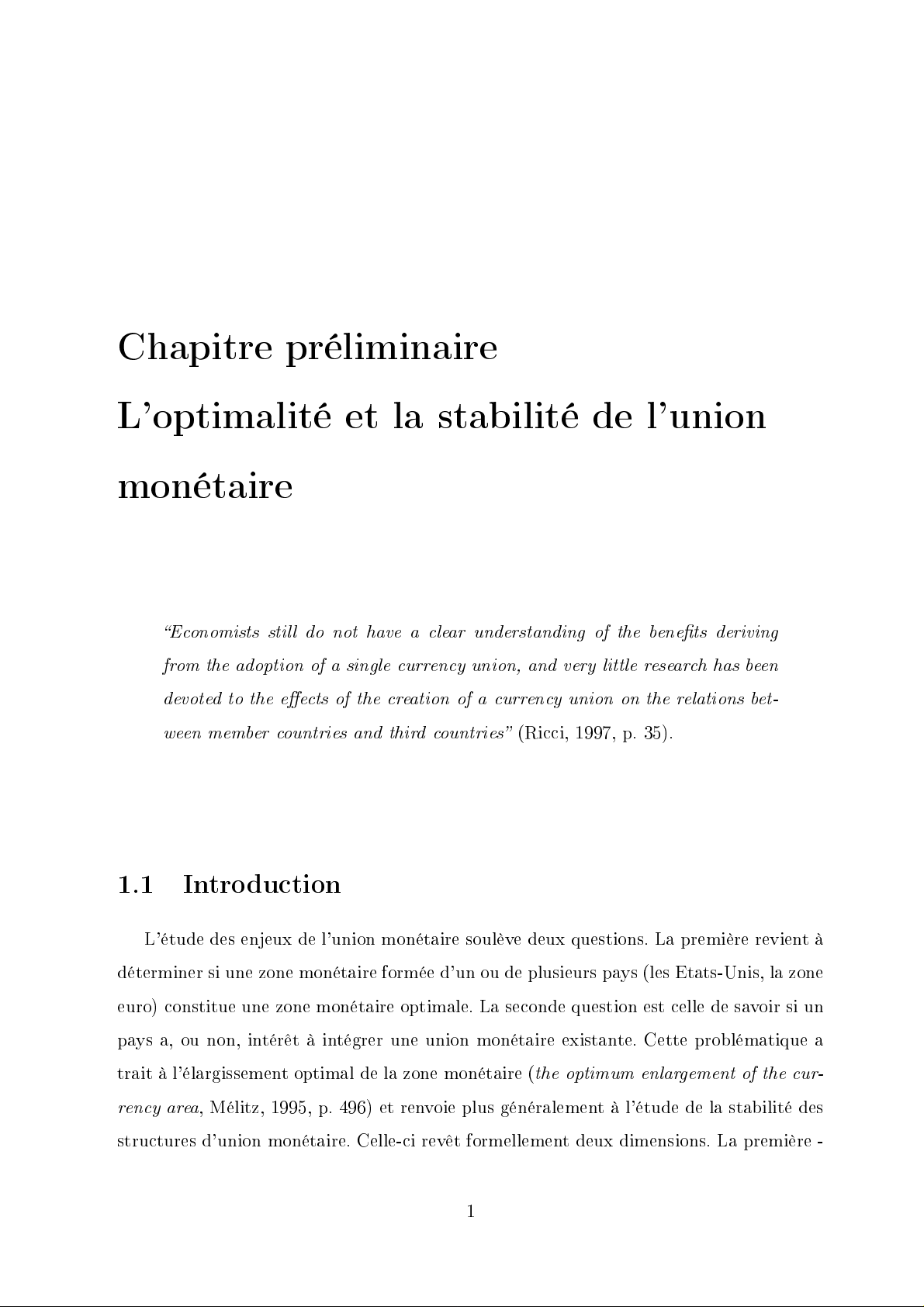
Chapitre préliminaire
L'optimalité et la stabilité de l'union
monétaire
Economists still do not have a clear understanding of the benets deriving
from the adoption of a single currency union, and very little research has been
devoted to the eects of the creation of a currency union on the relations bet-
ween member countries and third countries
(Ricci, 1997, p. 35).
1.1 Introduction
L'étude des enjeux de l'union monétaire soulève deux questions. La première revient à
déterminer si une zone monétaire formée d'un ou de plusieurs pays (les Etats-Unis, la zone
euro) constitue une zone monétaire optimale. La seconde question est celle de savoir si un
pays a, ou non, intérêt à intégrer une union monétaire existante. Cette problématique a
trait à l'élargissement optimal de la zone monétaire (
rency area
structures d'union monétaire. Celle-ci revêt formellement deux dimensions. La première -
, Mélitz, 1995, p. 496) et renvoie plus généralement à l'étude de la stabilité des
the optimum enlargement of the cur-
1
Page 20

1.1. INTRODUCTION
la stabilité interne - suppose que les pays membres de l'union monétaire n'ont pas intérêt
à en sortir, tandis que la seconde - la stabilité externe - assure que les pays non-membres
n'ont pas intérêt à y entrer.
La recherche s'est principalement intéressée à la première question et la théorie des
Zones monétaires optimales (ZMO), initiée par Mundell (1961), s'est établie progressive-
ment comme le principal cadre d'analyse de l'intégration monétaire. L'importance de cette
théorie est largement reconnue puisque Robert Mundell a reçu le Prix Nobel d'économie
en 1999. Traditionnellement, on évoque trois critères principaux permettant de dénir
l'étendue d'une ZMO : la mobilité du travail (Mundell, 1961), l'ouverture de l'économie
(McKinnon, 1963) et la diversication des structures de production (Kenen, 1969). Ces
critères sont les plus fréquemment cités, mais il en existe d'autres, relatifs par exemple
au degré d'intégration nancière (Ingram, 1962) ou à la similarité des taux d'ination
(Fleming, 1971). Une somme considérable d'articles de recherche, aussi bien théoriques
qu'empiriques, s'est développée par la suite dans la lignée de ces travaux. Si l'on suit
la périodisation proposée par Mongelli (2002), il y aurait trois grandes périodes, après
la
phase pionnière
principaux critères de ZMO. Les années 1970 constitueraient une
(du début des années 1960 au début des années 1970) qui dénit les
phase de réconciliation
autour d'une approche centrée davantage sur les coûts et bénéces de l'union monétaire
après les critiques émises par un certain nombre d'auteurs (Ishiyama, 1975, Johnson, 1969,
et plus tard Tavlas, 1994) qui soulignent que la présentation en termes de critère d'optima-
lité n'est pas pertinente1. Cette seconde approche n'est pas réellement novatrice puisque
les arguments mis en avant sont très similaires, mais la problématique est posée un peu
diéremment. Il ne s'agit plus de déterminer un critère essentiel permettant de délimiter
une ZMO, mais de faire apparaître diérents coûts et bénéces associés à la mise en place
d'une union monétaire. Le principal coût de l'union monétaire serait lié à la perte de
l'instrument de taux de change, tandis que les bénéces résideraient essentiellement dans
l'élimination de certains coûts de transaction. On observe ensuite une période de creux qui
1
Johnson va même jusqu'à considérer que la théorie des ZMO est dans une impasse (
(Johnson, 1969, p. 395).
dead-end
2
)
Page 21

1.1. INTRODUCTION
correspond à un moment où l'intégration monétaire européenne connaît plusieurs contre-
temps (Gros et Thygesen, 1998). Ce sont alors les avancées sur le terrain politique en
Europe qui tirent la recherche2. Le rapport Delors de 1988 relance l'idée d'une monnaie
unique et dénit les étapes concrètes devant mener à l'union monétaire. Le rapport de la
Commission européenne Marché Unique, Monnaie Unique, publié en 1990, propose une
évaluation critique de la théorie des ZMO et alimente le débat en donnant de nouvelles
pistes de recherche. Dans la littérature, la question principale tourne autour de l'Union
économique et monétaire (UEM), les étapes et les modalités de sa mise en place. Les
principaux coûts et bénéces de l'union monétaire sont réexaminés. La dernière phase,
couvrant les quinze ou vingt dernières années est empirique, centrée sur l'évaluation de
l'asymétrie des chocs, et des autres facteurs d'ajustement pouvant remplacer l'instrument
de taux de change : la mobilité du travail et le fédéralisme budgétaire.
La théorie des ZMO s'est révélée assez pessimiste sur les chances de succès de l'UEM.
Celle-ci néglige en eet les bénéces de l'union monétaire et omet des questions impor-
tantes, comme l'eet sur les pays tiers de la formation d'une union monétaire ou l'eet
sur les membres d'une union de son élargissement à d'autres pays (Powell et Sturzenegger,
2002). Ce cadre restrictif ne permet pas d'étudier les questions de l'élargissement et de la
stabilité de l'union monétaire et conditionne les résultats obtenus. Dans la deuxième partie
de ce chapitre préliminaire, nous examinons deux autres bénéces potentiels de l'union
monétaire : la crédibilité qu'elle confère aux autorités monétaires et les gains de coordina-
tion engendrés par une politique monétaire commune. Dans le modèle de Martin (1996)
à trois pays, développé à partir du cadre de Barro et Gordon (1983), la formation d'une
union monétaire entre deux pays exerce une externalité positive sur le pays non membre
qui peut mener une politique monétaire plus contre-cyclique que les pays membres, s'ap-
parentant à une stratégie de dépréciation compétitive. Il peut alors ne pas être incité à
entrer dans l'union monétaire et ce comportement de passager clandestin (
free-riding
risque d'être coûteux pour les pays membres et de remettre en cause la stabilité de l'union
2
Monfort (1997) note que la politique devance les analystes qui ont, au début, de la peine à suivre les
rythmes rapides des décisions prises en la matière (p. 1).
3
)
Page 22
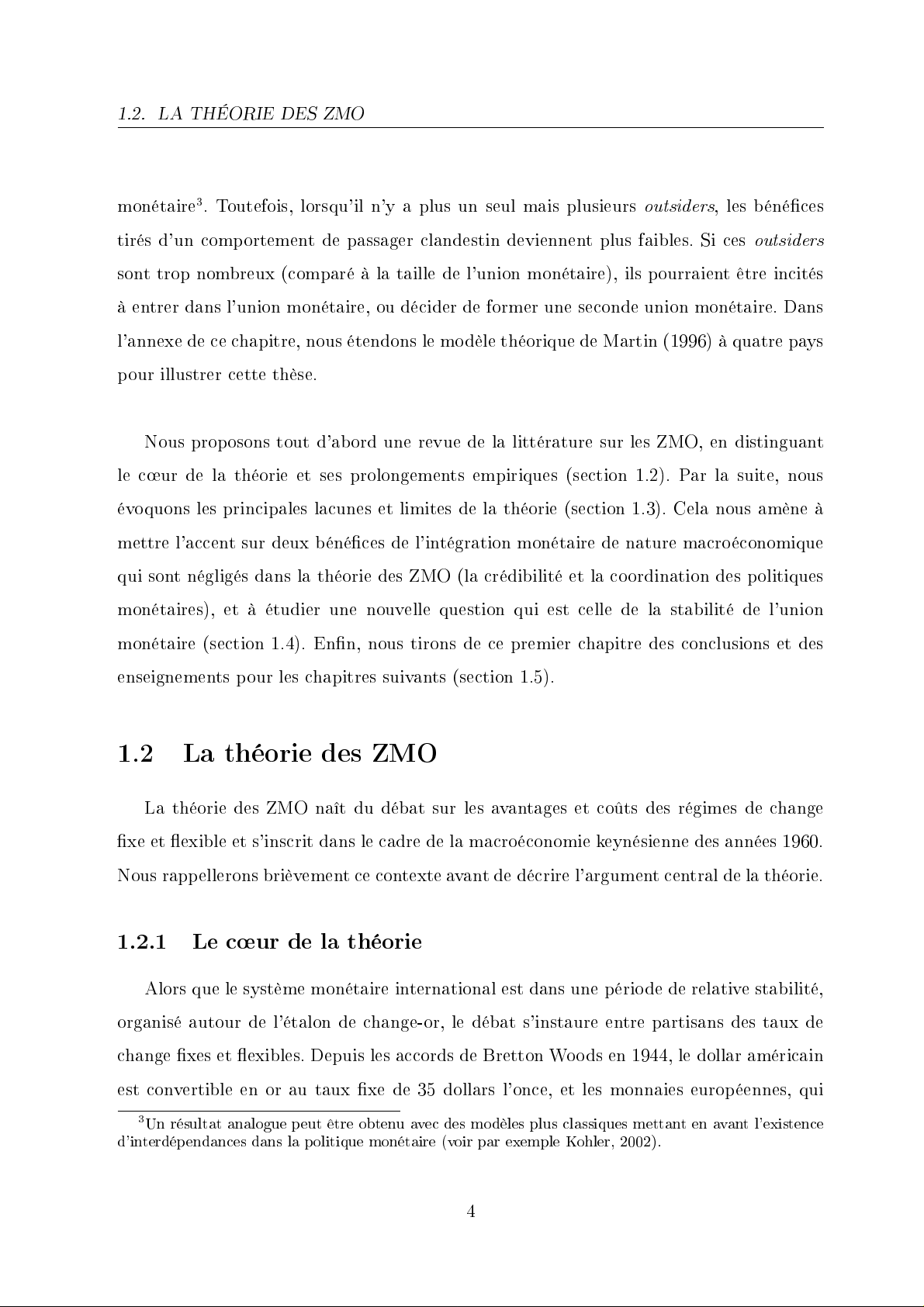
1.2. LA THÉORIE DES ZMO
monétaire3. Toutefois, lorsqu'il n'y a plus un seul mais plusieurs
tirés d'un comportement de passager clandestin deviennent plus faibles. Si ces
outsiders
, les bénéces
outsiders
sont trop nombreux (comparé à la taille de l'union monétaire), ils pourraient être incités
à entrer dans l'union monétaire, ou décider de former une seconde union monétaire. Dans
l'annexe de ce chapitre, nous étendons le modèle théorique de Martin (1996) à quatre pays
pour illustrer cette thèse.
Nous proposons tout d'abord une revue de la littérature sur les ZMO, en distinguant
le c÷ur de la théorie et ses prolongements empiriques (section 1.2). Par la suite, nous
évoquons les principales lacunes et limites de la théorie (section 1.3). Cela nous amène à
mettre l'accent sur deux bénéces de l'intégration monétaire de nature macroéconomique
qui sont négligés dans la théorie des ZMO (la crédibilité et la coordination des politiques
monétaires), et à étudier une nouvelle question qui est celle de la stabilité de l'union
monétaire (section 1.4). Enn, nous tirons de ce premier chapitre des conclusions et des
enseignements pour les chapitres suivants (section 1.5).
1.2 La théorie des ZMO
La théorie des ZMO naît du débat sur les avantages et coûts des régimes de change
xe et exible et s'inscrit dans le cadre de la macroéconomie keynésienne des années 1960.
Nous rappellerons brièvement ce contexte avant de décrire l'argument central de la théorie.
1.2.1 Le c÷ur de la théorie
Alors que le système monétaire international est dans une période de relative stabilité,
organisé autour de l'étalon de change-or, le débat s'instaure entre partisans des taux de
change xes et exibles. Depuis les accords de Bretton Woods en 1944, le dollar américain
est convertible en or au taux xe de 35 dollars l'once, et les monnaies européennes, qui
3
Un résultat analogue peut être obtenu avec des modèles plus classiques mettant en avant l'existence
d'interdépendances dans la politique monétaire (voir par exemple Kohler, 2002).
4
Page 23

1.2. LA THÉORIE DES ZMO
retrouvent leur convertibilité dans les années 1950, s'échangent à taux xes contre le dollar.
Ce n'est qu'en 1971 que le Président Nixon met n à la convertibilité du dollar en or, et
en 1973, que les grandes monnaies deviennent ottantes, marquant ainsi l'eondrement
du système de Bretton Woods.
Les adeptes des changes exibles, le Prix Nobel Milton Friedman en tête, soulignent
les avantages de la exibilité. Plusieurs arguments sont avancés. Premièrement, si les prix
et salaires sont rigides, la modication du taux de change apparaît comme un moyen peu
coûteux de corriger les déséquilibres externes. Un régime de change xe entraînerait alors
soit du chômage, soit de l'ination. Deuxièmement, le ottement ne conduit pas nécessai-
rement à une plus grande instabilité du taux de change et ore davantage de exibilité à
la politique macroéconomique. Cette conception suggère que le régime de change exible
est préférable au régime de change xe quelles que soient les caractéristiques du pays
(Ishiyama, 1975).
La théorie développée par Mundell en 1961 s'inscrit dans ce contexte. Mundell (1961)
dénit une zone monétaire comme un domaine à l'intérieur duquel les taux de change
sont xes et se demande quelle est la taille optimale d'une zone monétaire. Il donne ainsi
naissance à la
éléments nouveaux dans le débat opposant adeptes des régimes de change exible et ceux
qui prônent les changes xes (Bénassy-Quéré, 2003). Tout d'abord, Mundell déplace le
débat en montrant qu'aucun régime (xe ou exible) n'est meilleur
régime de change est conditionné par un certain nombre de conditions. Selon la réalisation
de ces conditions (et selon les pays et les époques), un régime sera plus approprié qu'un
autre. Il est alors possible que diérents systèmes de change coexistent parallèlement dans
diérents pays et à diérentes époques. Ensuite, il n'y a pas nécessairement coïncidence
théorie des Zones Monétaires Optimales
. Son article de 1961 apporte trois
a priori
. Le choix d'un
entre les frontières politiques et les frontières monétaires. L'exemple développé par Mundell
illustre bien cet argument, puisqu'il montre qu'on peut avoir intérêt à remplacer les dollars
canadien et américain par un dollar de l'Est et un dollar de l'Ouest (voir
facteur politique n'est donc pas le critère premier de détermination d'une zone monétaire
5
infra
). Le
Page 24
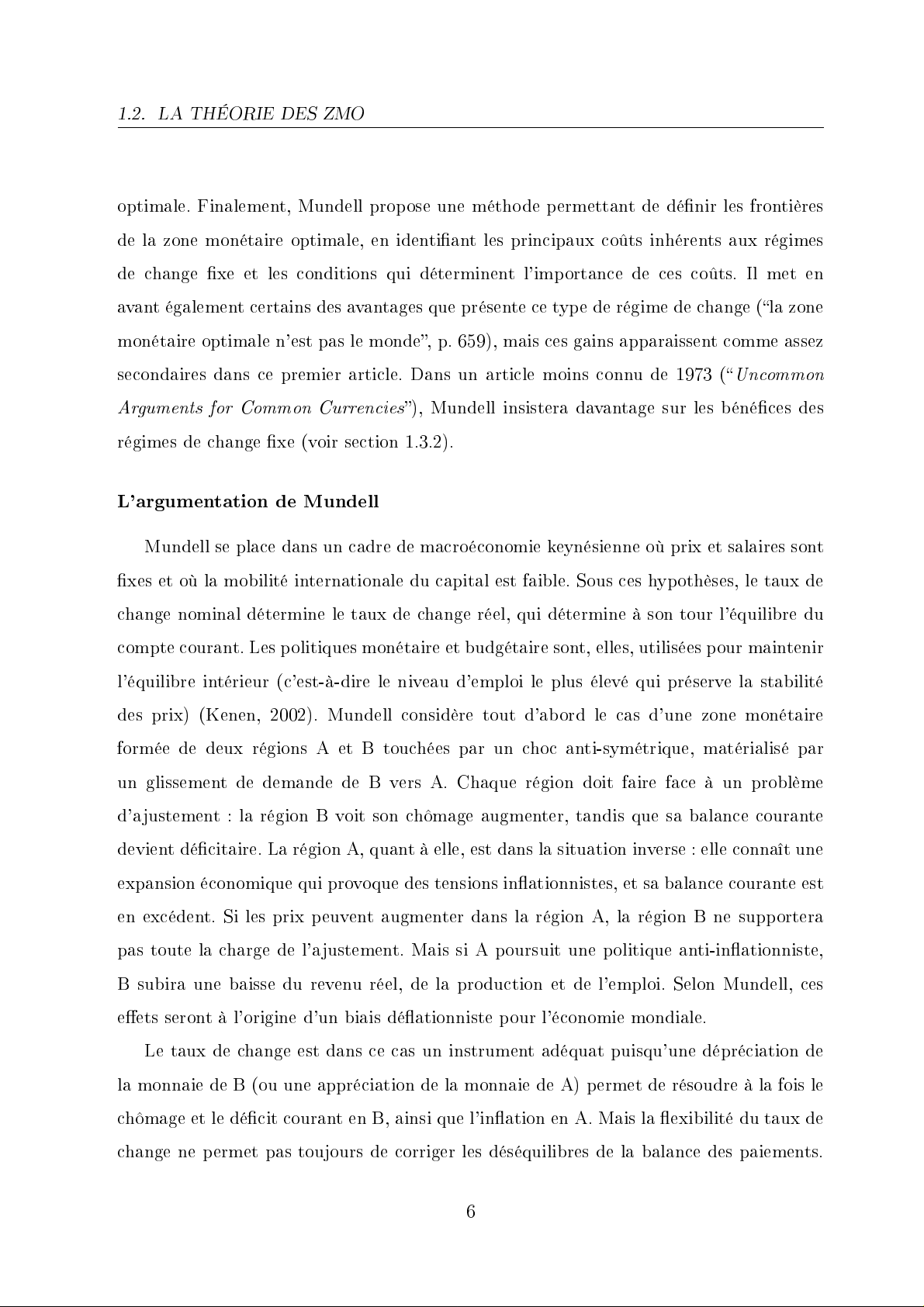
1.2. LA THÉORIE DES ZMO
optimale. Finalement, Mundell propose une méthode permettant de dénir les frontières
de la zone monétaire optimale, en identiant les principaux coûts inhérents aux régimes
de change xe et les conditions qui déterminent l'importance de ces coûts. Il met en
avant également certains des avantages que présente ce type de régime de change (la zone
monétaire optimale n'est pas le monde, p. 659), mais ces gains apparaissent comme assez
secondaires dans ce premier article. Dans un article moins connu de 1973 (
Arguments for Common Currencies
régimes de change xe (voir section 1.3.2).
L'argumentation de Mundell
Mundell se place dans un cadre de macroéconomie keynésienne où prix et salaires sont
xes et où la mobilité internationale du capital est faible. Sous ces hypothèses, le taux de
change nominal détermine le taux de change réel, qui détermine à son tour l'équilibre du
compte courant. Les politiques monétaire et budgétaire sont, elles, utilisées pour maintenir
l'équilibre intérieur (c'est-à-dire le niveau d'emploi le plus élevé qui préserve la stabilité
des prix) (Kenen, 2002). Mundell considère tout d'abord le cas d'une zone monétaire
formée de deux régions A et B touchées par un choc anti-symétrique, matérialisé par
un glissement de demande de B vers A. Chaque région doit faire face à un problème
d'ajustement : la région B voit son chômage augmenter, tandis que sa balance courante
), Mundell insistera davantage sur les bénéces des
Uncommon
devient décitaire. La région A, quant à elle, est dans la situation inverse : elle connaît une
expansion économique qui provoque des tensions inationnistes, et sa balance courante est
en excédent. Si les prix peuvent augmenter dans la région A, la région B ne supportera
pas toute la charge de l'ajustement. Mais si A poursuit une politique anti-inationniste,
B subira une baisse du revenu réel, de la production et de l'emploi. Selon Mundell, ces
eets seront à l'origine d'un biais déationniste pour l'économie mondiale.
Le taux de change est dans ce cas un instrument adéquat puisqu'une dépréciation de
la monnaie de B (ou une appréciation de la monnaie de A) permet de résoudre à la fois le
chômage et le décit courant en B, ainsi que l'ination en A. Mais la exibilité du taux de
change ne permet pas toujours de corriger les déséquilibres de la balance des paiements.
6
Page 25
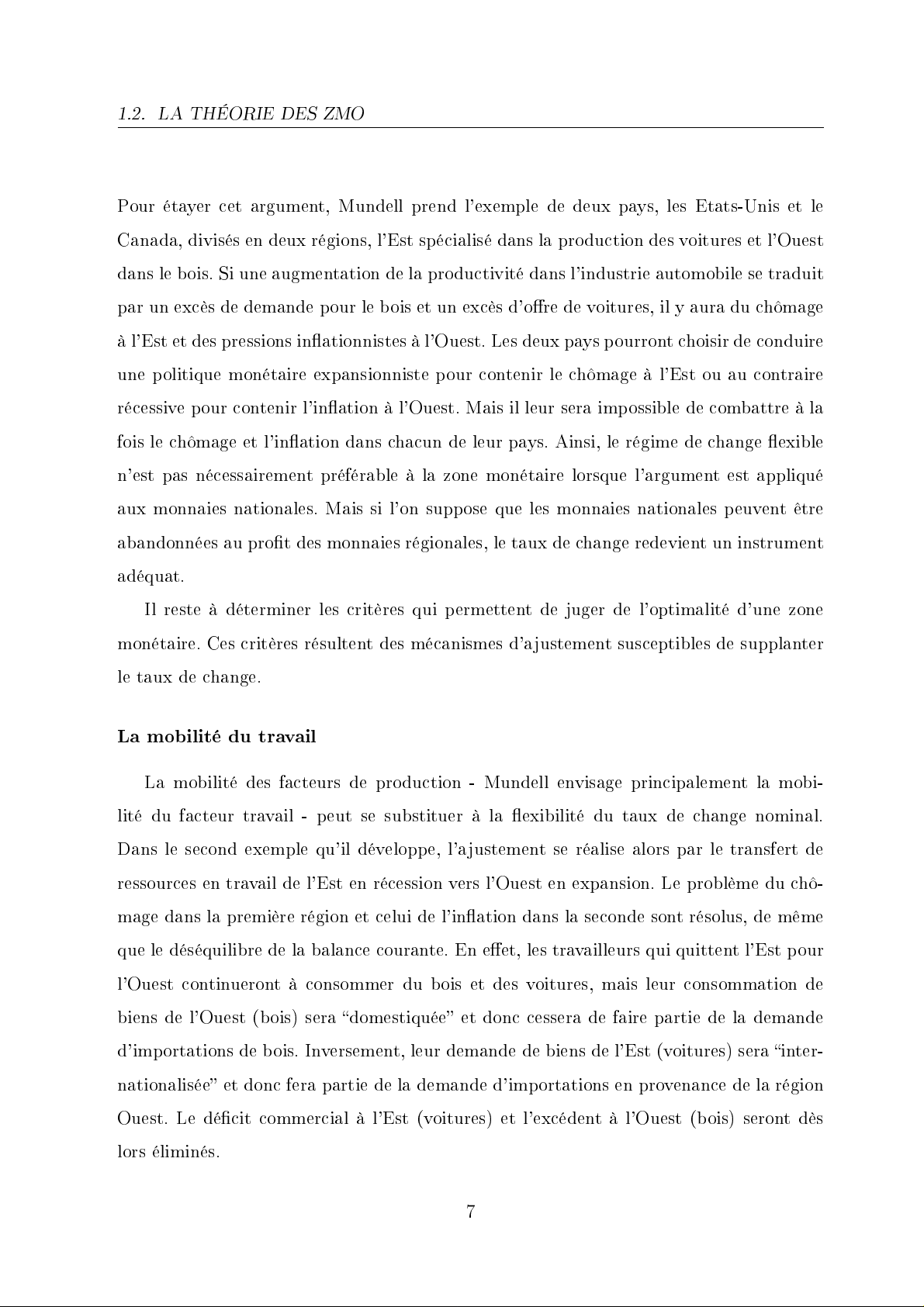
1.2. LA THÉORIE DES ZMO
Pour étayer cet argument, Mundell prend l'exemple de deux pays, les Etats-Unis et le
Canada, divisés en deux régions, l'Est spécialisé dans la production des voitures et l'Ouest
dans le bois. Si une augmentation de la productivité dans l'industrie automobile se traduit
par un excès de demande pour le bois et un excès d'ore de voitures, il y aura du chômage
à l'Est et des pressions inationnistes à l'Ouest. Les deux pays pourront choisir de conduire
une politique monétaire expansionniste pour contenir le chômage à l'Est ou au contraire
récessive pour contenir l'ination à l'Ouest. Mais il leur sera impossible de combattre à la
fois le chômage et l'ination dans chacun de leur pays. Ainsi, le régime de change exible
n'est pas nécessairement préférable à la zone monétaire lorsque l'argument est appliqué
aux monnaies nationales. Mais si l'on suppose que les monnaies nationales peuvent être
abandonnées au prot des monnaies régionales, le taux de change redevient un instrument
adéquat.
Il reste à déterminer les critères qui permettent de juger de l'optimalité d'une zone
monétaire. Ces critères résultent des mécanismes d'ajustement susceptibles de supplanter
le taux de change.
La mobilité du travail
La mobilité des facteurs de production - Mundell envisage principalement la mobi-
lité du facteur travail - peut se substituer à la exibilité du taux de change nominal.
Dans le second exemple qu'il développe, l'ajustement se réalise alors par le transfert de
ressources en travail de l'Est en récession vers l'Ouest en expansion. Le problème du chô-
mage dans la première région et celui de l'ination dans la seconde sont résolus, de même
que le déséquilibre de la balance courante. En eet, les travailleurs qui quittent l'Est pour
l'Ouest continueront à consommer du bois et des voitures, mais leur consommation de
biens de l'Ouest (bois) sera domestiquée et donc cessera de faire partie de la demande
d'importations de bois. Inversement, leur demande de biens de l'Est (voitures) sera inter-
nationalisée et donc fera partie de la demande d'importations en provenance de la région
Ouest. Le décit commercial à l'Est (voitures) et l'excédent à l'Ouest (bois) seront dès
lors éliminés.
7
Page 26

1.2. LA THÉORIE DES ZMO
Ainsi, si le monde est divisé en zones où la mobilité des facteurs est importante en leur
sein et faible internationalement, chacune de ces zones peut adopter une monnaie séparée
et un taux de change exible par rapport aux autres. Dans ce cadre, le principal critère
de dénition d'une zone monétaire optimale serait la mobilité du travail.
Degré d'ouverture et diversication de la structure de production
McKinnon (1963), pour sa part, insiste sur le degré d'ouverture des économies, déni
comme la proportion de biens échangeables dans la production. Il souligne que l'ecacité
du taux de change dans la réalisation des objectifs d'équilibre extérieur et de stabilité
des prix sera d'autant plus grande que l'économie est fermée vis-à-vis du reste du monde.
Cet argument repose sur deux constats. Premièrement, une économie ouverte qui utilise
son taux de change pour corriger un déséquilibre externe devra probablement subir une
forte instabilité des prix : les variations du taux de change se répercuteront sur le prix des
biens échangeables en monnaie domestique, donc sur l'indice général des prix (à moins que
l'ajustement ne se fasse par une baisse des prix des biens non échangeables, mais celle-ci
serait coûteuse en termes d'emploi). Le second aspect que met en évidence McKinnon
porte sur l'absence d'illusion monétaire. Dans un pays où la proportion d'importations
dans la consommation est importante, l'eet en termes réels des variations du taux de
change sera davantage perçu par la population, qui sera alors moins disposée à accepter
une diminution des salaires. L'instrument de taux de change devient alors inecace pour
corriger un déséquilibre du compte courant. Le régime de change xe semble donc plus
approprié pour des économies ouvertes.
Kenen (1969) met en avant un autre critère pertinent : le degré de diversication
d'une économie. Il arme que la mobilité du travail n'est pas un critère satisfaisant de
délimitation d'une zone monétaire optimale, car elle est rarement parfaite (Kenen, 1969,
p. 49). Kenen soutient que si la structure de production d'une économie est diversiée,
un choc négatif de demande sur un bien ou dans un secteur aura un eet moindre, tout
simplement parce que dans ce cas, chaque secteur représente une faible fraction de l'emploi
8
Page 27
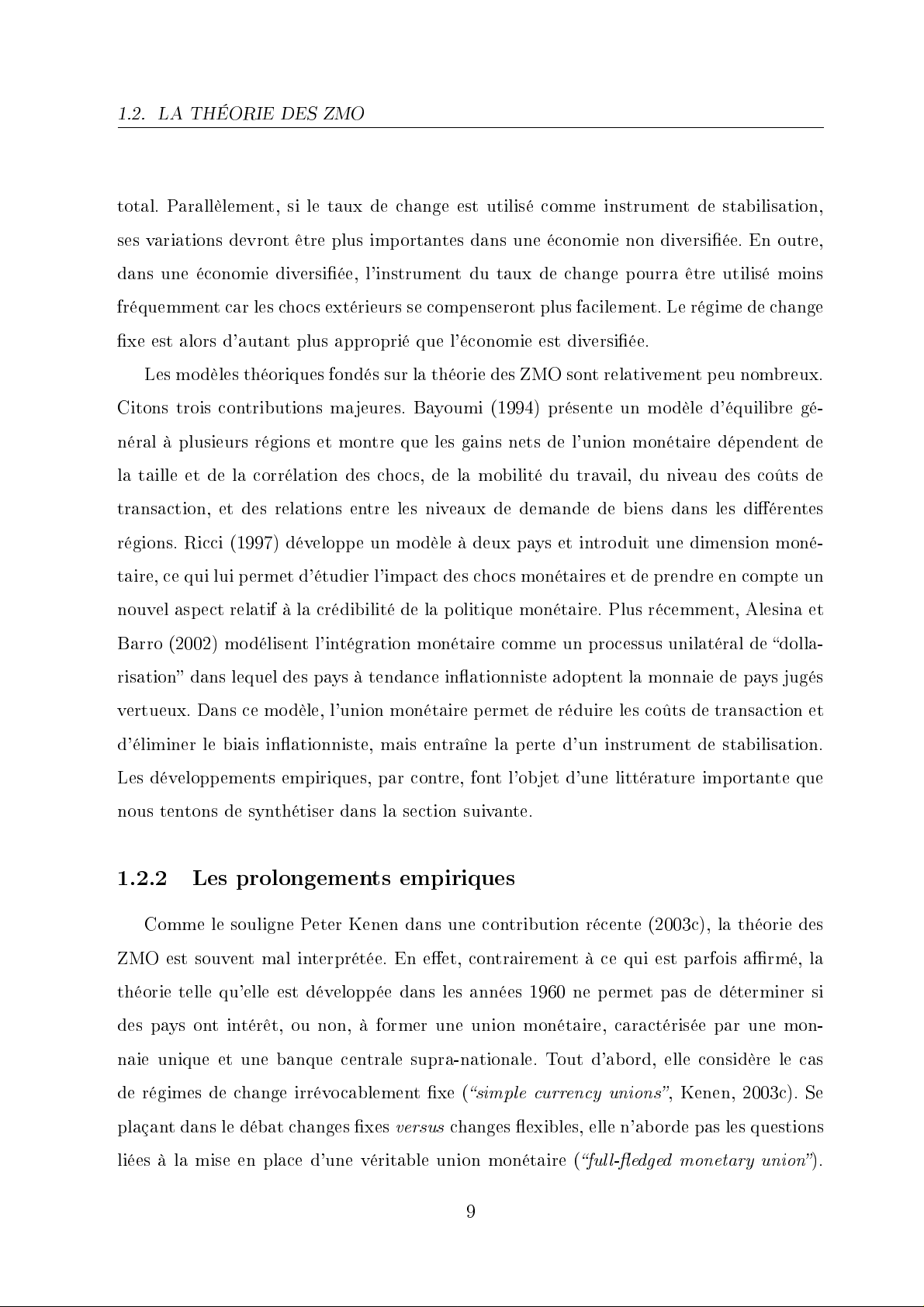
1.2. LA THÉORIE DES ZMO
total. Parallèlement, si le taux de change est utilisé comme instrument de stabilisation,
ses variations devront être plus importantes dans une économie non diversiée. En outre,
dans une économie diversiée, l'instrument du taux de change pourra être utilisé moins
fréquemment car les chocs extérieurs se compenseront plus facilement. Le régime de change
xe est alors d'autant plus approprié que l'économie est diversiée.
Les modèles théoriques fondés sur la théorie des ZMO sont relativement peu nombreux.
Citons trois contributions majeures. Bayoumi (1994) présente un modèle d'équilibre gé-
néral à plusieurs régions et montre que les gains nets de l'union monétaire dépendent de
la taille et de la corrélation des chocs, de la mobilité du travail, du niveau des coûts de
transaction, et des relations entre les niveaux de demande de biens dans les diérentes
régions. Ricci (1997) développe un modèle à deux pays et introduit une dimension moné-
taire, ce qui lui permet d'étudier l'impact des chocs monétaires et de prendre en compte un
nouvel aspect relatif à la crédibilité de la politique monétaire. Plus récemment, Alesina et
Barro (2002) modélisent l'intégration monétaire comme un processus unilatéral de dolla-
risation dans lequel des pays à tendance inationniste adoptent la monnaie de pays jugés
vertueux. Dans ce modèle, l'union monétaire permet de réduire les coûts de transaction et
d'éliminer le biais inationniste, mais entraîne la perte d'un instrument de stabilisation.
Les développements empiriques, par contre, font l'objet d'une littérature importante que
nous tentons de synthétiser dans la section suivante.
1.2.2 Les prolongements empiriques
Comme le souligne Peter Kenen dans une contribution récente (2003c), la théorie des
ZMO est souvent mal interprétée. En eet, contrairement à ce qui est parfois armé, la
théorie telle qu'elle est développée dans les années 1960 ne permet pas de déterminer si
des pays ont intérêt, ou non, à former une union monétaire, caractérisée par une mon-
naie unique et une banque centrale supra-nationale. Tout d'abord, elle considère le cas
de régimes de change irrévocablement xe (
plaçant dans le débat changes xes
liées à la mise en place d'une véritable union monétaire (
versus
simple currency unions
changes exibles, elle n'aborde pas les questions
full-edged monetary union
9
, Kenen, 2003c). Se
).
Page 28

1.2. LA THÉORIE DES ZMO
Ensuite, elle n'ore pas un cadre global pour juger de l'ensemble des coûts et bénéces
de l'union monétaire, mais se concentre principalement sur les coûts macroéconomiques
engendrés par l'abandon de l'instrument de taux de change.
Les prolongements empiriques de la théorie, portant, pour la plupart, sur l'expérience
européenne, repositionnent dans une certaine mesure la problématique autour des enjeux
de l'union monétaire dénie au sens strict, mais restent concentrés sur les coûts qu'elle
engendre. Il s'agit de déterminer si l'Union européenne (UE) constitue ou non une zone
monétaire optimale, en mesurant le déterminant du principal coût de l'union monétaire,
l'asymétrie des chocs, et en étudiant les facteurs d'ajustement pouvant remplacer l'ins-
trument de taux de change : la exibilité des prix et des salaires, le niveau de mobilité
du travail et le fédéralisme budgétaire. Notons toutefois qu'il existe d'autres domaines
d'évaluation empirique, relatifs par exemple au niveau d'intégration nancière, à la simi-
larité des taux d'ination, etc. Bayoumi et Eichengreen (1997) fournissent une synthèse
détaillée de cette littérature, en construisant des indices de ZMO à partir d'une batterie
d'indicateurs (asymétrie des chocs, importance du commerce bilatéral et taille économique
des pays).
L'asymétrie des chocs
La question de l'asymétrie des chocs et des réponses aux chocs est considérée comme
un aspect fondamental de la théorie des ZMO4. Elle peut être qualiée de meta-critère
dans le sens où elle se situe à l'intersection de plusieurs critères de ZMO (Mongelli, 2002) et
constitue indéniablement le corps de la littérature empirique sur les ZMO (Beine, 1999,
p. 149). L'idée sous-jacente est que si les chocs d'ore et de demande sont symétriques, une
politique monétaire commune devrait sure à permettre l'ajustement. Par contre, si les
chocs sont asymétriques5, les réponses des politiques monétaires devront être diérenciées.
Les coûts de l'union monétaire seront alors d'autant plus faibles que le degré de symétrie
4
Pour une revue de la littérature sur cet aspect en particulier, on peut se référer à Bayoumi et Eichen-
green (1999).
5
Les chocs asymétriques se caractérisent par une absence de corrélation entre les chocs nationaux.
L'exemple développé par Mundell (1961) illustre ce que l'on appelle parfois un choc anti-symétrique.
10
Page 29

1.2. LA THÉORIE DES ZMO
des chocs est grand.
Pour mesurer ce facteur, une première approche consiste à examiner la corrélation des
mouvements de production (voir Cohen et Wyplosz, 1989). Mais le principal problème
de cette approche tient à ce que les mouvements de la production peuvent reéter à la
fois l'inuence des chocs et les réponses de politique économique. Si deux économies su-
bissent le même choc, mais que l'une répond plus rapidement en engageant des mesures
de politique économique et parvient ainsi à revenir plus vite à son niveau initial, la cor-
rélation des mouvements de production entre les deux économies sera faible, alors que le
choc initial est identique. Bayoumi et Eichengreen (1993) proposent d'utiliser la méthode
VAR (
Vector autoregression analysis
)6et la procédure de décomposition développée par
Blanchard et Quah (1989), qui permet d'identier les chocs d'ore et de demande et de
les diérencier des réponses aux chocs7. Cette méthode permet, non seulement de mesu-
rer la corrélation des chocs entre pays, mais aussi d'examiner la vitesse avec laquelle les
économies s'ajustent à ces chocs. Elle peut être appliquée en prenant comme indicateur
quantitatif les variations de la production et de l'emploi (voir par exemple Bayoumi et
Prasad, 1996) ou des indicateurs de prix comme le taux de change réel (Eichengreen,
1990). Les résultats obtenus dans ces études sont souvent ambigus et donnent lieu à des
conclusions contradictoires (OCDE, 1999). Près de la moitié des études établissent que les
chocs ont un impact plutôt symétrique en Europe, tandis que pour l'autre moitié l'impact
est plutôt asymétrique.
Par contre, les conclusions paraissent plus ables quand il s'agit d'identier au sein de
l'UE un groupe de pays présentant une convergence plus grande. Bayoumi et Eichengreen
(1993) mettent en évidence deux groupes. Le premier forme le c÷ur de l'Europe et com-
prend l'Autriche, le Danemark, la France, le Bénélux et la Suisse. Ces pays se caractérisent
par des chocs beaucoup plus fortement corrélés avec l'Allemagne que les pays de la péri-
phérie (Italie, Espagne, Portugal, Irlande, Grèce, Royaume-Uni et Finlande). La Suède,
6
Cette méthode consiste à exprimer les variables d'intérêt en fonction d'autres variables et de leurs
valeurs retardées, et à interpréter les résidus comme des chocs subis par les économies.
7
Les chocs d'ore sont supposés avoir des eets permanents sur la production, tandis que les chocs de
demande n'auraient qu'un eet temporaire.
11
Page 30
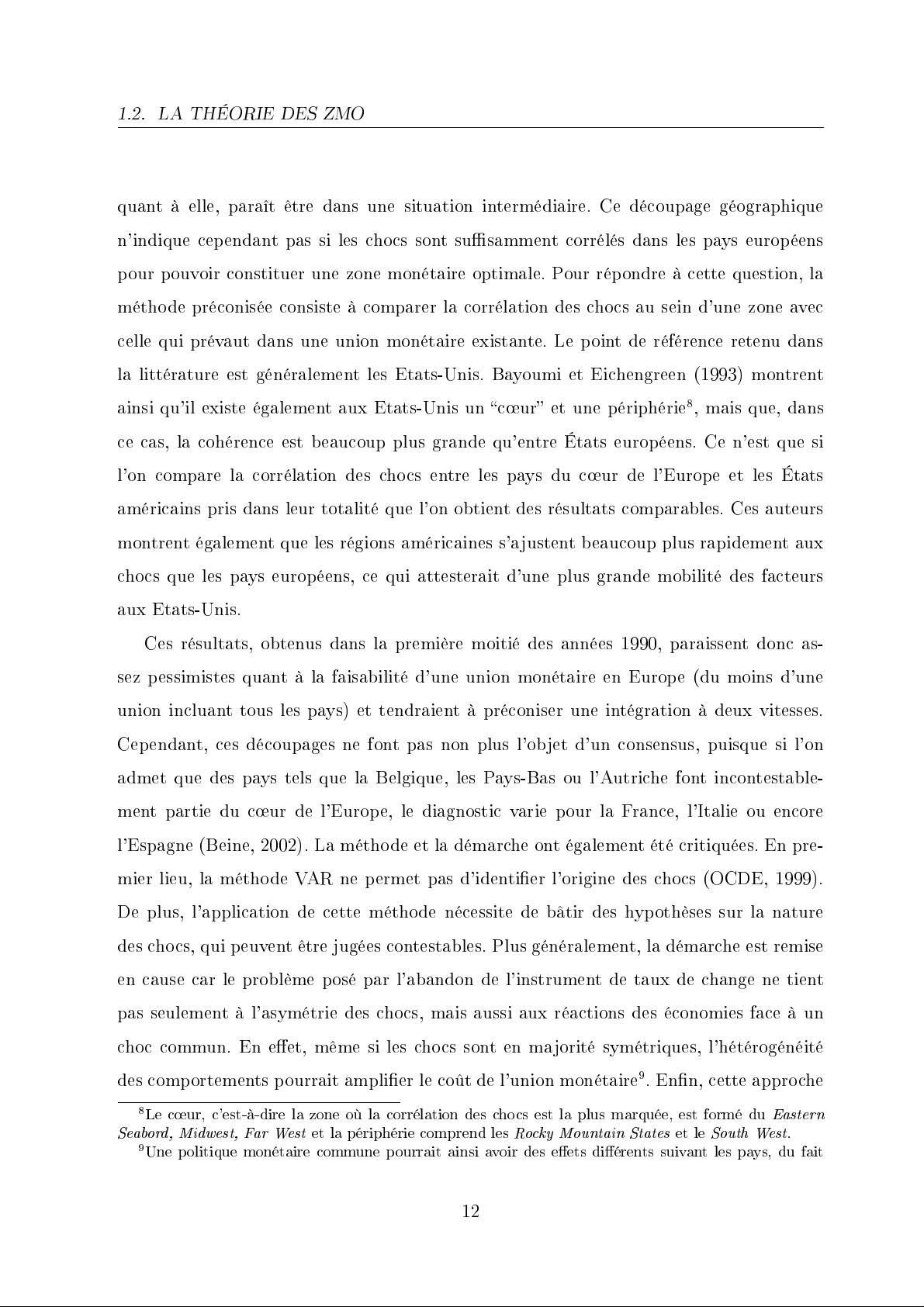
1.2. LA THÉORIE DES ZMO
quant à elle, paraît être dans une situation intermédiaire. Ce découpage géographique
n'indique cependant pas si les chocs sont susamment corrélés dans les pays européens
pour pouvoir constituer une zone monétaire optimale. Pour répondre à cette question, la
méthode préconisée consiste à comparer la corrélation des chocs au sein d'une zone avec
celle qui prévaut dans une union monétaire existante. Le point de référence retenu dans
la littérature est généralement les Etats-Unis. Bayoumi et Eichengreen (1993) montrent
ainsi qu'il existe également aux Etats-Unis un c÷ur et une périphérie8, mais que, dans
ce cas, la cohérence est beaucoup plus grande qu'entre États européens. Ce n'est que si
l'on compare la corrélation des chocs entre les pays du c÷ur de l'Europe et les États
américains pris dans leur totalité que l'on obtient des résultats comparables. Ces auteurs
montrent également que les régions américaines s'ajustent beaucoup plus rapidement aux
chocs que les pays européens, ce qui attesterait d'une plus grande mobilité des facteurs
aux Etats-Unis.
Ces résultats, obtenus dans la première moitié des années 1990, paraissent donc as-
sez pessimistes quant à la faisabilité d'une union monétaire en Europe (du moins d'une
union incluant tous les pays) et tendraient à préconiser une intégration à deux vitesses.
Cependant, ces découpages ne font pas non plus l'objet d'un consensus, puisque si l'on
admet que des pays tels que la Belgique, les Pays-Bas ou l'Autriche font incontestable-
ment partie du c÷ur de l'Europe, le diagnostic varie pour la France, l'Italie ou encore
l'Espagne (Beine, 2002). La méthode et la démarche ont également été critiquées. En pre-
mier lieu, la méthode VAR ne permet pas d'identier l'origine des chocs (OCDE, 1999).
De plus, l'application de cette méthode nécessite de bâtir des hypothèses sur la nature
des chocs, qui peuvent être jugées contestables. Plus généralement, la démarche est remise
en cause car le problème posé par l'abandon de l'instrument de taux de change ne tient
pas seulement à l'asymétrie des chocs, mais aussi aux réactions des économies face à un
choc commun. En eet, même si les chocs sont en majorité symétriques, l'hétérogénéité
des comportements pourrait amplier le coût de l'union monétaire9. Enn, cette approche
8
Le c÷ur, c'est-à-dire la zone où la corrélation des chocs est la plus marquée, est formé du
Seabord, Midwest, Far West
9
Une politique monétaire commune pourrait ainsi avoir des eets diérents suivant les pays, du fait
et la périphérie comprend les
Rocky Mountain States
et le
South West
Eastern
.
12
Page 31

1.2. LA THÉORIE DES ZMO
suppose que les chocs sont indépendants des régimes de change, alors que la structure des
chocs semble au contraire endogène (Pisani-Ferry, 1999). Nous reviendrons sur cet aspect
dans la section 1.3.
Le degré de mobilité du travail
Un autre pan de la littérature empirique dans le prolongement de la théorie des ZMO
s'est concentré sur l'analyse des mécanismes de marché, autres que ceux relatifs au taux
de change ou à la politique monétaire, facilitant l'ajustement aux chocs. Le premier de
ces mécanismes est la exibilité des prix et des salaires. En eet, si ces derniers sont
susamment exibles, le problème de l'asymétrie des chocs n'a pas lieu d'être, puisque les
variations de prix peuvent remplacer les ajustements de taux de change. Mais l'existence
de rigidités nominales remet en cause ce premier mécanisme d'ajustement. Le second
mécanisme possible est relatif à la mobilité du facteur travail mis en avant par Mundell
(1961) (voir
supra
).
Pour mesurer ce facteur, l'approche consiste, là aussi, à comparer le niveau de mobi-
lité en Europe et aux Etats-Unis. Les études concluent généralement à une mobilité des
travailleurs beaucoup plus faible en Europe qu'aux Etats-Unis (voir notamment OCDE,
1999). Mais ces mesures directes de la mobilité du travail peuvent reéter des situations
diérentes, comme un faible degré d'ajustement, la présence de chocs symétriques aectant
ce marché ou le rôle joué par la exibilité des salaires (Bayoumi et Eichengreen, 1993).
Blanchard et Katz (1992) tentent de déterminer les rôles respectifs des migrations
et de la exibilité des salaires dans l'évolution du marché du travail aux Etats-Unis. Ils
montrent que l'ajustement aux chocs de demande sur le marché du travail au niveau
régional s'eectue principalement par le biais de la mobilité de la main-d'÷uvre entre
Etats américains10. Par contre, l'ajustement par les salaires est réduit et ne permettrait
pas de répondre aux chocs. La situation semble bien diérente en Europe. La mobilité
de la diversité des structures bancaires et nancières (Mojon, 1998).
10
En fait, Blanchard et Katz (1992) n'utilisent pas de données sur les ux migratoires mais estiment
un eet indirect en montrant qu'un choc de 1% sur l'emploi dans un Etat est généralement suivi d'une
augmentation de 0,3% du chômage et d'une très faible diminution du taux d'activité. Ils en concluent que
la diérence est compensée par la migration de la main-d'÷uvre entre Etats.
13
Page 32

1.2. LA THÉORIE DES ZMO
des travailleurs est faible entre pays européens et l'ajustement s'opère principalement par
le changement d'activité et le chômage (OCDE, 1999). Ceci est conrmé par des études
montrant que la mobilité de la main-d'÷uvre joue un rôle peu important dans l'ajustement
du marché du travail européen en cas de chocs spéciques à une région (Decressin et Fatas,
1995).
Toutefois, si l'on s'en tient aux enseignements de la théorie des Zones monétaires opti-
males, il faudrait comparer la mobilité inter-régionale (au sein des États) et inter-nationale,
et pas non simplement évaluer le degré de mobilité inter-nationale en Europe (Gros, 2003).
En eet, d'après les enseignements de Mundell, ce n'est que si la mobilité est grande entre
régions et faible entre nations, que la nation peut être considérée comme une zone moné-
taire optimale. Par conséquent, l'union monétaire ne sera préférable au régime de change
ottant que si la diérence entre les deux niveaux de mobilité est importante. La situation
des États-Unis se rapproche du premier cas, puisque la mobilité entre États est beaucoup
plus élevée que la mobilité internationale, tandis que cet écart semble beaucoup plus faible
dans chacun des pays européens11. L'UEM pourrait alors ne pas fonctionner plus mal
que les unions monétaires existantes formées (avant 1999) par les États européens (Gros,
2003). Cet argument atténue quelque peu le pessimisme des analyses évaluant l'optimalité
de la zone monétaire européenne à partir du critère de mobilité du travail.
Le fédéralisme budgétaire
L'ajustement aux chocs asymétriques peut également être réalisé par des mécanismes
hors-marché, tels que des transferts budgétaires entre pays membres d'une union moné-
taire. La question de l'instauration d'un fédéralisme budgétaire au sein de l'union moné-
taire est récurrente en Europe et est déjà centrale dans le rapport MacDougall de 1977. A
l'heure actuelle, l'UEM ne prévoit pas une telle architecture, puisque les politiques bud-
gétaires restent du domaine national. Dans quelle mesure ce fédéralisme budgétaire est-il
un élément essentiel de dénition d'une zone monétaire optimale ? Quelles sont la ou les
11
Le ratio de la mobilité inter-régionale sur la mobilité inter-nationale est de 2 pour les États membres
de l'UE alors qu'il vaut environ 5 pour les États-Unis en 1999 et 2000 (Gros, 2003).
14
Page 33

1.2. LA THÉORIE DES ZMO
alternatives? Là encore, des premiers éléments de réponse sont donnés à partir de l'étude
des caractéristiques du système américain.
Sala-i-Martin et Sachs (1992) évaluent l'eet des transferts entre États américains sur
la stabilisation du revenu. Ils montrent qu'environ un tiers de l'impact des chocs spéci-
ques aux régions est compensé par le système d'impôts et de transferts fédéraux. Mais,
il paraît nécessaire de réexaminer ces résultats suivant le motif de l'intervention scale :
celle-ci peut, en eet, viser à égaliser les revenus, c'est-à-dire à répondre à des diérentiels
de revenu persistants entre régions (motif de redistribution), ou bien à stabiliser l'écono-
mie face à des chocs (motif de stabilisation). Bayoumi et Masson (1995) distinguent ces
deux motifs à partir des variables de revenu par tête (avant et après impôts et transferts)
considérées en niveau (eet de long terme destiné à capter l'élément redistributif) et en
diérences premières (réponses de court terme rendant compte de la composante stabi-
lisatrice). L'eet stabilisateur du fédéralisme budgétaire serait alors d'environ 30% aux
États-Unis (voir également Von Hagen, 1992a). De plus, les dimensions redistributrice et
stabilisatrice seraient également beaucoup plus importantes aux États-Unis qu'en Europe.
Mais ces estimations ignorent l'impact des transferts sur l'équilibre budgétaire fédé-
ral (Fatas, 1998). Or, si le revenu d'un État chute, ses recettes scales vont également
diminuer, ce qui aectera le budget fédéral. De nouveaux impôts (portant également sur
l'État en récession) devront être prélevés pour rétablir l'équilibre budgétaire, si bien qu'au
total, le montant net reçu par la région en récession sera plus faible que ne l'indique la
diérence de revenu disponible. Par ailleurs, ce type d'approche ignore l'eet des systèmes
scaux sur la dynamique des chocs. Pour estimer l'ecacité du système fédéral américain,
il faudrait reconstituer la dynamique des PNB par tête et des taux de chômage sans sys-
tème fédéral (Beine, 1999). Dès lors, certains économistes contestent l'idée selon laquelle
l'UEM nécessiterait un budget fédéral, d'autant que les politiques budgétaires nationales
permettent déjà en partie de protéger les régions contre d'éventuels chocs asymétriques et
pourraient être plus ecaces pour chaque pays pris isolément12(voir par exemple Fatas,
1998).
12
Dans le modèle Mundell Fleming, sous l'hypothèse d'une parfaite mobilité des capitaux, la politique
budgétaire est plus ecace en régime de change xe qu'en régime de change exible.
15
Page 34

1.2. LA THÉORIE DES ZMO
Dans ce cadre, la solution pourrait être de laisser plus de exibilité et d'autonomie aux
politiques budgétaires nationales aujourd'hui contraintes par le Pacte de stabilité et de
croissance. Cependant, cette solution peut s'avérer dangereuse. En eet, les gouvernements
pourraient être incités à créer des décits publics pour compenser les eets des chocs
négatifs sans chercher à recourir à d'autres ajustements moins coûteux tels que la mobilité
du travail (problème d'aléa moral) (voir Von Hagen et Farvaque, 2002). Or, lorsque le taux
d'intérêt est supérieur au taux de croissance de l'économie, le ratio dette/PIB s'accroît
automatiquement. Des politiques budgétaires trop expansionnistes sont donc insoutenables
à long terme. De plus, dans une union monétaire, de telles politiques peuvent créer des
externalités négatives pour les autres pays de l'union. En eet, un pays ayant davantage
recours au marché des capitaux pour nancer son décit, contribuera à la hausse du taux
d'intérêt prévalant au sein de la zone. Une telle évolution pourrait, d'une part, renforcer
le poids de la dette des autres pays membres et, d'autre part, conduire les pays subissant
ce coût supplémentaire à exercer des pressions sur la banque centrale de l'union pour
qu'elle relâche la politique monétaire (De Grauwe, 2000). Cette conception est l'un des
fondements du Pacte de stabilité et de croissance qui dénit des règles budgétaires strictes
(une limite de 3% du décit) pour les pays membres de la zone euro. Mais ces règles
sont également contestées et pourraient s'avérer contre-productives. Ainsi, Von Hagen et
Eichengreen (1996) montrent que les pays où les autorités régionales sont soumises à des
règles budgétaires strictes ont en moyenne des ratios de dette supérieurs.
Les études empiriques reposant sur la théorie des ZMO semblent donc, dans l'ensemble,
assez pessimistes quant à la faisabilité d'une union monétaire en Europe. Que ce soit du
point de vue de la symétrie des chocs, ou des autres mécanismes d'ajustement possibles
au sein d'une union monétaire, il semble que l'Europe, même limitée à douze pays, soit
encore loin de l'idéal-type de l'union monétaire que représentent les États-Unis. Ces
résultats doivent néanmoins être nuancés pour plusieurs raisons13. Tout d'abord, le point
13
Selon Eichengreen (2003),
based on pre-EMU data, including my own, paint too pessimistic a picture of the diculties that asym-
metric shocks and slow adjustment dynamics will pose for the operation of Europe's monetary union
further reections and analysis suggest that the rst generation of studies
.
16
Page 35

1.3. LE RÉEXAMEN DE LA THÉORIE
de référence constitué par les Etats-Unis n'est pas nécessairement pertinent. Les États-
Unis forment une union monétaire beaucoup plus ancienne et se caractérisent par des liens
culturels étroits et une même langue. Ensuite, la théorie ne permet pas de déterminer
un seuil à partir duquel une union monétaire est bénéque. C'est pour cette raison que
les études empiriques se contentent souvent de présenter leurs résultats sous forme de
classement relatif des économies européennes (Beine, 1999). Plus fondamentalement, les
critères des ZMO pourraient être
symétrie des chocs, le niveau de mobilité du travail ou de exibilité des salaires. Ainsi, il
n'est pas sûr que les conclusions auxquelles on parvient
ex post
être nuancés parce qu'ils reposent sur l'hypothèse implicite selon laquelle les variations du
taux de change permettent toujours un ajustement aux chocs, ce qui s'avère peu réaliste.
Les avantages des régimes de change exible seraient alors souvent surestimés. Dans la
section suivante, nous tenterons de mettre en lumière certaines des limites de la théorie
des ZMO.
, après la création de l'union monétaire. Enn, les résultats présentés ici doivent
endogènes
, si la création de l'union monétaire aecte la
ex ante
soient toujours pertinentes
1.3 Le réexamen de la théorie
La théorie des ZMO fait l'objet de nombreuses critiques dont certaines sont reprises
dans le document de la Commission européenne Marché unique, monnaie unique (1990).
Le cadre théorique est remis en cause en raison tout d'abord de son manque d'unication
et de son caractère restrictif.
1.3.1 Un cadre non unié et trop restrictif
Les contradictions internes de la théorie
L'une des critiques portées sur la théorie des ZMO a trait au manque de cohérence
du cadre d'analyse. Il n'existe pas de consensus sur les coûts et bénéces de l'union mo-
nétaire, en partie à cause de l'inexistence d'un cadre théorique global qui permettrait
d'aborder ces questions. Mélitz (1995) va plus loin en soulignant que la théorie des ZMO
17
Page 36

1.3. LE RÉEXAMEN DE LA THÉORIE
n'a pas connu d'avancées depuis la contribution de Mundell (1961) et que la faute revient
à la
profession's unwillingness to adopt a formal analysis of the subject divorced from the
policy aspects
en compte par une fonction de bien-être générale. Chaque critère est dicile à mesurer
quantitativement, et aucune approche ne permet d'identier clairement la ligne de dé-
marcation entre les pays qui devraient former une union monétaire et ceux qui devraient
rester à l'écart. Ces arguments conduisent certains économistes à considérer le concept de
zone monétaire optimale comme non opérationnel (McCallum, 1999).
Ce manque d'unication du cadre théorique peut être à l'origine des contradictions
internes que présente la théorie des ZMO. Ainsi, Tavlas (1994) relève à la fois un problème
d'indétermination (
premier tient au fait que l'application des diérents critères mis en avant dans la théorie
conduit à des conclusions parfois divergentes. Les critères sont diciles à mesurer et ne
peuvent donc pas être appréhendés les uns par rapport aux autres. Par exemple, une
économie ouverte, qui commerce beaucoup avec un groupe de pays, peut avoir intérêt à
(p. 493). Les coûts et bénéces sont traités de façon séparée et non pris
inconclusiveness
) et un problème d'incohérence (
inconsistency
). Le
former une zone monétaire avec ces pays, d'après le critère de McKinnon. Mais cette zone
peut présenter un faible degré de mobilité des facteurs, ce qui suggère plutôt l'adoption
d'un régime de change exible. Le second problème est plus important. Il révèle le fait que
certains critères sont intrinsèquement contradictoires. Ainsi, une petite économie sera en
général très ouverte et devrait donc adopter un régime de change xe, suivant le critère
d'ouverture. Mais une petite économie a également toutes les chances d'être peu diversiée
et devrait donc adopter un régime de change exible selon le critère de Kenen. Cette
contradiction dans les conclusions tirées peut être due aux diérences dans les hypothèses
sur la source du déséquilibre considéré : alors que McKinnon se préoccupe des chocs
internes, Kenen, lui, insiste sur les chocs externes (Ishiyama, 1975). De même, Gros (2003)
souligne que la mobilité du travail peut favoriser la concentration de la production. Le
critère de mobilité du travail introduit par Mundell peut donc s'opposer au critère de
diversication.
18
Page 37

1.3. LE RÉEXAMEN DE LA THÉORIE
Un cadre restrictif
Par ailleurs, la théorie des ZMO se concentre généralement sur un cadre à deux pays et
omet les chocs de l'extérieur, provenant par exemple des variations des taux de change des
grandes monnaies (Kenen, 2002). Elle envisage la zone monétaire comme une petite entité
dans un monde vaste. Or, si pour une petite économie, on peut eectivement supposer
que le choix d'un régime de change n'aecte pas le reste du monde, cette hypothèse
ne paraît pas réaliste pour des pays plus grands.
determined may not be `globally' optimum
(Kawai, 1992, p. 80). La formation d'une
The `optimum' currency area thus
union monétaire pourrait avoir un impact important sur les autres pays, ce qui suggère que
l'arbitrage traditionnel entre coûts et bénéces est faussé. De même, du fait d'externalités,
la politique menée par les principaux pays partenaires non-membres de l'union monétaire
peut inuencer le bien-être de l'union (voir section 1.4).
L'introduction dans les modèles de ZMO d'un troisième pays, c'est-à-dire d'un pays -
ou plus généralement d'un groupe de pays - extérieur à l'union monétaire peut dès lors
modier considérablement les résultats obtenus (Mélitz, 1995). Dans un modèle à deux
pays (où les deux pays forment l'union monétaire), la mise en place d'une union monétaire
entraîne l'abandon dénitif de l'instrument de taux de change. Mais dans un modèle à trois
pays, l'union monétaire conserve une certaine capacité d'ajustement puisqu'elle continue
d'appliquer un taux de change exible vis-à-vis du reste du monde. En outre, l'instrument
de taux de change paraît moins ecace dans la mesure où il ne permet un ajustement
face aux chocs que sous certaines hypothèses14. Il s'en suit que lorsque l'on envisage des
modèles à plus de deux pays, le coût relatif de l'union monétaire, traditionnellement mis
en évidence dans la théorie des ZMO, est réduit.
14
Mélitz (1995) donne l'exemple d'un choc asymétrique aectant une économie et rendant nécessaire
une dépréciation de 20% du taux de change réel de ce pays vis-à-vis de l'autre pays appartenant à l'union
monétaire. Une variation du taux de change nominal ne permettra l'ajustement que si, dans le premier
pays, le même niveau de dépréciation est requis vis-à-vis du reste du monde, alors que dans le second
aucune modication du taux de change réel n'est nécessaire. Mélitz souligne qu'en dehors de ce cas très
particulier, les variations du taux de change nominal ne permettront pas d'éviter un accroissement du
chômage.
19
Page 38

1.3. LE RÉEXAMEN DE LA THÉORIE
1.3.2 L'endogénéité des critères
Les analyses présentées jusqu'à présent sont essentiellement statiques, c'est-à-dire qu'elles
évaluent le degré d'asymétrie des chocs ou de mobilité du travail à un moment donné. Or,
il est probable que les critères de ZMO évoluent au cours du temps et sont aectés par le
processus même d'intégration économique et monétaire. Ainsi, l'intensité du commerce et
le niveau de corrélation des cycles entre pays peuvent être considérés comme deux critères
de zone monétaire optimale, mais la formation d'une union monétaire pourrait inuen-
cer le niveau de ces deux critères à l'intérieur de l'union. Cet argument constitue une
illustration de la critique émise par Robert Lucas à la n des années 1970 portant plus
généralement sur les modèles macro-économétriques15.
Intégration monétaire et corrélation des cycles
Deux vues s'opposent quant à la relation entre intégration monétaire et corrélation
des cycles. Selon Krugman (1993), l'intégration monétaire aurait pour eet de réduire la
corrélation des cycles. En eet, en présence de rendements d'échelle croissants, l'intégration
monétaire et commerciale pourrait renforcer les phénomènes de concentration régionale
des activités industrielles, et donc accroître la probabilité de chocs spéciques aux secteurs
qui pourraient devenir autant de chocs nationaux et asymétriques.
La Commission européenne (1990) défend une thèse diérente. Il y aurait, selon elle,
une relation négative entre le degré d'ouverture et l'occurrence de chocs asymétriques, car
le commerce entre pays européens est en grande partie intra-branche. La mise en place
de l'UEM, en renforçant l'intégration, devrait entraîner une modication des structures
industrielles dans le sens d'un renforcement des échanges intra-industriels et des inves-
tissements croisés, ce qui signie que la plupart des pays exporteront et importeront des
produits provenant de divers secteurs industriels (p. 25). Les pays se spécialiseront alors
moins selon leurs avantages comparatifs et les chocs spéciques à certains secteurs ne
15
Lucas met en évidence le fait que les paramètres des modèles macro-économétriques ne sont pas
indépendants des politiques économiques menées par les autorités car les anticipations des agents sont
rationnelles et prennent donc en compte les mesures annoncées. Dans ces conditions, on ne peut pas
s'appuyer sur l'observation du passé pour prédire l'impact de mesures à venir.
20
Page 39

1.3. LE RÉEXAMEN DE LA THÉORIE
seront plus nécessairement spéciques à certains pays.
La première remarque que l'on peut faire est que, même si l'argument de Krugman
d'un renforcement des phénomènes d'agglomération se vérie, cela n'implique pas néces-
sairement que la perte du taux de change comme instrument de stabilisation soit coûteuse.
En eet, on peut penser que le renforcement de l'intégration conduira également à réduire
l'importance des frontières nationales. Il est alors probable que les phénomènes de concen-
trations ne se réalisent pas à l'intérieur de pays particuliers mais dépassent les frontières.
Si tel est le cas, même si l'ajustement par le taux de change est possible, il ne permettrait
pas de gérer des chocs sectoriels, ce qui réduit le coût de l'union monétaire relativement à
un régime de change exible. Des études empiriques tendent à conrmer ces hypothèses.
Ainsi, Fatas (1997) souligne que la corrélation des cycles entre régions de pays limitrophes
s'est accrue sur la période 1966-1992, tandis que la corrélation entre régions d'un même
pays a eu tendance à diminuer. Les régions d'Italie du Nord par exemple auraient des
cycles plus corrélés avec les régions allemandes qu'avec les régions d'Italie du Sud.
Cette question est donc avant tout considérée comme une question empirique. Les
études utilisant des indicateurs de spécialisation et de concentration de la production
industrielle concluent généralement que la spécialisation est relativement faible en Europe,
mais qu'elle tend à croître depuis les années 1980 (Midelfart-Knarvik
également OCDE, 1999). L'évolution de la spécialisation des pays européens, analysée
sur la base des ux commerciaux, conduit à des conclusions opposées puisqu'elle reète
la prédominance du commerce intra-branche au sein de l'UE et indiquerait donc une
diversication des économies nationales. Par ailleurs, Frankel et Rose (1996) montrent que
la corrélation des cycles dépend du niveau d'intégration. Leur étude menée sur 21 pays
industriels sur la période 1959-1993 révèle que l'intensité des liens commerciaux est associée
et al.
, 2004 ; voir
positivement à la corrélation des activités économiques. Il s'en suit que si l'intégration
(économique et) monétaire a pour eet de renforcer les échanges, elle pourrait rendre
les chocs plus symétriques. Cela amène ces auteurs à parler d'endogénéité des critères
de ZMO : même si un ensemble de pays ne remplit pas les critères de ZMO
21
ex ante
, il
Page 40

1.3. LE RÉEXAMEN DE LA THÉORIE
est possible qu'il les remplisse
vision de la Commission européenne puisqu'il identie, pour les pays d'Europe centrale
et orientale, les chocs d'ore et de demande grâce à une méthode VAR et montre qu'un
renforcement de l'intensité commerciale est associé à une plus grande symétrie des chocs
de demande vis-à-vis de l'UE.
Mais une analyse plus poussée du commerce intra-européen révèle des évolutions com-
plexes. En eet, si la part du commerce inter-branche tend à diminuer en Europe au prot
du commerce intra-branche, c'est le commerce intra-branche de qualité (opposé à l'intra-
branche de variétés) qui domine (Fontagné et Freudenberg et Péridy, 1998 ; Fontagné,
1999). Or, ce type de spécialisation relève largement d'une logique d'avantages compa-
ratifs qui peut être porteuse d'asymétries. Toutefois, l'étude des eets de la volatilité du
taux de change sur la structure du commerce montre que la mise en place d'une union
monétaire,
réduction du commerce inter-branche et à une augmentation du commerce intra-branche
via
son eet de réduction de l'incertitude sur le change, devrait conduire à la
ex post
. Babetski (2005) conrme en partie ces eets et la
en diérenciation à la fois verticale (de qualité), et horizontale (de variété) (Fontagné et
Freudenberg, 1999). Ceci conrme la thèse de l'endogénéité et montre que l'union moné-
taire pourrait créer les conditions de sa propre réussite.
Intégration monétaire et partage des risques
La mise en place d'une union monétaire est susceptible d'inuencer non seulement la
nature des chocs, mais aussi leur impact sur l'économie. Elle pourrait, par le biais d'une
intégration nancière renforcée, fournir le moyen de s'assurer contre les chocs asymétriques,
réduisant ainsi le coût de l'union monétaire (De Grauwe et Mongelli, 2005).
L'article fondateur de Mundell (1961) met en évidence le fait que le seul moyen d'ajus-
tement face à des chocs asymétriques consiste à utiliser l'instrument du taux de change si
les prix et les salaires sont xes et si la mobilité du travail est faible. Mais dans un article
moins connu de 1973 (
ligne l'importance des facteurs nanciers dans le choix d'un régime de change et parvient
Uncommon Arguments for Common Currencies
), Mundell sou-
à des conclusions très diérentes :
a xed exchange rate system is a device for automatic
22
Page 41

1.3. LE RÉEXAMEN DE LA THÉORIE
cushioning of shocks without destroying the image of the international moneyness of the
national money in the public mind
(p. 115). L'union monétaire permettrait de réduire
l'impact des chocs asymétriques grâce à la diversication des portefeuilles et à la mise en
commun des réserves de change. La logique qui sous-tend la théorie des ZMO est alors
inversée (McKinnon, 2002). Les petits pays, fortement spécialisés et donc plus sensibles
aux chocs d'ore asymétriques, ne devraient pas conserver un taux de change exible,
comme le préconisait Kenen, mais au contraire former une union monétaire pour pou-
voir bénécier d'un partage des risques (
change limite le
risk sharing
en réduisant l'incitation à la diversication des portefeuilles
risk sharing
). En eet, la exibilité du taux de
(McKinnon, 2002).
Outre la exibilité des prix ou du taux de change, d'autres mécanismes de marché
pourraient alors permettre un ajustement aux chocs asymétriques. Une étude réalisée sur
les États-Unis montre que 39% des chocs aectant la production d'un des États sont
amortis par le canal du marché des capitaux (c'est-à-dire par la détention d'actifs sur la
production d'autres États), 23% grâce au marché du crédit, 13% par le biais du gouver-
nement fédéral, tandis que les 25% restants ne sont pas amortis (Asdrubali, Sørensen et
Yosha, 1996). Mélitz et Zumer (1999) reprennent et améliorent la méthodologie adoptée
par ces trois auteurs en ajoutant des variables qui conditionnent le partage des risques.
Leurs résultats dièrent légèrement de ceux de leurs prédécesseurs, donnant une part plus
importante au canal du marché du crédit et du gouvernement fédéral, tandis que, cette
fois, environ un tiers des chocs ne serait pas amorti. Plus important, ils étendent l'analyse
à d'autres pays et montrent que le
risk sharing
est plus faible à l'échelle internationale
qu'à l'échelle inter-régionale16. Le processus d'intégration pourrait alors conduire à un
renforcement du partage des risques dans l'UEM aussi bien par le canal du marché du
crédit que par celui du marché des capitaux (voir également Kalemli-Ozcan, Sørensen et
Yosha, 2005). Ainsi, la formation d'une union monétaire permettrait d'atténuer l'impact
des chocs asymétriques par le biais de ces mécanismes de marché.
16
Les trois quarts des chocs asymétriques pesant sur les pays - et non plus sur les régions - ne seraient
pas amortis par des mécanismes de marché (Mélitz et Zumer, 1999).
23
Page 42

1.3. LE RÉEXAMEN DE LA THÉORIE
Ce résultat, s'il se conrme, renforce l'argument précédent relativisant plus encore le
principal coût de la formation d'une union monétaire identié par la théorie traditionnelle.
Il semblerait, si l'on en croit ces études, qu'une union monétaire, grâce à un renforcement
de l'intégration commerciale, rende les chocs asymétriques moins probables, tout en met-
tant en place, parallèlement, les forces de marché susceptibles d'atténuer l'impact des
chocs asymétriques qui subsistent. Ces arguments contribuent à préconiser une adoption
précoce de l'euro dans les pays d'Europe centrale et orientale (PECO), puisque l'euroi-
sation devrait renforcer l'intégration nancière, permettant alors un partage des risques
plus important (Maurel, 2004).
Remarquons enn que la question de l'endogénéité n'est pas connée à l'intégration
commerciale et nancière (Mongelli, 2002). Le même type de raisonnement peut être
appliqué à l'ination, à l'intégration politique, aux institutions du marché du travail, ou
encore au cadre des politiques économiques (voir Mongelli, 2002 ; De Grauwe et Mongelli,
2005). Corsetti et Pesenti (2004) montrent, par exemple, à partir d'un modèle d'équilibre
général, que même si l'union monétaire ne renforce pas l'intégration économique et le
commerce intra-branche, l'adoption d'une politique monétaire commune peut être
validating
, dans la mesure où elle contribue à la synchronisation des cycles.
self-
1.3.3 L'alternative de l'union monétaire
Un élément essentiel dans la discussion sur les coûts de l'union monétaire porte sur
l'hypothèse (implicite ou explicite) concernant l'alternative supposée de l'union monétaire
(Gros et Thygesen, 1998). Cette alternative est généralement le régime de change exible.
Dans la théorie des ZMO, le taux de change est un instrument ecace de stabilisation, en
raison de l'hypothèse keynésienne de rigidité des prix et d'absence de mobilité du capital
(Buiter, Corsetti et Pesenti, 1998, ch. 10). Mais qu'en est-il si ces hypothèses ne sont plus
vériées?
24
Page 43

1.3. LE RÉEXAMEN DE LA THÉORIE
Le taux de change n'est pas toujours un instrument ecace
Une condition fondamentale de l'ecacité de l'instrument de taux de change est que
les variations du taux de change nominal se répercutent sur la compétitivité et ne sont
pas compensées par des variations de prix. Or, les variations du taux de change nominal
n'auraient qu'un eet temporaire sur la compétitivité des pays (tant qu'il subsiste des ri-
gidités nominales). A long terme, la dévaluation se traduit par une hausse des prix et des
salaires nominaux qui ramèneront le taux de change réel à son niveau initial. Toutefois,
les eets de court terme doivent également être pris en compte. Ainsi, De Grauwe (1999)
note que la dévaluation du franc belge de 1982 a permis de restaurer l'équilibre interne
et commercial à moindre coût. La dévaluation française de 1982-83 peut également être
considérée comme un succès (Sachs et Wyplosz, 1986). L'instrument de taux de change
serait alors approprié si la dévaluation est accompagnée d'eorts crédibles pour corriger
les sources des déséquilibres et utilisée une fois pour toutes (Mongelli, 2002). De plus, le
taux de change peut être employé comme un instrument correcteur des divergences de
préférences de politiques économiques. Un pays peut, par exemple, par des dévaluations
répétées, atteindre un taux de chômage faible en acceptant un taux d'ination élevé (De
Grauwe, 1999). Mais ce raisonnement ne vaut que dans l'hypothèse où la courbe de Phil-
lips est stable (c'est-à-dire non aectée par les variations des anticipations d'ination).
Or, la critique monétariste soutient qu'un pays optant pour une ination trop élevée verra
sa courbe de Phillips se déplacer vers le haut. A long terme, la courbe de Phillips serait
verticale, ce qui revient à dire que les autorités n'ont plus la possibilité de choisir une
combinaison optimale entre chômage et ination. Ainsi les hypothèses qui sous-tendent la
théorie des ZMO (ecacité à long terme des ajustements de taux de change et arbitrage
entre chômage et ination) paraissent largement remises en cause aujourd'hui (voir égale-
ment Erkel-Rousse, 1997).
Plus généralement, nombreux sont les économistes pour lesquels les variations du taux
de change ne reètent pas les réponses optimales aux chocs. Les études empiriques sou-
lignent que seule une fraction de la volatilité du taux de change expliquerait les mouve-
25
Page 44

1.3. LE RÉEXAMEN DE LA THÉORIE
ments de fondamentaux, comme les chocs sur l'ore de monnaie ou la productivité17. Flood
et Rose (1995) montrent empiriquement qu'il n'y a pas de relation systématique entre le
régime de change et la volatilité des variables macroéconomiques (ore de monnaie, taux
d'intérêt, prix relatifs, réserves de change). L'instabilité des taux de change pourrait alors
provenir de défaillances des marchés nanciers internationaux (Krugman, 1989).
Ainsi, l'alternative d'un taux de change qui s'ajuste parfaitement pour répondre aux
chocs n'est peut-être pas appropriée. Comme le résument Gros et Thygesen (1998) :
would be unfair to compare EMU to an idealized world in which exchange rates are perfect
shock absorbers, since in reality [...] oating exchange rates seem to uctuate much more
than required by shocks to fundamentals
(p. 265).
Le taux de change peut être générateur de chocs
Les variations du taux de change pourraient résulter de chocs sur le marché des titres
(et non sur le marché des biens), et en particulier de modications des anticipations
concernant l'évolution du taux de change lui-même (Kenen, 2003b).
Les théories classiques tendent à considérer que le taux de change s'ajuste en réponse
aux déséquilibres du commerce. Mais si le taux de change équilibre les échanges de titres
nanciers, il sera plus volatile (beaucoup plus que ne l'est le prix des biens). Les anticipa-
tions des agents sont alors des déterminants essentiels des évolutions du taux de change.
Buiter (2000) souligne ainsi que si le taux de change suit les évolutions du marché des
it
titres, et si ces derniers sont eux-mêmes dirigés non pas par des fondamentaux mais par
des comportements moutonniers et des bulles spéculatives, alors l'ecacité de la exibi-
lité du taux de change comme instrument de stabilisation sera de fait réduite18. Le coût
de l'union monétaire pourrait ainsi être plus faible que ne le laisserait penser la théorie
des ZMO.
17
Meese et Rogo (1983) montrent que les formes réduites des modèles de taux de change les plus
courants ne permettent pas de prédire l'évolution du taux de change de façon plus satisfaisante qu'une
simple marche aléatoire, expliquant le taux de change de la période actuelle par le taux de change de la
période passée.
18
The potential advantages of nominal exchange rate exibility when a country is faced with fundamen-
tal asymmetric shocks, are dominated by its disadvantages as a source of extraneous asymmetric shocks
(Buiter, 2000, p. 33-34).
26
Page 45

1.3. LE RÉEXAMEN DE LA THÉORIE
Le taux de change n'est pas toujours une stratégie de stabilisation viable
Un courant récent de la littérature sur le choix des régimes de change tend à montrer
que les pays émergents ou en développement stabilisent leur taux de change beaucoup plus
que ne le font les pays développés (Calvo et Reinhart, 2002) et qu'il existe un décalage
entre les régimes de change annoncés (
C÷uré, 2000; Reinhart et Rogo, 2002 ; Rogo
2005). On observe ainsi, même dans les pays qui annoncent un régime de change exible,
une faible volatilité des taux de change par rapport au taux de change dollar/yen ou
dollar/deutschmark, et une forte volatilité des réserves de change et de taux d'intérêt qui
reètent des politiques délibérées de stabilisation du taux de change (Calvo et Reinhart,
2002). Contrairement aux grandes économies, le taux d'intérêt n'est pas xé en rapport
avec les objectifs internes, mais de façon à stabiliser le taux de change, et la politique
monétaire est alors largement pro-cyclique (Hausmann
volatilité du cours des matières premières plus forte que celle du taux de change, ce qui
suggère que même les pays en change exible n'utilisent pas cet instrument pour ajuster
l'économie face aux chocs de termes de l'échange. Il y aurait alors une peur du ottement
(
fear of oating
facteurs. Tout d'abord, le manque de crédibilité pourrait rendre la xité du taux de change
) qui pourrait, selon Calvo et Reinhart (2002), s'expliquer par plusieurs
de jure
) et eectifs (
et al.
, 2003; Levy-Yeyati et Sturzenegger,
et al.
de facto
, 1999). De plus, on note une
) (Bénassy-Quéré et
souhaitable car elle permettrait d'ancrer les anticipations. A l'inverse, un régime ottant
entraînerait des taux d'intérêt nominaux et réels trop élevés. D'autres facteurs peuvent
s'ajouter à ce manque de crédibilité : l'existence d'une dollarisation
coûteuse toute dépréciation de la monnaie ; des restrictions sur les marchés du crédit
associée à l'instabilité du taux de change; un eet récessif plus important de la volatilité
du taux de change sur le commerce à cause des possibilités réduites de couverture contre
le risque de change; un degré plus élevé de transmission des variations du taux de change
aux prix dans les pays émergents.
Cette crainte du ottement pourrait également s'expliquer par un péché originel (
ginal sin
En eet, à cause de l'incapacité d'emprunt à long terme dans la monnaie locale, la dette
) lié à l'incomplétude des marchés nanciers (Eichengreen et Hausmann, 1999).
27
de facto
qui rend
ori-
Page 46

1.3. LE RÉEXAMEN DE LA THÉORIE
extérieure des pays émergents est majoritairement libellée en monnaie étrangère (dollars).
Cette caractéristique peut produire une discordance de devises (
currency mismatch
-
projets nancés en dollar mais qui génèrent des ux de revenu en monnaie locale) ou
d'échéances (
maturity mismatch
- projets de long terme nancés par des prêts de court
terme), qui créent une forme de fragilité nancière, puisque les agents ne peuvent se cou-
vrir contre ce type de risque. Laisser otter le taux de change serait alors contre-productif
pour ces pays.
Le taux de change peut même être un instrument dangereux
La théorie des ZMO se place dans le cadre d'une absence de mobilité du capital. Cette
hypothèse semble peu réaliste aujourd'hui et cette nouvelle caractéristique a des consé-
quences importantes. Ainsi, selon le principe du triangle d'incompatibilité de Mundell, on
ne peut pas combiner des changes xes, une parfaite mobilité des capitaux et une politique
monétaire autonome19. Dans un contexte de forte mobilité des capitaux, un pays ne peut
donc pas avoir à la fois un taux de change stable et une politique monétaire indépendante.
Cette contrainte se fait d'autant plus sentir que les crises de change se sont multipliées ces
dernières années : crise du Système monétaire européen (SME) en 1992-1993, crise mexi-
caine de 1994-1995, crise asiatique de 1997-1998, et plus récemment crises russe (1998) et
brésilienne (1999). Le débat sur le choix d'un régime de change a alors considérablement
évolué avec la conviction de nombreux économistes que ces crises étaient dues en partie
au régime de change choisi par ces pays (Begg
et al.
, 2002).
Diérents modèles théoriques ont été développés montrant que des crises de change
peuvent et ont toutes les chances de se produire dans des pays qui adoptent un régime de
change xe et ajustable. Une première génération de modèles (dits classiques) suppose
que des crises de change surviennent lorsque les autorités poursuivent des politiques éco-
nomiques incompatibles avec le maintien d'un régime de change xe. L'idée est simple :
19
Dans le modèle Mundell-Fleming, en change xe et lorsque la mobilité des capitaux est parfaite, une
politique monétaire expansionniste produit un excès d'ore de monnaie et une baisse des taux d'intérêt
qui tendent à déprécier la monnaie. Pour lutter contre cette dépréciation et maintenir le taux de change
xe, les autorités monétaires doivent racheter la monnaie nationale et vendre des réserves de change, ce
qui annule la stimulation monétaire initiale.
28
Page 47

1.3. LE RÉEXAMEN DE LA THÉORIE
si un pays conduit une politique monétaire expansionniste qui mène à des réductions de
réserves de change, il s'expose à une attaque spéculative qui se produira avant que les
réserves ne soient épuisées. En eet, les agents voudront éviter une baisse de la valeur
en monnaie étrangère de leurs titres en monnaie domestique et l'attaque spéculative aura
donc lieu avant que l'épuisement des réserves n'entraîne une dévaluation de la monnaie.
A la suite des crises de change du SME en 1992-93, des modèles dits de deuxième géné-
ration ont été développés montrant qu'une crise de change peut survenir même lorsque les
fondamentaux sont bons. Cette approche des crises de change avec clause de sortie part
de l'hypothèse que le gouvernement décide ou non de rester en change xe en comparant
les coûts et bénéces d'un tel régime (dépendant eux-mêmes des conditions macroécono-
miques). Dans ce cadre, une crise de change peut se produire si les agents croient que le
gouvernement sera incité à sortir du régime, c'est-à-dire à dévaluer la monnaie. La spé-
culation devient alors auto-réalisatrice, puisque ces anticipations vont accroître le coût du
régime de change xe (
le gouvernement à dévaluer, validant
via
une augmentation des taux d'intérêt) et peuvent donc conduire
ex post
les anticipations des agents. Ce type de mo-
dèles fait généralement apparaître des équilibres multiples en fonction de la valeur des
fondamentaux.
Ainsi, dans un monde caractérisé par une forte mobilité des capitaux, le régime de
change xe et ajustable serait insoutenable. Les seuls régimes de change viables à long
terme sont alors le régime de change ottant et le régime de change strictement xe (caisse
d'émission -
currency board
ou dollarisation) (voir par exemple Obstfeld et Rogo, 1995a;
Eichengreen, 1998; Fischer, 2001). Cette approche, qualiée de vision bipolaire ou encore
d'approche par les solutions en coin, contribue largement à réhabiliter les unions moné-
taires au-delà des coûts qu'elles pourraient engendrer20.
La théorie des ZMO s'est principalement intéressée aux coûts de l'union monétaire liés
20
Notons toutefois que cette vision bipolaire aurait peu de fondements théoriques (Frankel, Schmukler
et Servén, 2000; Bénassy-Quéré et C÷uré, 2002). Elle ne semble pas non plus être appliquée dans les faits,
puisqu'il n'y a pas de tendance au ottement généralisé et de nombreux régimes intermédiaires subsistent
(Bénassy-Quéré et C÷uré, 2000).
29
Page 48

1.3. LE RÉEXAMEN DE LA THÉORIE
à la perte de l'instrument de taux de change. Or, conserver cet instrument ne servirait à
rien pour la plupart des pays émergents, car d'ores et déjà, il ne peut être utilisé comme
moyen d'ajustement aux chocs21. De plus, adopter un régime de change xe pourrait
même s'avérer dangereux, car il conduirait irrémédiablement à des crises de change. Ces
analyses tendent donc à relativiser les coûts de l'union monétaire par rapport aux régimes
de change xe ou exible. Par ailleurs, la théorie des ZMO donne trop peu de place
aux bénéces de l'union monétaire, le seul envisagé étant l'élimination de certains coûts
de transaction (Beine, 1999)22. De ce fait, elle ne peut être considérée comme un cadre
complet d'analyse des coûts et avantages de l'UEM (Commission européenne 1990, p. 48).
La principale raison de ce déséquilibre résiderait dans le fait que les coûts peuvent être plus
facilement évalués car ils s'appuient sur la théorie macroéconomique, alors que l'analyse
des bénéces traditionnels de l'union monétaire fait appel à deux domaines séparés de
la théorie économique : la microéconomie et la théorie monétaire (Pisani-Ferry, 1999).
Dans la suite de ce chapitre, nous mettons en avant deux autres avantages de l'union
monétaire de nature macroéconomique qui sont moins étudiés dans la littérature : la
crédibilité de la politique monétaire et l'élimination des comportements non coopératifs
de type dépréciation compétitive.
Enn, la théorie des ZMO raisonne généralement dans un cadre limité à deux pays
et fait peu référence aux relations entre pays membres et non-membres (Ricci, 1997). La
prise en compte de ces interdépendances permet de mettre en avant une autre question
importante liée aux enjeux de l'union monétaire : celle de l'élargissement et de la stabilité
de l'union monétaire. Dans la section suivante, nous présentons le cadre d'analyse qui
permet d'étudier cette question et ses principales conclusions.
21
Calvo et Reinhart (2001) notent ainsi que :
on closer examination. The extra degrees of freedom provided by exchange-rate exibility are fallacious or
can be substituted by scal policy
22
La réduction de l'incertitude sur le taux de change est parfois citée comme un autre avantage de
l'union monétaire. Mais, là encore, cet eet ne concerne pas spéciquement l'union monétaire et s'insère
dans le débat plus général sur les mérites des régimes de change xe et ottant (voir chapitre 1).
(p. 47).
much of the glitter of exible exchange rates disappears
30
Page 49

1.4. LA STABILITÉ DE L'UNION MONÉTAIRE
1.4 La stabilité de l'union monétaire
De nombreux travaux ont mis l'accent sur l'existence d'interdépendances entre pays
qui se matérialisent par des externalités dans les réponses de politiques économiques aux
chocs (voir par exemple Hamada, 1976 ; Currie, 1993). Dans ce cadre, l'union monétaire
peut apparaître comme bénéque dans la mesure où elle conduit à centraliser les décisions
de politique monétaire. Qu'en est-il plus précisément ?
1.4.1 La coordination internationale des politiques
Interdépendances et gains de coordination
L'existence d'externalités peut produire un conit d'intérêt qui génère des ineciences
et donc un équilibre sous-optimal. La coordination des politiques permet de prendre en
compte ces externalités et donc de parvenir en général à un bien-être supérieur pour
l'ensemble des pays (Meyer
et al.
, 2002). On distingue souvent le concept de coopération de
celui de coordination (voir Canzoneri et Henderson, 1991, pp. 3-4 ; Loisel et Martin, 2001).
Dans le cas de la coopération, les gouvernements minimisent ensemble une fonction de
perte commune et acceptent donc une perte de souveraineté. Un dispositif doit permettre
aux gouvernements de s'engager ensemble, par exemple
via
une institution supra-nationale
comme dans l'UEM. Dans le cas de la coordination, les gouvernements s'accordent sur un
objectif commun (correspondant à une situation d'équilibre), mais il n'y a pas perte de
souveraineté et chaque pays minimise sa fonction de perte individuelle. L'importance de
la coordination des politiques macroéconomiques trouve une bonne illustration dans la
politique de désination du début des années 1980 (Krugman et Obstfeld, 2003). Les pays
industrialisés espéraient réduire l'ination grâce à des politiques monétaires restrictives.
Mais à cause de l'impact des taux de change sur le niveau des prix23, les politiques menées
ont été excessivement restrictives, ce qui a nalement provoqué une récession mondiale.
Tous les pays se sont alors trouvés dans une situation sous-optimale, mais aucun n'aurait
23
Une politique monétaire moins restrictive dans un pays entraîne une dépréciation de sa monnaie qui
accroît la valeur des importations et donc s'oppose à la baisse des prix.
31
Page 50

1.4. LA STABILITÉ DE L'UNION MONÉTAIRE
eu intérêt à mettre en ÷uvre une politique diérente, étant donné les choix des autres
pays24.
Il n'y a pas réellement d'accord sur la mesure quantitative de ces gains de coordination.
On cite généralement le résultat obtenu par Oudiz et Sachs (1984) selon lequel les gains
de coordination représenteraient chaque année environ entre
1
et 1% du PNB25. Cet ordre
2
de grandeur est généralement jugé faible (notamment au regard de la taille des chocs).
Cependant, d'autres études montrent des gains de coordination signicatifs, ce qui conduit
Meyer
et al.
(2002) à conclure que le débat est loin d'être tranché (voir également Currie,
1993 ; Debrun, Masson et Patillo, 2003).
Externalité et union monétaire
Le signe de ces externalités semble primordial, dans le sens où il conditionnerait en
grande partie les résultats obtenus26. Dans la littérature portant sur l'intégration mo-
nétaire, l'existence d'externalités
négatives
est généralement justiée soit par l'argument
de dépréciation compétitive (lorsque l'objectif est l'emploi), soit par celui d'appréciation
compétitive (lorsque l'objectif est l'ination). Dans le premier cas, une dépréciation de
la monnaie domestique dans un pays y accroît l'emploi et l'ination mais a des eets
inverses sur l'autre pays. Chacun peut alors être tenté de provoquer une dépréciation sur-
prise pour accroître son niveau d'emploi au détriment de l'autre. Mais si les deux pays
agissent de même, cette politique de dépréciation compétitive va se révéler inecace en
termes d'emploi et coûteuse en termes d'ination. Martin (1995, 1996) introduit ces ex-
ternalités du côté de l'ore : si les investisseurs préfèrent s'implanter dans les pays qui
sont les plus compétitifs,
i.e.
ceux qui parviennent à maintenir des salaires réels faibles,
une politique monétaire expansionniste dans un pays aura des eets récessifs sur les autres
24
Cette situation peut se modéliser en théorie des jeux comme un dilemme du prisonnier.
25
Ce résultat est obtenu à partir de modèles économétriques de grande ampleur et porte sur trois pays
industrialisés (les Etats-Unis, l'Allemagne et le Japon).
26
Dans sa discussion de l'article Frenkel et Razin (1985), Matthew Canzoneri souligne :
that the rst order of business in policy coordination research is to achieve some sort of consensus on the
sign and symetry of policy spillover eects. I suspect that the assumption made in this regard are far more
important than distinctions between utility functions and game theoretic solution concepts that dominate
much of our present discussion
(p. 75) (voir également Baudry, Cahuc et Kempf, 2000).
I would suggest
32
Page 51

1.4. LA STABILITÉ DE L'UNION MONÉTAIRE
pays. D'autres modèles sont centrés sur l'ination (Canzoneri et Henderson, 1991 ; Buiter,
Corsetti et Pesenti, 1995 ; Kohler, 2002). Ils supposent que les pays sont incités à me-
ner des politiques monétaires plus restrictives que les autres pour réduire le prix de leurs
importations et leur ination aux dépens des autres pays.
L'union monétaire devrait permettre de faire cesser les comportements non coopéra-
tifs, et générer des hausses de bien-être dans les pays membres grâce à l'internalisation
des externalités (Persson et Tabellini, 2000). Mais ce résultat est généralement dérivé de
modèles à deux pays qui ne considèrent que deux congurations possibles : la coopération
globale (l'union monétaire) et l'absence de coopération (le régime de change exible). Dès
lors que l'on introduit un troisième pays, la coopération partielle (entre deux des trois
pays) devient possible et les conclusions obtenues dièrent. En eet, la mise en place
d'une union monétaire entre deux pays inuence la position du pays non membre, et la
politique qu'il adopte aecte, en conséquence, le bien-être des pays membres. Dans le cas
où les externalités entre les pays membres sont de signe négatif, la formation de l'union
monétaire pourrait exercer des externalités
positives
sur le pays non membre27. La poli-
tique conduite par ce pays serait alors susceptible d'entraîner une dégradation du bien-être
des pays membres et de réduire les avantages de la coopération (Canzoneri et Henderson,
1991, ch. 3).
Ces résultats peuvent être rapprochés des travaux relatifs à l'incohérence temporelle
de la politique monétaire (voir encadré 1,
infra
), puisque l'interaction stratégique peut se
situer aussi bien sur le plan interne (entre le secteur privé et les autorités monétaires) que
sur le plan externe (entre les autorités monétaires de diérents pays) (Barre, 2001). La
coopération permet-elle de résoudre ce conit interne ou, au contraire, le renforce-t-elle ?
Rogo (1985b) montre que celle-ci peut s'avérer contre-productive lorsque la politique
monétaire présente une incohérence temporelle, dans la mesure où elle élimine l'eet de
discipline que le régime de change exible exerce sur les banques centrales. En eet, les
gouvernements qui ne coopèrent pas verront un coût supplémentaire dans l'adoption d'une
27
Dans le modèle de Canzoneri et Henderson (1991) par exemple, la politique monétaire au sein de
l'union monétaire est moins restrictive (par comparaison avec un régime de change exible), ce qui bénécie
aussi au pays non membre qui peut augmenter son niveau d'emploi sans accroître davantage l'ination.
33
Page 52

1.4. LA STABILITÉ DE L'UNION MONÉTAIRE
politique monétaire expansionniste, puisqu'un accroissement de la masse monétaire pro-
duit une dépréciation du taux de change qui se traduit par de l'ination (
tion du prix des biens importés). Dans ce type de modèle, le régime coopératif présente
donc un biais inationniste plus important que le régime non coopératif, et conduit à un
bien-être inférieur.
Pour étudier les enjeux de l'union monétaire, il paraît donc essentiel de mieux com-
prendre les interactions entre l'union monétaire et les pays non-membres puisque, suivant
leur nature, elles pourraient modier de façon importante les résultats. Lorsque la forma-
tion de l'union monétaire exerce des externalités positives sur (le ou) les pays non-membres,
il est possible d'expliquer, même dans un cadre parfaitement symétrique, pourquoi cer-
tains souhaitent rester en dehors de l'union monétaire, puisqu'ils en tirent prot sans en
payer le coût. Ces comportements peuvent s'apparenter à des comportements de passager
clandestin (
être étudiée dans le cadre de la théorie de la formation endogène des coalitions.
free-riding
) et posent la question de la stabilité de l'union monétaire qui peut
via
l'augmenta-
1.4.2 La formation endogène des coalitions
La littérature sur la formation des coalitions (
essor important ces dernières années (voir Bloch, 1997, pour une revue de la littérature).
Ce cadre théorique trouve de nombreuses applications en particulier dans le domaine de
l'environnement (Carraro, 2005, par exemple). Il a également été utilisé (mais plus ra-
rement) pour étudier la mise en place d'accords de commerce et d'accords monétaires.
Sa véritable innovation consiste à mettre l'accent sur la stabilité des équilibres, et non
plus seulement sur leur ecience (Espinosa-Vega et Yip, 1994). En eet, les modèles
traditionnels de coordination (Canzoneri et Henderson, 1991, par exemple) n'abordent gé-
néralement pas la question de la stabilité, puisqu'ils comparent le bien-être d'un pays dans
une situation (par exemple dans l'équilibre non coopératif) à celui d'un
est dans une autre situation (équilibre coopératif ou coopération partielle) alors qu'étu-
dier la stabilité nécessite de comparer pour un
coalition formation theory
même
pays les deux pôles d'une alternative.
) connaît un
autre
pays qui
34
Page 53

1.4. LA STABILITÉ DE L'UNION MONÉTAIRE
La formation endogène des coalitions est généralement modélisée comme un jeu en
deux étapes et se résout de façon récursive. Les coalitions se forment dans une première
étape, puis, dans une seconde étape, s'engagent dans un jeu non coopératif en prenant
comme donnée la structure de coalitions (Yi, 1997). Cette seconde étape du jeu est géné-
ralement modélisée grâce à une fonction de partition qui assigne à chaque coalition une
valeur qui est fonction de l'ensemble de la structure de coalition. Dans la première étape,
la stabilité d'un équilibre est caractérisée par une double condition relative à sa stabilité
interne et externe. Ce concept de stabilité est emprunté à la théorie des cartels (voir D'As-
premont
les membres de la coalition (
tion de stabilité externe présume que les pays non-membres (
à y entrer. Certains auteurs ajoutent une troisième condition (dite de
et al.
, 1983). Énoncée simplement, la condition de stabilité interne28suppose que
insiders
) ne sont pas incités à la quitter, tandis que la condi-
outsiders
) ne sont pas incités
protabilité
) selon
laquelle la coalition serait préférable à l'équilibre non coopératif, c'est-à-dire que s'il y a
coalition, les gains des pays membres sont supérieurs à ce qu'ils obtiendraient en l'absence
de coalition.
Ce cadre d'analyse peut être appliqué pour analyser la stabilité des unions monétaires.
Même s'il ne fait pas référence à ces conditions de stabilité, Martin (1995, 1996) étudie des
questions similaires. Dans un cadre à trois pays, Martin (1996) prend en compte à la fois
les problèmes de crédibilité et les eets externes caractéristiques de la politique monétaire
et met l'accent sur les coûts associés à l'exclusion de certains pays de l'union monétaire.
Il montre que la création de l'union monétaire a des eets positifs pour les pays exclus qui
pourront proter de la discipline au sein de l'union pour mettre en ÷uvre une politique
plus active s'apparentant à une stratégie de dépréciation compétitive. L'exclusion de pays
constitue alors un coût pour l'union monétaire. A partir du même modèle mais spécié
de manière dynamique, Martin (1995) résume les dangers d'une unication monétaire
à deux vitesses29: les pays à faible ination peuvent vouloir retarder l'entrée des pays
28
Cette condition est parfois appelée condition de stabilité autonome (
29
Cet article se situe dans le cadre du débat qui, après le traité de Maastricht, opposait d'une part ceux
stand-alone stability
, Yi, 1997).
35
Page 54

1.4. LA STABILITÉ DE L'UNION MONÉTAIRE
à plus forte ination dans l'union, mais ces derniers risquent de refuser d'y entrer, une
fois le processus de convergence achevé, car ils bénécieront d'une marge de man÷uvre
supplémentaire dans la conduite de leur politique. Il existe donc un arbitrage entre la
nécessité de convergence et le risque de comportement de
free-riding
.
A partir du modèle de Canzoneri et Henderson (1991) étendu ànpays, Kohler (2002)
étudie les conditions de stabilité interne et externe des coalitions suivant leur taille. Une
coalition est dénie comme un sous-ensemble de pays qui minimise une fonction de perte
commune. Dans ce type de modèle, l'équilibre non coopératif (équilibre de Nash) est in-
ecient car, à la suite d'un choc négatif, chaque pays est incité à exporter de l'ination
via
une appréciation de son taux de change (voir
supra
). L'unique gain de l'union moné-
taire réside alors dans l'internalisation de ces externalités, qui se traduit au nal par une
politique moins déationniste puisque les pays membres ne s'engagent pas dans une guer-
re d'appréciations compétitives. Malgré l'absence d'asymétrie dans le modèle et donc du
principal coût de l'union monétaire30, Kohler montre que la grande coalition (
i.e.
l'union
monétaire comprenant tous les pays) n'est pas un équilibre stable. En eet, dans ce mo-
dèle, les pays non-membres bénécient du taux d'ination plus faible qui prévaut dans
l'union monétaire pour mettre en ÷uvre une stratégie oensive d'appréciation du taux de
change; ils adoptent alors un comportement de passager clandestin. La seule conguration
stable est l'union monétaire partielle. D'après les simulations eectuées par Kohler (2002),
celle-ci comporterait trois pays.
Laskar (1996) précise cette notion de
free-riding
dans un modèle à trois pays. Ce terme
recouvrirait en fait trois réalités diérentes. Dans le premier cas, les pays non-membres
bénécient du fait que les autres coopèrent31. Dans le deuxième, le gain du pays non
pour qui la réalisation de l'union monétaire européenne en plusieurs étapes se justiait par la convergence
insusante entre les pays du sud de l'Europe (Espagne, Italie, Portugal notamment) et ceux du centre,
moins inationnistes (l'Allemagne en particulier) et d'autre part, ceux pour qui ce schéma était risqué
dans la mesure où il pouvait entraîner un blocage du processus d'intégration (voir également Alesina et
Grilli, 1994).
30
Dans ce cadre totalement symétrique, le coût de l'union monétaire lié à l'asymétrie des chocs n'est
pas pris en compte.
31
Plus formellement, cette condition indique que le gain d'un
deux autres pays se coordonnent et jouent non coopérativement contre l'
Nash-coordination) qu'à l'équilibre de Nash.
outsider
est plus grand à l'équilibre lorsque
outsider
(appelé équilibre de
36
Page 55

1.4. LA STABILITÉ DE L'UNION MONÉTAIRE
membre de l'union monétaire partielle est supérieur à celui des pays membres. Enn, un
troisième type possible de
free-riding
apparaît lorsque les pays préfèrent être en dehors
d'une union monétaire partielle plutôt que de participer à une union monétaire globale32.
Cette troisième condition semble être déterminante puisque, dès qu'elle n'est plus vériée,
la grande coalition est l'unique équilibre stable du jeu (Lenoble-Liaud, 2001). Dans le
modèle de Kohler (2002), les trois formes de
free-riding
sont présentes. Or, la seconde
s'oppose à la condition de protabilité énoncée plus haut. Ainsi, dans ce modèle, même
si
insidersetoutsiders
chacun est incité à rester
quelle que soit la taille de l'union, le gain d'un
ont intérêt à ce que l'union existe (et comporte trois membres),
outsider
(et à ce que d'autres créent l'union monétaire) puisque,
outsider
est supérieur à celui d'un pays
membre. Autrement dit, le processus de formation de la coalition sera entravé par le
fait que tous les pays auront intérêt à attendre que d'autres forment l'union monétaire
(Kohler, 2002). Dans le modèle de Martin (1996) à trois pays identiques, la première
condition de
free-riding
est toujours remplie, tandis que les deux autres ne le sont pas
nécessairement. On peut alors montrer que s'il y a coordination partielle, le bien-être de
l'
outsider
augmente s'il entre dans l'union monétaire (formant ainsi une union monétaire
globale). La grande coalition est alors le seul équilibre stable du jeu. L'ajout d'un pays
supplémentaire modie ces conclusions puisque, dans ce cas, il n'y a plus un seul, mais
plusieurs
outsiders
potentiels (voir
infra
et le modèle décrit en annexe).
Dans un cadre plus général, il est possible que plusieurs coalitions se mettent en place.
On peut ainsi envisager le cas d'un pays extérieur qui a le choix entre adhérer à une gran-
de union monétaire, former une autre union monétaire, ou rester
outsider
. Dans ce cadre,
la formation de deux unions monétaires de plus petite taille est généralement préférée
à une seule union de plus grande taille (voir Kohler, 2004). Ce résultat est ici aussi lié
aux externalités positives exercées par la formation de la coalition sur les
génèrent des comportements de
free-riding
et rendent instable la grande coalition. Notons
outsiders
qui
que l'existence possible de diérentes coalitions accroît le nombre de conditions nécessaires
pour dénir la stabilité de l'équilibre. Carraro (2005) dénit les conditions de stabilité dans
32
Le gain d'un
outsider
est alors plus élevé à l'équilibre de Nash-coordination qu'à l'équilibre coordonné.
37
Page 56

1.4. LA STABILITÉ DE L'UNION MONÉTAIRE
le cas plus général où il y akcoalitions possibles. Pour chaque coalition, la stabilité est
assurée si sont remplies des conditions de stabilité interne, externe et
intra-coalition
. Cette
dernière condition stipule qu'aucun des joueurs n'a intérêt à quitter une coalition pour
entrer dans une autre.
Dans l'annexe de ce chapitre, nous étendons le modèle de Martin (1996) à quatre pays
identiques an d'analyser les interdépendances entre les membres d'une union monétaire
et plusieurs pays non-membres tout en gardant une structure la plus simple possible.
Ce cadre théorique permet d'étudier et de comparer plusieurs congurations : l'union
monétaire globale, le régime de change exible, l'union monétaire partielle à deux pays,
celle à trois pays, et la conguration avec deux unions monétaires. Il a deux avantages par
rapport au modèle utilisé par Kohler (2002). Tout d'abord, il est plus simple et permet
d'obtenir certains résultats de façon analytique, alors que les principales conclusions de
Kohler sont issues de simulations. Ensuite, il prend en compte un aspect important de
l'intégration monétaire qui est négligé dans la théorie des ZMO et dans le modèle de
Kohler, à savoir la crédibilité qu'elle confère aux autorités monétaires (voir encadré 1,
infra
)33.
Après une présentation du modèle théorique, nous dérivons les stratégies optimales des
pays face à un choc d'ore. Puis, nous analysons les conditions de stabilité des structures
de coalitions possibles : il en ressort alors que la structure de coalition caractérisée par
une union monétaire de taille égale à celle des
qu'il y a
tropd'outsiders
(par rapport à la taille de l'union monétaire), les bénéces tirés
outsiders
n'est pas stable. En eet, dès
d'un comportement de passager clandestin sont plus faibles. Lorsque le biais ination-
niste est élevé, ces pays sont incités à entrer dans l'union monétaire, formant ainsi une
union globale34. Par contre, s'il est faible comparé à la variance des chocs, les gains de
l'intégration monétaire sont moindres, et les pays non-membres peuvent décider de former
33
Beine (1999) souligne que : l'ignorance des considérations minimales de réputation et de crédibilité
demeure un des aspects les plus critiquables de la théorie [des ZMO] (p. 189).
34
Dans ce modèle, les pays sont identiques, donc les membres de l'union monétaire auront toujours
intérêt à les laisser entrer.
38
Page 57

1.4. LA STABILITÉ DE L'UNION MONÉTAIRE
une deuxième union monétaire ou, plus probablement, certains pourraient entrer dans
l'union tandis que les autres continueront à tirer parti de leur position d'
outsider
. Ces
premiers résultats pourraient être prolongés en introduisant des asymétries soit à partir
de la fonction de perte, soit sur les chocs35. La littérature sur la formation des coalitions
se place généralement dans un cadre parfaitement symétrique pour simplier l'analyse,
mais l'existence d'asymétries peut modier les résultats obtenus (Lenoble-Liaud, 2001).
De plus, l'introduction d'asymétries sur les chocs permettrait de prendre en compte les
coûts de l'union monétaire liés à l'hétérogénéité des pays et mis en avant dans la théorie
des ZMO. Une autre piste de recherche consisterait à remplacer le cadre théorique utilisé
ici par un modèle plus élaboré de concurrence monopolistique avec rigidités nominales.
Ce type de modèles, initié par Obstfeld et Rogo (1995b), est de plus en plus utilisé (voir
Lane, 2001, pour une revue de la littérature) et tend à remplacer les modèles macroécono-
miques traditionnels. Il permettrait par exemple de prendre en compte des paramètres-clés
comme le degré de substitution entre les biens ou le niveau d'intégration commerciale (voir
Loisel et Martin, 2001).
35
Il serait également possible d'étendre le modèle ànpays, mais les calculs sont plus lourds, et aucun
résultat ne semble pouvoir être dérivé analytiquement.
39
Page 58

1.4. LA STABILITÉ DE L'UNION MONÉTAIRE
Encadré 1
: La crédibilité de la politique monétaire
La crédibilité des politiques est revenue au premier plan avec l'attribution, en 2004,
du prix Nobel d'économie à Finn Kydland et Edward Prescott, qui montrent, dans un
article datant de 1977 (
Plan
), que beaucoup de décisions politiques sont sujettes à un problème d'incohérence
temporelle (
time inconsistency
Rules Rather than Discretion : The Inconsistency of Optimal
). Un gouvernement menant une politique qui maximise
le bien-être des citoyens choisira généralement, s'il le peut, de réviser sa politique,
suite aux anticipations des agents. Dans ce cadre, il peut rencontrer un problème de
crédibilité, puisque les agents réaliseront que la politique menée par le gouvernement
ne coïncide pas nécessairement avec celle qui a été annoncée. Appliquée à la politique
monétairea, cette incohérence temporelle se traduit généralement par l'existence d'un
biais inationniste, car une politique de faible ination n'est pas crédible (Barro et
Gordon, 1983).
Plusieurs types de solutions à ce problème sont proposés dans la littérature. Ainsi, il
est possible de contraindre la politique monétaire par des règles, en xant par exemple
un taux de croissance de la masse monétaire constant ou en liant l'augmentation de
la monnaie en circulation à l'évolution du PIB nominal. Le problème de crédibilité
peut également être résolu dans le cadre de jeux répétés (voir Barro et Gordon, 1983).
D'autres solutions reposent sur le principe de délégation : puisque les autorités d'un
pays rencontrent un problème d'incohérence temporelle, elles doivent déléguer la poli-
tique monétaire à un banquier central conservateur, qui valorise davantage l'objectif
de stabilisation de l'ination (Rogo, 1985a), ou adopter un régime de change xe ou
encore mettre en place une union monétaire.
Crédibilité et régime de change xe
Des pays inationnistes peuvent accroître leur crédibilité en ancrant leur monnaie
sur celle d'un pays-ancre jugé plus vertueux. On dit dans ce cas qu'ils importent de
la crédibilité du pays-ancre. Comme dans le cas du recours à un banquier central
conservateur proposé par Rogo (1985a), cette solution réside essentiellement dans
fait que la politique monétaire est déléguée à des autorités jugées plus crédibles. Le
régime de change xe semble préférable à d'autres solutions de délégation ou de règles
car le taux de change est un instrument facilement observable par les agents privés
(par comparaison avec la masse monétaire, par exemple) qui pourront alors vérier
l'engagement des autorités. De plus, un régime de change xe est plus crédible du fait
des coûts (notamment politiques) entraînés par une dévaluation.
a
Soulignons que le problème de l'incohérence temporelle a été également soulevé dans des modèles
s'intéressant à l'imposition du capital, ou au seigneuriage par exemple.
40
Page 59

1.4. LA STABILITÉ DE L'UNION MONÉTAIRE
Mais, on peut penser que la mise en place d'un régime de change xe a également
un impact sur les choix de politiques économiques du pays-ancre. Celui-ci pourrait
en eet inciter le pays-ancre à mener une politique plus inationniste, car le coût de
cette dernière est partagé avec les pays ayant décidé d'ancrer leur monnaie (Fratianni
et Von Hagen, 1990). L'ination dans le pays-ancre pourrait alors être supérieure à ce
qu'elle serait en change exible. Dans ces conditions, comment expliquer que ce pays
accepte de participer à tel système ? Le cadre de la théorie des jeux répétés permet
d'apporter des éléments de réponse à cette question en mettant en avant un mécanisme
de réputation. Dans son principe, ce mécanisme est similaire à celui décrit par Barro
et Gordon (1983) : s'il y a plus d'un `tour' (ou période), la pénalité imposée en cas
d'ination surprise est accrue, puisqu'elle provoque un changement des anticipations
au second tour. La mise en place d'un système de change xe permet alors de générer
des gains de crédibilité pour les pays inationnistes, sans détériorer la crédibilité du
pays moins inationniste (Von Hagen, 1992b).
Dans le cas d'un régime multilatéral dans lequel tous les pays membres participent
aux décisions, le change xe apparaît également comme une solution au problème
d'incohérence temporelle dans la mesure où il accroît les coûts associés à la mise
en place d'une politique expansionniste. En eet, si l'on suppose que le régime de
change est un système xe mais ajustable (dans lequel les réalignements consistent
à dévaluer la monnaie des pays inationnistes d'un niveau, au plus égal, à celui qui
est nécessaire pour restaurer la parité de pouvoir d'achat), une expansion monétaire
dans un pays provoquera de l'ination, qui se traduira par une appréciation réelle
et engendrera donc une perte de compétitivité jusqu'à ce que se réalise un nouveau
réalignement. Dans ce cas, l'engagement d'un maintien de la stabilité des prix peut
être crédible, car les gains obtenus lorsque les autorités xent un taux d'ination non
nul peuvent devenir inférieurs aux coûts liés à l'ination (Giavazzi et Pagano, 1988).
Ces arguments ont été développés pour expliquer les avantages que procurait le Sys-
tème monétaire européen (SME). Le SME était à la croisée des deux types de régimes
de change puisqu'il était en théorie multilatéral, mais en pratique se rapprochait plus
d'un système de change asymétriquea. Il pouvait alors être vu comme un moyen pour
des pays non crédibles de se lier les mains (Giavazzi et Pagano, 1988) et d'importer
de la crédibilité des autorités allemandes.
a
Voir Gros et Thygesen (1998) pour une discussion sur l'asymétrie du SME. Certains indicateurs
(mesurant les interventions sur le marché des changes ou le degré de stérilisation des interventions)
tendraient à montrer que l'Allemagne ait bénécié d'un rôle particulier au sein du SME, tandis que
d'autres parviennent au résultat inverse. En fait, il semble que le degré d'asymétrie ait été important
sur la période 1983-1986, mais plus faible avant 1983 et après 1987. Sans conclure à une totale
asymétrie, on peut alors dire que la politique monétaire allemande a été plus importante pour la
France ou l'Italie que
vice versa
(voir également Fratianni et Von Hagen, 1992).
41
Page 60

1.4. LA STABILITÉ DE L'UNION MONÉTAIRE
Qu'en est-il d'un point de vue quantitatif ? La désination dans les pays du SME a
été importante à partir du début des années 1980. Le taux d'ination moyen dans
la zone est ainsi passé de 11% en 1980 à 2% en 1988. Mais cette baisse globale
n'était pas exceptionnelle, comparée aux expériences des autres pays industrialisés
sur la même période. En fait, il semble que la réduction de l'ination ait été plus
marquée pour les pays membres du SME que pour les pays extérieurs à la zone, ce
qui fait dire à certains économistes que la discipline anti-inationniste du SME a
bel et bien fonctionné, du moins dans la deuxième moitié des années 1980 (Giavazzi
et Giovannini, 1989; Mélitz, 1988; Padoa-Schioppa, 1988). A l'opposé, Collins (1988)
montre, grâce à une estimation économétrique, que l'appartenance au SME n'a pas eu
d'eet résiduel sur les performances d'ination. Mais ces résultats paraissent sensibles
à l'échantillon, et notamment au groupe de pays choisis pour former le contrefactuel.
L'abandon de la souveraineté monétaire
Une question plus importante demeure. Si les autorités d'un pays ne sont pas crédibles,
pourquoi leur décision de mettre en place un régime de change xe le serait-elle ? Fi-
nalement, le problème de crédibilité se déplace seulement du choix par les autorités
monétaires du taux d'ination vers le choix d'appartenance à un système de change
xe. Les autorités du pays inationniste auront toujours intérêt à `tricher' et à dé-
valuer leur taux de change (ce qui revient à sortir du système de change xe) pour
créer de l'ination non anticipée et donc obtenir un arbitrage ination-production
plus favorable. Un régime de change xe est toujours en un sens un régime ajustable
(Krugman, 1995). Cette incitation des autorités pourrait alors être perçue par les
agents privés qui adapteront leurs anticipations en conséquence, ce qui accroîtra na-
lement l'ination sans réduire le chômage. Ainsi, le SME s'est révélé être un système
assez instable, marqué par des réalignements des parités et des entrées et sorties de
paysa.
La mise en place d'une union monétaire pourrait renforcer la crédibilité du système,
puisque dans ce cas, les parités xes sont irrévocables du fait de l'abandon de la
souveraineté monétaire. Cette caractéristique constituerait une diérence importante
entre le régime de change xe et l'union monétaire. De Grauwe (1992) écrit par
exemple :
the only viable form of a monetary union is one where a common currency
has displaced the national currencies, and where one European central bank conducts
a
Cette instabilité s'est révélée notamment lors de la crise qui a marqué les marchés des changes
européens en 1992-93 : la lire italienne et la livre sterling ont dû quitter le SME en septembre 1992
suite à des attaques spéculatives, puis, en novembre, la peseta espagnole et l'escudo portugais ont
été dévalués de 6% par rapport aux autres monnaies, suivis par la livre irlandaise en janvier 1993.
En août 1993, les marges de uctuation du SME ont été élargies à
Au total, entre 1979 et 1999, le SME a subi 16 réalignements.
+/− 15%
autour des cours-pivots.
42
Page 61

1.5. CONCLUSION
monetary policy in the union. A system where national currencies maintain their
domestic legal tender and whose exchange rates are `irrevocably xed' will suer from
a credibility problem, and therefore will not be robust in the long run
(p. 162).
Cependant, la mise en place de l'union monétaire peut également accroître l'ination
dans la zone. En eet, dans un système de type SME, les pays à tendance inationniste
sacrient implicitement l'indépendance de leur politique monétaire sans humiliation
politique, alors que dans une union monétaire, les points de vue de ces pays sont éga-
lement représentés (Krugman, 1995). Le taux d'ination pourrait alors être supérieur
(et la crédibilité du système moindre) dans une union monétaire symétrique, par rap-
port à un régime de change xe asymétrique. Cet argument est cependant contesté
car dans un système symétrique (comme l'UEM), la banque centrale pourrait être
plus disposée à combattre l'ination dans la mesure où elle répond à moins de chocs
que dans un système asymétrique (SME) (Laskar, 1991)a.
a
En eet, dans un système symétrique, puisque la banque centrale donne un poids équivalent
aux pays membres, elle n'utilisera l'instrument monétaire pour répondre aux chocs que s'ils ont une
composante symétrique, tandis que dans un système asymétrique, elle répondra à tout type de chocs
aectant le pays-ancre.
1.5 Conclusion
La théorie des Zones monétaires optimales constitue toujours la principale théorie de
l'intégration monétaire. Cette piste de recherche s'est révélée féconde, en ce sens qu'elle a
permis une première évaluation empirique de la désirabilité d'une union monétaire dans
diérentes régions du monde (Europe mais aussi Amérique latine et Asie du Sud-Est).
Mais elle a aussi montré ses limites. Comme le souligne Beine (1999), une application
directe [de la théorie des ZMO] ne permet pas de déterminer clairement le prol exact de
la ZMO européenne (p. 151). Elle ne permet, au mieux, que d'identier les pays où les
conditions sont les plus favorables à l'instauration d'une union monétaire (pays du c÷ur
par opposition à la périphérie).
Par ailleurs, cette approche n'étudie pas les questions liées à la mise en place d'une vé-
ritable union monétaire mais reste largement connée dans le débat entre changes xes
et changes exibles (Kenen, 2003c). Or l'union monétaire se diérencie d'un régime de
43
Page 62

1.5. CONCLUSION
change xe notamment par ses implications quant au domaine de la politique monétaire
(Kenen, 2002). Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous examinons deux des princi-
paux avantages de l'union monétaire relatifs à la politique monétaire : la crédibilité qu'elle
confère aux autorités monétaires et l'élimination des comportements non coopératifs de
type dépréciation compétitive. La prise en compte des interdépendances entre l'union mo-
nétaire et les partenaires extérieurs permet également de montrer que la formation d'une
union monétaire est à même d'exercer des externalités positives sur les pays non-membres
qui peuvent alors adopter un comportement de passager clandestin. Cette politique risque
de se révéler coûteuse pour les pays membres et d'entraîner une réduction de la taille de
l'union monétaire stable.
Nous tirons plusieurs enseignements de cette revue de la littérature pour les chapitres
suivants. Tout d'abord, les coûts et bénéces de l'union monétaire semblent diciles à
prendre en compte conjointement car ils sont peu comparables. Dans ce contexte, nous
nous proposons d'adopter une approche alternative dans la suite de la thèse, qui consiste
à évaluer les enjeux des unions monétaires à partir de leurs eets. Les eets des unions
monétaires sur les transactions internationales sont importants parce qu'ils conditionnent
leurs bénéces mais aussi leurs coûts. De plus, si la mise en place d'une monnaie com-
mune renforce les ux de commerce et d'investissements entre pays membres, elle pourrait
contribuer à réduire l'asymétrie des chocs au sein de la zone et à rendre viable l'union
monétaire
empirique de l'impact des unions monétaires sur le commerce (chapitres 1, 2 et 4) et
l'investissement direct étranger (chapitres 3 et 4).
De plus, il semble important de mettre l'accent sur les spécicités des unions monétaires
et sur ce qui les diérencie des autres régimes de change (en particulier du régime de
ex post
(Frankel et Rose, 1996). Les chapitres suivants portent sur l'évaluation
change xe). Enn, nous porterons une attention toute particulière aux interdépendances
entre l'union monétaire et ses partenaires extérieurs. Nous tenterons de comprendre, pour
certains aspects en particuliers, dans quelle mesure la formation de l'union monétaire
inuence les pays non-membres.
44
Page 63

1.6. ANNEXE : LA STABILITÉ DANS UN MODÈLE THÉORIQUE SIMPLE
1.6 Annexe : la stabilité dans un modèle théorique simple
Nous reprenons ici la structure du modèle de Martin (1996), lui-même dérivé du modèle
de Barro et Gordon (1983). Ce modèle est simple mais il permet d'illustrer les problèmes
qui peuvent se poser dès lors que l'on envisage la question de l'élargissement d'une union
monétaire. Par ailleurs, il introduit la question de l'incohérence temporelle des politiques
monétaires qui est au centre du débat sur les enjeux de l'union monétaire, mais n'est
pas prise en compte dans les modèles traditionnels, comme celui utilisé par Kohler (2002,
2004). Nous étendons ce modèle à quatre pays, supposés identiques.
Dans ce modèle, les autorités monétaires du paysiminimisent une fonction de perte
quadratique de la forme :
1
Li=
2
1
2
π
+
β(yi− ¯y)
i
2
2
(1.1)
oùyest la production etπle taux d'ination. Le paramètreβreprésente le poids relatif
accordé à l'objectif de production (¯y) par rapport à celui de stabilité des prix36. Tous les
pays produisent le même bien et on suppose que l'ore du paysia la forme suivante :
3
X
yi= (pi− wi) −
1
(pj− wj) + ²
3
j=1
(1.2)
oùwest le log du salaire,pest le log des prix et²un choc de productivité commun à tous
les pays, qui suit une loi normale de moyenne nulle et d'écart type
σ². On suppose, comme
dans les modèles à la Barro Gordon, que les autorités xent l'ination après que les salariés
eurent formé leurs anticipations d'ination, et après avoir observé le choc. Mais, à cause
de l'existence de contrats, le choc n'est pas pris en compte par les salariés au moment de
la détermination des salaires. Ceux-ci xent alors le salaire nominal au niveau des prix
e
j
e
)
i
e
). On obtient nalement37:
i
) + ²
.
(1.3)
anticipés pour minimiser les variations de salaire réel (
3
X
1
e
i
e
) −
i
− p
3
j=1
) = (pi− p
i,t−1
yi= (πi− π
36
Pour simplier nous supposerons que l'objectif de production est identique dans tous les pays.
37
Notons que :
πi− π
e
= (pi− p
i
i,t−1
) − (p
wi= p
(πj− π
45
Page 64

1.6. ANNEXE : LA STABILITÉ DANS UN MODÈLE THÉORIQUE SIMPLE
Le premier terme est classique dans les modèles de type Barro-Gordon, et montre
qu'il est possible d'accroître l'activité en créant des surprises d'ination. Le second terme
est relatif au cadre de l'économie ouverte et représente les interactions stratégiques entre
pays. Dans ce modèle, les externalités négatives se traduisent par une concurrence entre
pays pour attirer la production et l'emploi. Martin illustre ces interactions en prenant
l'exemple de rmes multinationales qui ont des usines dans tous les pays, et doivent dé-
cider en fonction du niveau du salaire réel d'augmenter ou de diminuer l'emploi et la
production. Chaque pays a alors intérêt à avoir un salaire réel plus faible, et donc un
écart d'ination par rapport à l'ination anticipée plus important que celui des autres
pays. Comme il est expliqué dans Martin (1995) (note 6 p. 1350) et Martin (1998), les
coecients de l'équation (1.3) correspondent à la taille relative des pays, et sont choisis de
façon à ce que le niveau de production mondiale ne dépende pas du salaire réel (la courbe
de Phillips est verticale au niveau mondial)38.
A partir de ce cadre théorique, nous nous proposons d'étudier trois régimes moné-
taires : le régime de change exible dans lequel les autorités monétaires de chaque pays
choisissent leur taux d'ination en prenant comme donnée la politique monétaire suivie
par les autres pays; l'union monétaire globale dans laquelle les autorités xent un taux
d'ination de manière à minimiser une fonction de perte commune; l'union monétaire
partielle dans laquelle un sous-ensemble de pays forment une union monétaire qui adopte
un taux de change exible vis-à-vis des pays non-membres.
Le jeu de formation des coalitions se résout de façon récursive : il faut tout d'abord
déterminer les stratégies optimales et l'équilibre en prenant comme donnée la structure
de coalition (seconde étape du jeu), avant d'étudier la stabilité des diérentes structures
de coalition (première étape du jeu).
38
Dans le cas à N pays ou régions identiques, la fonction d'ore devient (voir Martin, 1998) :
yi= (pi− wi) −
1
N−1
P
N
(pj− wj) + ²
j6=i
.
46
Page 65

1.6. ANNEXE : LA STABILITÉ DANS UN MODÈLE THÉORIQUE SIMPLE
Les stratégies optimales et l'équilibre
Dans un modèle à quatre pays, il existe cinq structures de coalition possibles : le régime
de change exible (FER), l'union monétaire globale (GUM), l'union monétaire à trois pays
et un pays non membre (LUM), l'union monétaire à deux pays et deux pays non-membres
(PUM) et la double union monétaire (DUM). Nous étudions ces cinq cas successivement.
Le régime de change exible (FER)
Dans le cas d'un régime de change exible généralisé, chaque pays choisit son taux
d'ination optimale de façon à minimiser sa fonction de perte. Celle-ci est obtenue en
remplaçant (1.3) dans (1.1) :
3
Li=
1
2
1
2
π
+
β[(πi− π
i
2
e
i
) −
1
3
X
j=1
(πj− π
e
) + ² − ¯y]
j
2
(1.4)
Il prend comme donnés le taux d'ination anticipé et les taux d'ination étrangers. La
condition de premier ordre de ce programme de minimisation est alors :
3
∂L
i
= 0 ⇒ πi+ β[(πi− π
∂π
i
e
i
) −
1
3
X
j=1
(πj− π
e
) + ² − ¯y] = 0
j
(1.5)
A l'équilibre, les taux d'ination (eectifs et anticipés) sont égaux entre pays puisque les
pays sont supposés identiques. On obtient alors :
e
Et
π
= β ¯y
i
puisque l'espérance des chocs est nulle par hypothèse. En régime de change
exible, le taux d'ination anticipé (
πi= β¯y − β²
e
π
) est supérieur à0. Le régime de change exible
i
(1.6)
introduit donc un biais inationniste (représenté par le premier terme de l'équation 1.6)
car les banques centrales cherchent à atteindre le niveau de production optimal en tentant
de réduire le salaire réel au-dessous de celui des autres pays. Mais cette politique devient
inecace dès lors qu'elle est anticipée par les salariés.
47
Page 66

1.6. ANNEXE : LA STABILITÉ DANS UN MODÈLE THÉORIQUE SIMPLE
L'union monétaire globale {4,0} (GUM)
Dans le cas de l'union monétaire globale (GUM), la politique monétaire est commune
à tous les pays. Dans ce cas, il n'y a plus d'arbitrage possible entre ination et produc-
tion. La politique optimale consiste donc à ne pas réagir aux chocs. On obtient alors :
πi= π
e
i
= 0
et
yi= ²
. Ainsi, dans ce type de modèle, l'union monétaire permet à la fois
d'apporter des gains de coordination et de discipline (Martin, 1995).
L'union monétaire à trois pays {3,1} (LUM)
On suppose que le pays non membre (singleton) adopte un régime de change exible.
Les pays de l'union, eux, prennent en compte le fait qu'ils partagent leur politique mo-
nétaire (et ont donc le même taux d'ination). Si l'on représente les pays qui coopèrent
(c'est-à-dire ceux qui font partie de l'union monétaire) par l'indice [c] et le pays qui ne
coopère pas (le singleton) par l'indice [nc], la fonction d'ore d'un pays membre devient :
yc=
1
(πc− π
3
e
c
) −
1
(πnc− π
3
e
nc
) + ²
(1.7)
Sa fonction de perte est alors :
1
Lc=
2
1
2
1
β[
3
(πc− π
2
π
+
c
La condition de premier ordre donne :
A l'équilibre, on a
π
c
πc+
e
=
1
β[(πc− π
9
1
β¯y
, et :
3
e
c
πc=
e
) −
c
) − (πnc− π
1
β¯y − β²
3
9 + 12β
yc=
9 + 10β
48
1
(πnc− π
3
e
)] +
nc
3 + 4β
9 + 10β
²
e
) + ² − ¯y]
nc
1
β[² − ¯y] = 0
3
2
(1.8)
(1.9)
(1.10)
(1.11)
Page 67

1.6. ANNEXE : LA STABILITÉ DANS UN MODÈLE THÉORIQUE SIMPLE
L'ination des pays de l'union monétaire est plus faible en moyenne et moins variable qu'en
régime de change exible. En eet, on a
E(πc) =
1
β¯y < β¯y
3
et
V (πc) = β2(
3+4β
9+10β
)2σ
2
< β2σ
²
(équation 1.10 comparée à 1.6). Par contre, la production est plus instable qu'en union
monétaire globale ou en régime de change exible [
9+12β
(
9+10β
)2σ
2
²
2
> σ
] à cause de la politique
²
suivie par le singleton. En eet, pour ce pays, la fonction d'ore est :
2
²
A l'équilibre, on obtient :
ync= (πnc− π
e
π
= β¯y
nc
, et
e
) − (πc− π
nc
e
) + ²
c
(1.12)
9 + 4β
πnc= β¯y − β²
(1.13)
9 + 10β
9 + 4β
ync=
²
(1.14)
9 + 10β
La création d'une union monétaire partielle inuence la politique monétaire et la pro-
duction du singleton qui ne réagit plus de la même façon qu'en régime de change exible
généralisé. Ce résultat est courant dans la littérature sur la coordination (voir par exemple
Canzoneri et Henderson, 1991) mais il est novateur par rapport au cadre de la théorie des
ZMO. Comparé à l'union monétaire globale, la politique du singleton devient plus active
(c'est-à-dire qu'elle réagit davantage au choc). Ce résultat s'interprète en termes d'eet de
taille, le pays non membre protant de sa taille trois fois plus petite que l'union monétaire
(voir Martin, 1994). Il bénécie alors de la zone de moindre ination que constitue l'union
monétaire et a une marge de manoeuvre plus grande qui lui permet d'utiliser davantage
sa politique monétaire pour stabiliser son économie, étant donné que les pays membres
mènent une politique moins contre-cyclique. Sa production est donc plus stable qu'en ré-
gime de change exible ou en union monétaire globale. Par contre, l'ination moyenne est
la même qu'en régime de change exible car les anticipations d'ination ne sont pas mo-
diées. Par rapport aux membres de l'union monétaire, le singleton perd donc en termes
de crédibilité (les anticipations d'ination sont plus élevées) mais gagne en termes de
stabilisation de la production, lorsqu'il y a un choc commun.
49
Page 68

1.6. ANNEXE : LA STABILITÉ DANS UN MODÈLE THÉORIQUE SIMPLE
L'union monétaire à deux pays {2,1,1} (PUM)
Dans le cas où la structure de coalition est caractérisée par une union monétaire com-
posée de deux pays et deux singletons, la fonction d'ore devient :
2
yc=
2
(πc− π
3
e
c
) −
X
1
(π
3
jnc
j=1
− π
e
jnc
) + ²
(1.15)
puisque les membres de l'union prennent en compte le fait qu'ils sont deux à partager la
même politique monétaire. Parallèlement pour l'un des deux singletons (i) :
y
= (π
inc
inc
− π
e
inc
) −
2
(πc− π
3
e
c
) −
1
(π
jnc
3
− π
e
jnc
) + ²
(1.16)
Le paysia en face de lui deux pays qui ont la même politique monétaire et un autre pays
(j) extérieur à l'union monétaire. A l'équilibre, de la même façon que précédemment, on
2
obtient
e
π
=
β¯y
c
, et :
3
πc=
2
β¯y − β²
3
6 + 8β
(1.17)
9 + 10β
9 + 12β
yc=
²
(1.18)
9 + 10β
L'ination des pays membres est plus élevée en moyenne et plus variable comparée
au cas de l'union monétaire partielle à trois pays (équation 1.17 comparée à 1.10). Ce
résultat s'explique par le fait que l'union monétaire est plus petite et qu'il n'y a plus un
seul, mais deux singletons.
Pour ces pays :
e
π
= β¯y
nc
, et,
πnc= β¯y − β²
(1.19)
9 + 10β
9 + 8β
9 + 8β
ync=
²
(1.20)
9 + 10β
L'ination est donc plus variable que dans le cas où il n'y a qu'un seul singleton et la
50
Page 69

1.6. ANNEXE : LA STABILITÉ DANS UN MODÈLE THÉORIQUE SIMPLE
production plus instable.
Les deux unions monétaires {2,2} (DUM)
Si l'on considère le cas où deux unions monétaires, (
c1,
c2), chacune formée de deux
pays, est possible, alors pour les membres de la première union monétaire, par exemple,
la fonction d'ore devient :
En eet, les membres de (
y
=
(π
c
1
− π
c
1
3
c1) prennent en compte le fait que tous les deux ont la même
2
2
e
) −
c
1
(π
3
e
− π
c
2
) + ²
c
2
(1.21)
politique monétaire et que les deux autres pays ont également une politique monétaire
commune, puisqu'ils forment aussi une union monétaire. On obtient alors :
2
β¯y
, et,
3
e
π
c
1
= π
e
=
c
2
2
π
= π
c
1
=
2
β(¯y − ²)
3
c
(1.22)
Comme dans le cas de l'union monétaire globale :
y
= y
c
1
= ²
c
2
(1.23)
La comparaison des fonctions de perte
On peut maintenant calculer, pour chacune des structures de coalition possible, le
montant de la perte encourue, où plutôt l'espérance de la perte qui dépend du paramètre
β
, de l'objectif de production (¯y) et de la variance du choc (
monétaire globale (GUM) :
E(L
GUM
1
) =
β E[(² − ¯y)2]
2
51
σ²). Par exemple, pour l'union
(1.24)
Page 70

1.6. ANNEXE : LA STABILITÉ DANS UN MODÈLE THÉORIQUE SIMPLE
d'où39:
E(L
GUM
) =
1
2
β(σ
2
+ ¯y2)
²
(1.25)
L'espérance de la perte est obtenue de la même façon dans les autres cas. Ces résultats
sont reportés dans le tableau 1.1.
On remarque que l'union monétaire globale (GUM) est préférable aux unions mo-
nétaires partielles du point de vue des pays membres, dans la mesure où elle permet
d'éliminer le biais inationniste.
A contrario
, on vérie facilement que le régime de change
exible est la conguration la moins avantageuse. Entre ces extrêmes, les pays préfèrent
être membres d'une union la plus grande possible, puisqu'ils bénécient alors d'une plus
faible ination en moyenne (la perte des coalisés de LUM est inférieure à celle de PUM).
Les singletons, eux, préfèrent être les moins nombreux possibles et que l'union monétaire
soit la plus grande possible car ils protent de la plus faible ination au sein de l'union
monétaire pour avoir une politique monétaire plus active. S'ils sont plus nombreux (PUM
comparé à LUM), leur production sera plus instable. On peut également vérier que pour
chacune des structures d'union monétaire partielle, les
aux chocs mais un biais inationniste plus important que les
outsiders
ont une meilleure réponse
insiders
.
La stabilité des unions monétaires
Pour analyser la formation et l'élargissement de l'union monétaire, il faut non pas
comparer de façon statique les pertes des pays dans les cinq cas, mais dénir des conditions
de stabilité pour chaque conguration. Nous étudions successivement le cas où une seule
union monétaire est possible et le cas où deux unions peuvent être formées, puisque les
conditions de stabilité dièrent dans les deux cas (voir section 1.4.2).
Premier cas : une seule union monétaire est possible
Le tableau 1.2 récapitule les conditions de stabilité des diérentes structures de coa-
litions dans le cas où une seule union monétaire est possible. On ne considère ici que
39
On utilise la formule :
E(X2) = V (X) + E(X )2.
52
Page 71

1.6. ANNEXE : LA STABILITÉ DANS UN MODÈLE THÉORIQUE SIMPLE
)
2
+ ¯y
2
²
β(1 + β)(σ
1
2
) −
2
+ ¯y
2
²
β)(σ
4
9
β(1 +
1
2
]
2
¯y
1
9
+
2
²
σ
2
)
] −
2
+ ¯y
2
²
σ
2
)
1.1 Fonctions de perte des coalisés et des singletons
Tab.
{4,0} {3,1} {2,1,1} {2,2}
GUM LUM PUM DUM FER
3+4β
9+10β
β(9 + 4β)[(
1
2
]
2
¯y
1
9
+
2
²
σ
2
)
3+4β
9+10β
β(9 + β)[(
1
2
)
2
+ ¯y
2
²
β(σ
1
2
9+8β
9+10β
β(1 + β)[(
1
2
]
2
+ ¯y
2
²
σ
2
)
9+4β
9+10β
β(1 + β)[(
1
2
−
Coalisés
53
Singletons
Page 72

1.6. ANNEXE : LA STABILITÉ DANS UN MODÈLE THÉORIQUE SIMPLE
l'équilibre de Nash classique, où pour chaque conguration, un seul agent a la possibilité
de dévier (c'est-à-dire de sortir ou d'entrer dans l'union monétaire). Examinons brièvement
ces conditions.
Tab.
1.2 Conditions de stabilité interne et externe
GUM LUM PUM
{4,0} {3,1} {2,1,1}
Stabilité interne
Stabilité externe
L
GUM
LUM
< L
nc
− L
L
LUM
c
LUM
nc
< L
< L
P U M
nc
GUM
L
L
P U M
c
P U M
nc
< L
< L
F ER
LUM
c
Pour que l'union monétaire globale soit un équilibre stable, la condition de stabi-
lité interne sut : aucun membre ne doit être incité à quitter l'union monétaire.
Pour vérier cette condition il sut de comparer la perte d'un membre de l'union
monétaire globale et celle d'un
outsider
dans le cas {3,1} (LUM).
Pour que la structure de coalition caractérisée par une union monétaire à trois pays
et un
outsider
soit stable, les conditions de stabilité interne et externe doivent être
vériées. La première condition assure qu'aucun membre de l'union n'a intérêt à la
quitter, tandis que la seconde assure que l'
outsider
n'a pas intérêt à la rejoindre.
Pour vérier la condition de stabilité interne il faut comparer la perte d'un membre
de l'union monétaire à trois à celle d'un
vérier la condition de stabilité externe il faut comparer la perte de l'
outsider
dans le cas {2,1,1} (PUM). Pour
outsider
dans
le cas {3,1} (LUM) à celle d'un membre de l'union monétaire globale. Notons pour
la suite que cette condition est l'inverse de la condition de stabilité interne de l'union
monétaire globale.
Pour que la structure de coalition correspondant à une petite union monétaire (deux
pays) soit stable, il faut de la même façon que précédemment remplir à la fois
une condition de stabilité interne et externe. La première condition se vérie en
comparant la perte d'un membre de l'union monétaire à deux pays à celle d'un pays
dans le cas du régime de change exible généralisé. La condition de stabilité externe
54
Page 73

1.6. ANNEXE : LA STABILITÉ DANS UN MODÈLE THÉORIQUE SIMPLE
se vérie en comparant la perte d'un
outsider
dans le cas {2,1,1} (PUM) à celle d'un
membre dans le cas {3,1} (LUM). Ici encore, cette condition est exactement l'inverse
de la condition de stabilité interne dans le cas {3,1}.
En étudiant ces conditions de stabilité, nous parvenons à la proposition suivante :
Proposition 1
: la structure de coalition caractérisée par une union monétaire à deux
pays et deux singletons (PUM) n'est jamais stable.
En eet, nous avons :
E(L
P U M
nc
) =
1
β(1 + β)(
2
9 + 8β
9 + 10β
)2σ
2
+
²
1
β(1 + β)¯y
2
2
et,
E(L
LUM
c
) =
1
β(9 + β)(
2
3 + 4β
9 + 10β
)2σ
1
2
+
β(1 +
²
2
β
2
)¯y
9
(1.26)
(1.27)
Le second terme de la seconde équation est toujours inférieur au second terme de la pre-
mière équation, et il est facile de montrer que :
D'où
E(L
P U M
nc
) > E(L
LUM
)
. Comme la condition de stabilité externe de la structure de
c
(9 + β)(3 + 4β)2< (1 + β)(9 + 8β)2.
coalition {2,1,1} n'est jamais vériée, cette forme de coalition ne peut être stable40.
Corollaire 1
: Suivant les valeurs des paramètres (β,¯yet
σ²), une et une seule des struc-
tures de coalition caractérisées par une union monétaire globale ou une union monétaire
à trois pays {3,1}, sera stable.
En eet, comme la condition de stabilité de la structure de coalition {2,1,1} est l'inverse de
la condition de stabilité interne de la coalition {3,1}, cette dernière sera toujours vériée.
De plus, la condition de stabilité externe de la structure de coalition {3,1} est l'inverse de
la seule condition de stabilité de l'union monétaire globale. Par conséquent, une et une
40
Remarquons que la condition de stabilité interne par contre est toujours vériée car le régime de
change exible est instable.
55
Page 74

1.6. ANNEXE : LA STABILITÉ DANS UN MODÈLE THÉORIQUE SIMPLE
seule de ces deux structures de coalition sera stable. On a :
E(L
LUM
nc
E(L
1
) =
β¯y2(1 + β) +
2
GUM
) =
1
β¯y2+
2
1
2
1
β(1 + β)(
2
βσ
2
²
9 + 4β
9 + 10β
)2σ
(1.28)
2
²
(1.29)
Le premier terme de la seconde équation est toujours supérieur au premier terme de la
première équation, mais on peut montrer que :
l'intervalle
[0, 1]
. Donc, si (
β¯y
) est faible, alors la seule coalition stable sera (LUM). Par
(1 + β)(
9+4β
9+10β
)2< 1
pourβcompris dans
contre, s'il est élevé, la perte d'un membre de l'union monétaire globale sera plus faible que
la perte d'un
outsider
dans le cas {3,1}. Ce résultat est intuitif. En eet, dans ce modèle,
l'appartenance à une union monétaire permet de réduire le biais inationniste tandis que
le fait de rester en dehors de l'union permet de mieux contrer l'eet des chocs. Ainsi, si le
poids accordé à l'objectif d'ination (
1/β
) est élevé, le biais inationniste sera plus faible,
et les gains d'entrée dans l'union monétaire seront moindres. Le singleton pourra alors
préférer sa situation d'
outsider
dans la structure de coalition {3,1} à l'union monétaire
globale.
Deuxième cas : deux unions monétaires sont possibles
Dans le cas où deux unions monétaires sont possibles, le nombre de conditions de
stabilité est plus élevé pour les congurations intermédiaires (LUM et PUM). Toutes les
congurations possibles ainsi que les liens entre ces congurations sont représentées sur la
gure 1.1.
L'union monétaire à trois pays (LUM) est stable si trois conditions (et non plus
deux) sont réunies :
L
L
L
LUM
nc
LUM
c
LUM
c
< L
< L
< L
GUM
P U M
nc
DU M
et L
LUM
nc
> L
DU M
56
Page 75

1.6. ANNEXE : LA STABILITÉ DANS UN MODÈLE THÉORIQUE SIMPLE
Fig.
1.1 Les structures de coalitions (deuxième cas)
La première partie de la dernière condition indique qu'aucun membre de l'union à
trois pays ne doit être incité à s'engager dans une deuxième union monétaire. Mais
cette condition ne tient que si cette dernière stratégie est crédible, c'est-à-dire si
l'
outsider
de la première union accepte de former une union avec un autre pays
(c'est ce qu'indique la deuxième partie de la condition)41.
De même, l'union monétaire à deux pays (PUM) ne sera stable que si :
L
L
L
P U M
c
P U M
nc
P U M
nc
< L
< L
< L
F ER
LUM
c
DU M
La troisième condition est, cette fois, toujours vériée, car la conguration est symé-
trique : si un
41
Remarquons que la première condition, elle, est toujours vériée puisque les membres de l'union
monétaire à trois pays auront toujours intérêt à ce que l'
ce cadre symétrique, les pays membres ont toujours intérêt à ce que l'union monétaire soit la plus grande
possible.
outsider
a intérêt à former une seconde union monétaire avec l'autre
outsider
rentre dans l'union. Autrement dit, dans
57
Page 76

1.6. ANNEXE : LA STABILITÉ DANS UN MODÈLE THÉORIQUE SIMPLE
outsider
, ce dernier sera aussi gagnant, car ils sont dans la même situation.
Enn, la conguration à deux unions monétaire (DUM) sera stable si :
L
L
DU M
DU M
< L
< L
P U M
nc
LUM
c
La condition de stabilité interne devant être remplie pour que la structure de coalition
à deux unions monétaires soit stable est qu'aucun membre d'une union ne doit être
incité à se désengager de son union monétaire. S'il le fait, on est réduit au cas {2,1,1}
puisqu'il fait éclater l'union monétaire dans lequel il était. Dans un modèle à quatre
pays, il n'y a pas de condition de stabilité externe, puisqu'il n'y a pas d'
outsider
Mais intervient également une condition de stabilité intra-coalition (Carraro, 2005),
qui assure qu'aucun membre de la première union monétaire ne doit être incité à
rejoindre l'autre union monétaire, ce qui conduirait au cas {3,1} puisque l'autre
.
membre de la seconde union monétaire se retrouve seul. Les deux unions monétaires
étant équivalentes, cette condition est identique pour l'autre union monétaire, on
peut donc l'omettre.
Comme dans le cas où une seule union monétaire est possible, la structure de coalition
caractérisée par une petite union (PUM) ne sera jamais stable car elle est non stable de
façon externe (proposition 1). Par contre, les cas {3,1} et {2,2} sont indéterminés
Proposition 2
: Suivant les valeurs des paramètres (β,¯yet
σ²), la structure de coalition
a priori
caractérisée par une double union monétaire (DUM) peut être stable.
Corollaire 2
: Suivant les valeurs des paramètres (β,¯yet
σ²), si l'union monétaire globale
n'est pas stable, alors (au moins) l'une des deux structures de coalition caractérisées par
une union monétaire à trois pays (LUM) et une double union monétaire (DUM) sera stable.
.
58
Page 77

1.6. ANNEXE : LA STABILITÉ DANS UN MODÈLE THÉORIQUE SIMPLE
En eet, on peut montrer facilement que la condition de stabilité interne de la structure
de coalition à deux union monétaires est toujours vériée. Et :
E(L
LUM
c
E(L
) =
DU M
1
β¯y2(1 +
2
) =
1
β¯y2(1 +
2
1
β) +
9
1
β(9 + β)(
2
4
β) +
9
1
β(1 +
2
3 + 4β
9 + 10β
4
β)σ
9
2
²
)2σ
2
²
(1.30)
(1.31)
Le premier terme de la première équation est toujours inférieur au premier terme de la
seconde équation, mais on peut montrer que :
où
µ =
−27
128
+
9√73
128
' 0.39
4
1 +
β < (9 + β)(
9
. Si le coecientβest faible (inférieur àµ) et la variance du choc
3 + 4β
9 + 10β
)2pour β < µ
(1.32)
est grande par rapport au biais inationniste, alors la structure de coalition caractérisée
par la présence de deux unions monétaires peut être stable. Par contre, si le coecient
β
est supérieur àµ, l'union monétaire à trois pays devient préférable car la condition de
stabilité intra-coalition de la coalition DUM n'est plus respectée.
En résumé, la situation du jeu où il y a une union monétaire formée de deux pays et
deux singletons est toujours instable car elle est non stable de façon externe, tandis que les
autres cas (union monétaire globale, union monétaire à trois pays, deux unions monétaires
à deux pays) peuvent être des équilibres stables suivant les valeurs de la variance de chocs,
du niveau de production optimal et du poids relatif placé sur l'objectif de stabilisation de
la production. Si la variance des chocs est faible par rapport au biais inationniste, alors
le seul équilibre stable sera l'union monétaire globale. A l'inverse, si le biais inationniste
est faible par rapport à la variance du choc, alors l'union monétaire globale ne sera pas un
équilibre stable et la résultante du processus d'intégration monétaire sera la conguration
avec deux unions monétaires (DUM) ou une grande union monétaire (LUM). Notons enn
que ce dernier cas semble plus probable que la structure à deux unions monétaires, puisque
pour que cette dernière soit stable, une condition supplémentaire est nécessaire (
β < 0.39
59
).
Page 78

1.6. ANNEXE : LA STABILITÉ DANS UN MODÈLE THÉORIQUE SIMPLE
Ainsi, l'augmentation du nombre d'
l'union monétaire, mais aussi celui des premiers singletons car elle limite les bénéces tirés
des comportements de passager clandestin. Si l'on rend possible la formation d'une seconde
union monétaire, les résultats sont plus diciles à interpréter. Toutefois, il apparaît que
la formation d'une seconde union monétaire peut être un choix plus attractif pour les
outsiders
En eet, en formant une plus petite union monétaire, les pays peuvent tirer bénéce à la
fois de l'externalité positive produite par l'autre union monétaire et des gains de crédibilité.
devenus trop nombreux plutôt que de rentrer dans la première union monétaire.
outsiders
potentiels réduit le bien-être des pays de
Une illustration par des simulations
Nous réalisons des simulations numériques pour illustrer les principaux résultats du
modèle. Nous considérons plusieurs valeurs possibles pour les paramètres du modèle (β,
σ
et¯y). Les résultats de ces simulations sont reportés dans le tableau 1.3. Plusieurs en-
seignements peuvent être tirés de ce tableau. Tout d'abord, les trois congurations, union
monétaire globale (GUM), grande union monétaire (LUM) et double union monétaire
(DUM) peuvent être des équilibres stables suivant la valeur des paramètres, mais le cas
GUM semble le plus vraisemblable. Ensuite, lorsque le biais inationniste est faible com-
paré à la variance du choc, l'union monétaire présente moins d'avantages, et les bénéces
tirés d'une politique plus active peuvent l'emporter sur les gains de crédibilité. Dans ce
cas, la double union monétaire sera un équilibre stable tant que le poids relatif accordé
à l'objectif d'ination (
(comprenant trois pays) qui constituera l'unique équilibre stable du jeu. Cependant, dans
le premier cas (
stable, car cette situation est préférable à toutes les autres du point de vue de l'
En eet, dans ce cas, on peut vérier que la structure à deux unions monétaires n'est pas
une alternative crédible. La stabilité de l'union monétaire (LUM) est alors garantie par les
deux seules conditions de stabilité interne et externe (voir
cas où l'objectif de production est faible comparé à la variance du choc (
β = 0.1,σ = 1,¯y = 0.1
1/β
) est grand (
β = 0.1
), l'union monétaire à trois pays peut également être
). Sinon, c'est la grande union monétaire
outsider
infra
). Notons enn que dans le
¯y = 0.1etσ = 1
.
),
la condition de protabilité n'est pas respectée c'est-à-dire que la perte des pays non-
60
Page 79

1.6. ANNEXE : LA STABILITÉ DANS UN MODÈLE THÉORIQUE SIMPLE
membres est toujours inférieure à celle des pays membres quelle que soit la conguration
(LUM ou PUM).
61
Page 80

1.6. ANNEXE : LA STABILITÉ DANS UN MODÈLE THÉORIQUE SIMPLE
1.3 Simulations
GUM
)
GUM
) > E(L
LUM
c
) > E(L
DU M
) > E(L
P U M
c
GUM
)
GUM
) > E(L
LUM
c
) > E(L
LUM
nc
) > E(L
DU M
DUM ou LUM
)
LUM
nc
) > E(L
GUM
) > E(L
DU M
) > E(L
LUM
c
GUM
)
GUM
) > E(L
LUM
c
) > E(L
DU M
) > E(L
P U M
c
GUM
)
GUM
) > E(L
LUM
c
) > E(L
LUM
nc
) > E(L
DU M
LUM
)
LUM
nc
) > E(L
GUM
) > E(L
LUM
c
) > E(L
DU M
GUM
)
GUM
) > E(L
LUM
c
) > E(L
DU M
) > E(L
P U M
c
GUM
)
GUM
) > E(L
LUM
c
) > E(L
DU M
) > E(L
LUM
nc
LUM
)
LUM
nc
) > E(L
GUM
) > E(L
LUM
c
) > E(L
DU M
Tab.
Rangement des espérances Equilibre stable
β σ ¯y
LUM
P U M
F ER
) > E(L
) > E(L
nc
P U M
) > E(L
nc
P U M
) > E(L
F ER
E(L
) > E(L
c
P U M
nc
LUM
) > E(L
) > E(L
nc
P U M
c
P U M
) > E(L
) > E(L
F ER
F ER
E(L
E(L
1 1
1 0.1
0.1 0.01 1
) > E(L
) > E(L
nc
P U M
) > E(L
nc
P U M
) > E(L
F ER
E(L
) > E(L
c
P U M
nc
LUM
) > E(L
) > E(L
nc
P U M
c
P U M
) > E(L
) > E(L
F ER
F ER
E(L
E(L
1 1
1 0.1
0.5 0.01 1
) > E(L
) > E(L
nc
P U M
) > E(L
nc
P U M
) > E(L
F ER
E(L
) > E(L
c
P U M
nc
) > E(L
) > E(L
nc
P U M
c
) > E(L
) > E(L
F ER
E(L
E(L
1 1
1 0.1
0.9 0.01 1
62
Page 81

Première partie
Unions monétaires et commerce
63
Page 82

Introduction de la première partie
La première partie de cette thèse a pour objectif d'analyser les eets des unions moné-
taires sur le commerce. Cette question fait l'objet d'une littérature empirique relativement
récente et reste peu étudiée sur le plan théorique. Il existe donc un décalage indéniable
entre les deux approches, théorique et empirique. De fait, les deux formes d'intégration,
monétaire et économique, sont généralement traitées de façon séparée dans la littérature
(Rajan, 2002). La recherche portant sur l'intégration économique et le commerce fait ap-
pel à des outils théoriques relativement consensuels, tandis que l'intégration monétaire fait
référence à des questions ambiguës souvent mal comprises par les économistes, comme la
crédibilité ou la rationalité limitée (Krugman, 1995). Les gains de l'intégration réelle sont
alors largement avérés, alors que dans le cas de l'intégration monétaire, ils paraissent plus
incertains (Deissenberg et Fontagné, 1997).
Dans le chapitre préliminaire, nous avons développé les arguments avancés dans la
théorie des Zones monétaires optimales (ZMO). Dans ce cadre d'analyse, plus des pays
commercent entre eux, plus ils auront intérêt à former une union monétaire, car les coûts
de l'intégration monétaire diminuent avec l'ouverture de l'économie (l'utilisation de l'ins-
trument de taux de change devient plus coûteuse), tandis que les bénéces (qui résident
dans l'élimination des coûts de transaction) augmentent (voir notamment McKinnon,
1963 ; De Grauwe, 1999, ch. 2 et 4). L'intégration économique serait alors un préalable
à l'intégration monétaire. D'autres arguments tendent à privilégier une relation inverse.
L'intégration monétaire pourrait par exemple permettre de limiter les groupes de pression
protectionnistes, sensibles à la variabilité du taux de change, qui ralentissent le proces-
sus d'intégration économique (Fernandez-Arias, Panizza et Stein, 2002). Par ailleurs, en
64
Page 83

réduisant certains coûts de transaction et l'incertitude portant sur les variations du taux
de change notamment, l'union monétaire est susceptible d'accroître les ux de commerce
entre les pays membres. Dans le chapitre précédent, nous avons souligné qu'une partie
de la littérature suggère que cet eet est important parce qu'il contribue à renforcer la
symétrie des chocs, réduisant ainsi le principal coût de l'union monétaire relatif à la perte
de l'instrument de taux de change : l'union monétaire pourrait être optimale
si elle ne l'est pas
Des travaux empiriques récents conrment l'eet de l'union monétaire sur le commerce.
Deux types d'approche sont possibles. La première, suivie par Rose (2000), consiste à étu-
dier, d'un point de vue général, l'eet de l'union monétaire sur le commerce à partir
d'un échantillon comprenant diérentes expériences d'intégration monétaire. La seconde
consiste à se concentrer sur une ou certaines unions monétaires en particulier. L'Union
économique et monétaire (UEM) a bien sûr été privilégiée car elle constitue une expérience
d'intégration monétaire entre douze pays développés (voir partie 2), mais la recherche a
également porté sur d'autres unions monétaires (la Zone Franc CFA en Afrique de l'Ouest
et en Afrique Centrale, par exemple).
Dans le chapitre 1, nous mettons l'accent sur les principaux problèmes méthodolo-
giques qui se posent dès lors que l'on cherche à mesurer un eet global. L'absence de
ex ante
(Frankel et Rose, 1996).
ex post
même
cadre théorique explicite complique la tâche car il n'existe pas ou peu d'indications sur
les mécanismes qui sous-tendent la relation entre union monétaire et commerce. De plus,
comme il y a peu d'unions monétaires dans le monde, les travaux empiriques sont ame-
nés à prendre en compte toutes sortes d'expériences monétaires qui se rapprochent des
unions monétaires, mais qui n'en sont pas réellement. Ainsi, l'échantillon de Rose (2000)
qui comprend plus de 180 pays, regroupe à la fois des unions monétaires de type unila-
téral, multilatéral, mais aussi et surtout beaucoup d'anciennes colonies qui ont adopté la
monnaie du pays colonisateur. Dans ce contexte, nous insistons sur la question du choix
de la méthode d'estimation et suggérons d'utiliser la méthode proposée par Hausman et
Taylor (1981). Cette méthode des variables instrumentales permet de prendre en compte
65
Page 84

l'ensemble des spécicités (inobservables) - en particulier les liens historiques et institu-
tionnels - qui caractérisent ces unions monétaires.
Dans le chapitre 2, nous nous intéressons à une zone en particulier (la Zone Franc CFA)
et étudions le rôle de la monnaie commune dans la réduction des obstacles au commerce.
Cette zone comprend deux unions monétaires et constitue l'une des plus anciennes ex-
périences d'intégration monétaire multilatérale existant à l'heure actuelle. En utilisant la
méthode de `l'eet frontière', nous évaluons le poids relatif des barrières monétaires engen-
drées par l'utilisation de monnaies diérentes dans l'ensemble des obstacles aux échanges
liés à l'existence d'une frontière.
66
Page 85

Chapitre 1
L'eet de l'union monétaire sur le
volume de commerce
There has been a change in economists' thinking about monetary unions. When
we wrote about them in the 1960s, we took as given the extent of trade and
nancial integration, then focused on their implications for the functioning
of a monetary union. We paid little attention to the eects of a monetary
union on the intensity of integration or to the ways in which a single mone-
tary policy would aect its members. We were wrong to neglect these eects
(Kenen, 2003b, p. 51).
1.1 Introduction
Comme le souligne Kenen (2003b), les premières approches relatives aux unions mo-
nétaires et en particulier la théorie des Zones monétaires optimales (ZMO), ne disent rien,
ou presque, de l'impact des unions monétaires sur le commerce. La littérature étudie gé-
néralement la relation inverse entre l'ouverture et les gains et coûts de l'union monétaire :
67
Page 86

1.1. INTRODUCTION
il s'agit de savoir si l'ouverture favorise ou non la mise en place d'une union monétaire. De
plus, l'union monétaire est souvent assimilée à un régime de change xe (Fratianni et von
Hagen, 1992). Or, ces deux régimes monétaires pourraient être très diérents, notamment
parce que l'union monétaire représente un engagement beaucoup plus important :
sharing
a common currency is a much more serious and durable commitment than a xed rate
(Rose, 2000).
Dans ce contexte, l'article publié par Andrew Rose en 2000 apparaît comme très no-
vateur. Dans cet article, Rose se donne une dénition restreinte de l'union monétaire (une
monnaie commune) et tente d'évaluer empiriquement son eet sur le commerce à partir
d'un échantillon comprenant plus de 180 pays. Il obtient deux résultats majeurs. Il montre
premièrement que deux pays qui partagent une même monnaie commercent en moyenne
trois fois plus que des pays avec des monnaies diérentes, toutes choses égales par ailleurs,
et deuxièmement, que réduire la volatilité du taux de change n'équivaut pas à adopter une
monnaie commune. Ce dernier résultat est important puisqu'il signie que l'on ne peut
plus assimiler les unions monétaires aux régimes de change xe, comme on l'a fait par
le passé. Il amène également à se questionner sur les eets macroéconomiques de l'union
monétaire (commerce, investissements domestiques et étrangers, croissance) et non plus
seulement sur ses conditions d'optimalité. Cet article a suscité de nombreuses réactions,
les critiques portant pour la plupart sur l'hétérogénéité et la nature des unions monétaires
considérées par Rose dans son échantillon. Il a également été à l'origine d'un grand nombre
de travaux qui prolongent cette ligne de recherche en s'intéressant à certaines unions mo-
nétaires et en particulier à l'Union économique et monétaire (UEM) (voir par exemple
Flam et Nordström, 2003 ; Micco, Stein et Ordoñez, 2003)1.
Dans ce chapitre, nous présentons les premiers résultats empiriques relatifs à l'eet
de l'union monétaire sur le commerce et mettons l'accent sur les principaux problèmes
méthodologiques qui se posent dès lors que l'on cherche à mesurer un eet global. Nous
insistons en particulier sur le biais de variables omises dû à l'existence de spécicités (inob-
1
Les principaux articles portant sur l'eet de l'UEM sur le commerce sont présentés dans le chapitre 4.
68
Page 87

1.2. LE LIEN ENTRE UNION MONÉTAIRE ET COMMERCE
servables) caractérisant les unions monétaires considérées par Rose (2000). Pour prendre
en compte ces spécicités, nous adoptons la méthode d'estimation proposée par Hausman
et Taylor (1981). Celle-ci a deux avantages par rapport à la méthode d'estimation en eets
xes parfois utilisée pour répondre à ce type de biais : elle produit des estimateurs plus
ecients et permet, contrairement au modèle à eets xes, d'estimer les coecients des
variables constantes dans le temps (Hausman et Taylor, 1981). Nous montrons que lorsque
l'on applique cette méthode, l'eet Rose disparaît. Autrement dit, l'eet de l'union mo-
nétaire sur le commerce, estimé à partir de l'échantillon de Rose, reéterait avant tout les
liens historiques et institutionnels entre les pays de l'échantillon.
Nous présentons tout d'abord les premiers éléments théoriques permettant d'éclairer
le lien entre union monétaire et commerce (section 1.2), avant d'exposer les résultats em-
piriques obtenus par Rose (2000) et les principaux problèmes méthodologiques soulevés
dans la littérature (section 1.3). Dans la section 1.4, nous décrivons brièvement les mé-
thodes d'estimation permettant de résoudre ces problèmes et, dans la section 1.5, nous
présentons nos propres résultats. Enn, nous apportons des éléments de conclusion dans
la section 1.6.
1.2 Le lien entre union monétaire et commerce
An de diérencier l'union monétaire du régime de change xe, nous présentons tout
d'abord les conséquences de la xation irrévocable des parités, avant de nous intéresser
plus spéciquement aux incidences d'une monnaie commune.
1.2.1 La xation irrévocable des parités
Le premier avantage d'une union monétaire ou d'un régime de change xe réside dans
la réduction de l'incertitude associée aux variations du taux de change2. L'argument géné-
2
Il faut noter que la xation irrévocable des parités n'élimine que la variabilité des taux de change
nominaux. Des variations des taux de change réels demeurent possibles.
69
Page 88

1.2. LE LIEN ENTRE UNION MONÉTAIRE ET COMMERCE
ralement invoqué est que si les agents sont adverses au risque, une forte volatilité du taux
de change constitue un obstacle aux échanges3. Cela suppose que les agents engagés dans le
commerce international ne peuvent prévoir correctement les variations du taux de change.
Le modèle théorique de Clark (1973) examine le comportement d'une rme exportatrice
en concurrence parfaite. Un accroissement de la volatilité du taux de change se traduit
dans ce modèle par une augmentation de la variance des prots et par une baisse des
exportations (voir également Hooper et Kohlhagen, 1978 ; Cushman, 1983). De Grauwe
(1988) relativise ces résultats en montrant que la relation entre variabilité des taux de
change et commerce dépend des hypothèses sur l'aversion au risque des agents. En eet,
si l'exportateur a susamment d'aversion au risque, un renforcement du risque de change
peut mener à un accroissement des activités d'exportation pour compenser une éventuelle
baisse du revenu (eet revenu opposé à l'eet de substitution traditionnel). Gagnon (1993)
montre grâce à des simulations numériques, que l'impact négatif de la volatilité du taux
de change sur le commerce est nécessairement faible. De fait, les travaux empiriques ne
parviennent généralement pas à dégager un eet signicatif (FMI, 1984 et 2004 ; Frankel
et Wei, 1993).
L'absence de résultat empirique concluant est généralement expliquée par l'existence
de marchés à terme qui permettent de réduire l'incertitude à moindre coût. Cependant,
ces marchés à terme n'existent pas toujours, ou à des horizons plus courts que ceux des
rmes engagées dans le commerce international.
1.2.2 La monnaie commune
Si l'on se réfère aux fonctions de la monnaie, il apparaît qu'une monnaie commune
facilite les échanges à la fois dans sa fonction d'unité de compte et de moyen d'échange
(Krugman, 1995). Au-delà de la réduction de l'incertitude, l'union monétaire implique
l'élimination des coûts de transaction liés au taux de change. Deux types de coûts sont
3
Le lien entre volatilité du taux de change et incertitude repose sur une caractéristique essentielle du
commerce international, à savoir l'existence d'un décalage entre le moment où la rme exportatrice décide
de sa production et engage des frais en monnaie domestique et le moment où elle livre les biens et reçoit,
en monnaie étrangère, les revenus de la vente de ces biens. Ce laps de temps peut s'expliquer par la durée
du transport, mais aussi par d'autres délais (contractuels par exemple).
70
Page 89

1.2. LE LIEN ENTRE UNION MONÉTAIRE ET COMMERCE
susceptibles d'être supprimés : les coûts directs payés par les ménages et les entreprises au
secteur nancier sous forme de commissions et de marges de change, et des coûts internes
aux entreprises (Commission européenne, 1990). En pratique, il est dicile d'évaluer les
coûts de transaction liés aux échanges, car ils varient considérablement en fonction de la
monnaie échangée et de la taille des transactions. Dans le cas européen, ces coûts nanciers
seraient compris entre 0,17% et 0,27% du PIB communautaire en 1990 (Commission eu-
ropéenne, 1990). Quant aux coûts internes aux entreprises, ils sont d'origine très diverse :
ils peuvent provenir d'une fragmentation dans la gestion des liquidités due à la complexité
accrue des fonctions de trésorerie et de comptabilité, du rallongement du délai entre le
débit et le crédit des comptes bancaires, ou encore des coûts d'opportunité encourus par
les rmes qui tentent d'éviter le risque de change. Au total, l'ensemble de ces coûts de
transaction pourraient s'élever à 0,4% du PIB européen (Commission européenne, 1990).
D'autres estimations concluent à un chire plus élevé, de l'ordre de 1% du PIB4(Gros et
Thygesen, 1998).
Par ailleurs, l'union monétaire pourrait simplier le calcul des coûts et les décisions de
xation des prix des entreprises (Kenen, 2003a). Elle devrait également entraîner une plus
grande transparence des prix qui pourrait accroître le commerce car les agents peuvent
plus facilement comparer les prix entre pays et chercher l'ore la plus compétitive, domes-
tique ou étrangère (HM Treasury, 2003b).
Même s'il n'existe pas, à l'heure actuelle, de cadre théorique permettant de décrire
précisément l'ensemble des mécanismes par lesquels l'union monétaire inuence le com-
merce, cette question peut néanmoins être envisagée d'un point de vue empirique. Rose
(2000) adopte cette démarche en utilisant un modèle empirique simple et nécessitant peu
de formalisation théorique.
4
Toutefois il faut noter que seule une partie de ces coûts de transaction est susceptible d'aecter
directement le volume de commerce international.
71
Page 90

1.3. LES RÉSULTATS EMPIRIQUES ET LES SOURCES DE BIAIS
1.3 Les résultats empiriques et les sources de biais
Dans un article désormais célèbre, publié en 2000, Andrew Rose tente de mesurer
l'eet d'une monnaie commune sur le commerce. Auparavant, la littérature évaluait de
manière indirecte cet eet en s'intéressant principalement au canal de la volatilité du taux
de change (voir par exemple De Grauwe et Skudelny, 2000). La publication de l'article de
Rose, et ses conclusions assez diérentes de celles qui prévalaient jusque-là, ont engendré
beaucoup de réactions, commentaires ou critiques5. Nous synthétisons ici les résultats
obtenus dans ces travaux et les principaux problèmes méthodologiques et économétriques
posés par le choix de l'échantillon.
1.3.1 Le modèle empirique de Rose (2000)
Pour mesurer l'impact de l'union monétaire sur le commerce, Rose a recours à une
équation de gravité, qui est le modèle empirique généralement utilisé pour expliquer le
niveau du commerce entre deux pays. Dans cette section, nous présentons succinctement
l'intuition qui sous-tend ce modèle, et que nous utiliserons également dans les chapitres
suivants. Dans le chapitre 2, nous discutons les fondements théoriques de l'équation de
gravité et proposons une modélisation simple reposant sur les travaux d'Anderson et van
Wincoop (2003).
La première application du modèle de gravité au commerce international est souvent
attribuée à Linnemann (1966), poursuivant les travaux de Tinbergen (1962). Mais l'équa-
tion de gravité a été utilisée bien avant en sciences sociales et a été appliquée notamment
en géographie dès la n du XIXème siècle (voir Raballand, 2004, pp. 59-60). Elle tient
son nom de la loi de Newton (loi de la gravitation), selon laquelle la force d'attraction
entre deux corps matériels dans l'univers est directement proportionnelle au produit de
leurs masses et inversement proportionnelle au carré de leur distance. Dans sa spécica-
tion la plus simple, l'équation de gravité appliquée au commerce international explique
5
La plupart de ces articles sont repris par Rose (2004) dans une méta-analyse.
72
Page 91

1.3. LES RÉSULTATS EMPIRIQUES ET LES SOURCES DE BIAIS
les ux de commerce entre deux pays par leur taille économique et par la distance qui
les sépare. L'intensité des échanges est ainsi déterminée par deux forces concurrentes :
des forces d'attraction (la taille économique des pays) et des forces de résistance (souvent
représentées par la distance et correspondant plus généralement à l'ensemble des obstacles
au commerce) (voir Fontagné, Pajot et Pasteels, 2002).
Ce modèle bénécie ces dernières années d'un regain d'intérêt de la part des écono-
mistes parce qu'il donne de bons résultats empiriques (c'est-à-dire qu'il permet d'ex-
pliquer une part très importante de la variance du commerce bilatéral) et parce que ses
fondements théoriques ont été élargis, notamment grâce aux théories plus récentes du
commerce international (Frankel, 1997) (voir la section 2.4 du chapitre 2).
L'équation de gravité
Formellement, l'équation de gravité, sous sa forme la plus simple, est donnée par :
YiY
Xij= A
où
Xijreprésente la valeur des ux de commerce (par exemple les exportations) entre
un paysiet un paysj,Yleur revenu national,
j
D
ij
Dijune mesure de la distance entre
(1.1)
ces pays etAun coecient de proportionalité. Elle est généralement estimée sous forme
logarithmique. En plus des variables traditionnelles de PIB et de distance, il est possible
d'ajouter diérentes variables de contrôle qui prennent en compte les autres déterminants
du commerce - des variables captant par exemple l'existence d'une frontière ou d'une
langue commune, des accords de libéralisation commerciale ou des liens privilégiés liés à
une histoire commune. La variable de PIB par habitant peut être également introduite
pour mesurer le niveau de développement de chacun des pays, car on suppose qu'au fur et à
mesure qu'un pays se développe, il tend à se spécialiser davantage et à commercer plus (voir
Frankel, 1997). Bergstrand (1989) souligne que le PIB par habitant représente les dotations
en facteurs du pays exportateur et la structure de préférences du pays importateur.
73
Page 92

1.3. LES RÉSULTATS EMPIRIQUES ET LES SOURCES DE BIAIS
La variable indicatrice d'union monétaire
Comment mesurer l'eet de l'union monétaire sur le commerce ? Une première possibi-
lité consiste à introduire dans l'équation de gravité traditionnelle une variable de volatilité
du taux de change, mais cela revient à supposer que l'union monétaire n'accroît le volume
de commerce que parce qu'elle réduit l'incertitude sur les variations du taux de change.
L'union monétaire est alors assimilée à un régime de change xe. Cette conception a
longtemps dominé, aussi bien dans le milieu de la recherche académique que sur le plan
politique (Fratianni et Von Hagen, 1992), mais il apparaît de plus en plus que l'union
monétaire ne peut se réduire à un régime de change xe (voir encadré 1). Dans ce cadre,
il semble dicile de mesurer l'union monétaire par une variable quantitative. La solution
qui a été adoptée dans la littérature depuis l'article de Rose (2000) consiste à utiliser une
variable indicatrice qui prend la valeur0pour des pays qui ont leur propre monnaie, et la
valeur1pour des pays membres d'une union monétaire. Il est vrai que cette solution n'est
pas entièrement satisfaisante, dans la mesure où, si le modèle est mal spécié, ce type
de variable indicatrice peut mesurer l'inuence d'autres facteurs (variables omises), qui
ne sont pas liés strictement à l'existence d'une union monétaire. C'est pour cette raison
qu'il est nécessaire de porter une attention toute particulière aux méthodes d'estimation,
en choisissant celles qui limitent le risque de variables omises (voir
infra
et les chapitres
suivants).
1.3.2 L'estimation de Rose (2000)
L'équation estimée
Rose retient les variables de gravité classiques et ajoute deux déterminants supplémen-
taires : la volatilité du taux de change et l'appartenance à une union monétaire. L'équation
qu'il estime est la suivante :
ln(X
) = β0+ β1ln(YitYjt) + β2ln(yityjt) + β3ln(Dij) + β5Comlang
ijt
+β7Regional
+ β8Comctry
ijt
+ β9Comcolij+ β10Colonial
ijt
74
+ β6Border
ijt
ij
ij
Page 93

1.3. LES RÉSULTATS EMPIRIQUES ET LES SOURCES DE BIAIS
+γC U
où
X
est la valeur du commerce entre les paysietjà la périodet, Y est le PIB réel,
ijt
y est le PIB réel par habitant,
+ δV (e
ijt
) + λt+ ²
ijt
ijt
Dijest la distance entreietj,
BorderetComlang
(1.2)
sont
deux variables muettes qui valent 1 siietjpartagent une frontière et une même langue,
Regional
commerciale,
est une autre variable muette qui vaut 1 siietjont passé un accord d'intégration
Comctry,Comcol
, et
Colonial
sont trois autres variables de contrôle qui
valent 1 respectivement siietjfont partie du même pays, s'ils sont d'anciennes colonies
d'un même colonisateur, et siia coloniséjou
vaut 1 lorsqueietjpartagent la même monnaie et
vice versa.CU
V (e)
représente la volatilité du taux de
est une variable muette qui
change nominal bilatéral. Rose inclut cette variable à la fois pour mesurer l'impact d'un
taux de change plus ou moins volatile sur le commerce et pour pouvoir évaluer l'impact
de l'union monétaire au-delà de l'eet de stabilisation du taux de change. Enn,
une variable muette pour chaque année de l'échantillon et
²
est le terme d'erreur.
ijt
λtest
La base de données
Les données de commerce utilisées par Rose proviennent de l'Oce statistique des Nations
Unies. Les populations et les PIB sont repris des
la Banque Mondiale (
World Development Indicators
pour mesurer la distance grand-cercle, proviennent de la CIA
Penn World Tables
et des indicateurs de
). Les latitudes et longitudes, utilisées
World Factbook
, de même
que les autres variables muettes. La variable d'accords régionaux est construite à partir
des données du site de l'OMC. La variable de volatilité est mesurée comme l'écart type
de la première diérence du logarithme du taux de change nominal mensuel calculé sur
les cinq années précédant l'année courante (les calculs sont réalisés à partir des données
de taux de change du FMI).
L'échantillon de Rose inclut 186 pays, départements d'outre-mer et colonies dans le
monde entier, et 5 années (1970, 1975, 1980, 1985 et 1990). Beaucoup de données sont
75
Page 94

1.3. LES RÉSULTATS EMPIRIQUES ET LES SOURCES DE BIAIS
manquantes et l'estimation porte sur un total de 22 948 observations renseignées6. Sur ce
total, 252 observations concernent des pays partageant une même monnaie. Les unions
monétaires considérées par Rose sont décrites en annexe de ce chapitre (tableau 1.4).
Les résultats de Rose
En utilisant une méthode d'estimation en coupe transversale - une régression en Moindres
carrés ordinaires (MCO) sur données empilées avec des variables muettes par année - Rose
montre que le fait de partager une même monnaie accroît le volume de commerce bilatéral
de 235% [
= exp(1.21) − 1
] (voir tableau 1.5 en annexe de ce chapitre). Ainsi, deux pays
appartenant à une même union monétaire commerceraient en moyenne trois fois plus entre
eux que des pays ayant leur propre monnaie. En outre, il faut noter que ce résultat peut
être interprété comme un eet de création de commerce plutôt que comme un simple eet
d'accroissement du commerce, puisque les pays en union monétaire commercent également
plus avec des pays qui ne partagent pas la même monnaie7. L'union monétaire serait donc
aussi génératrice de gains pour les pays non-membres. Ce résultat rejoint les intuitions
développées dans le chapitre préliminaire, indiquant que les pays non-membres peuvent
également tirer bénéce de la formation d'une union monétaire. Nous revenons sur ce
point dans les chapitres 3 et 4.
Cet eet est élevé et Rose reconnaît lui-même qu'il peut dicilement être transposé
à des pays hors-échantillon (comme les pays de la zone euro par exemple). Un résultat
peut-être plus convaincant est que l'eet sur le commerce d'une réduction de la volatilité
du taux de change dière radicalement de l'impact d'une monnaie commune. En eet,
le coecient de la variable d'union monétaire est toujours signicatif, même après avoir
introduit la variable de volatilité, ce qui signie que l'union monétaire a un eet sur le
commerce au-delà de la simple stabilisation du taux de change. De plus, l'eet estimé de
6
Le nombre maximal d'observations possibles sur cet échantillon est de 86 025 [=
7
Lorsque l'on ajoute dans l'équation 1.2 une variable muette qui vaut 1 si les deux pays n'appartiennent
pas à la même union monétaire, mais si au moins un des deux pays fait partie d'une union monétaire avec
un ou des pays tiers, le coecient de cette variable est positif et signicatif, ce qui conrme la présence
d'un eet de création de commerce (voir Rose, 2000).
(186 ∗ 185 ∗ 5)/2
].
76
Page 95

1.3. LES RÉSULTATS EMPIRIQUES ET LES SOURCES DE BIAIS
ces deux variables est sensiblement diérent. La valeur du coecient de volatilité montre
que la réduction la volatilité du taux de change d'un écart type autour de sa moyenne
n'accroît le commerce que de 13%, chire à comparer avec l'eet de 235% généré par
l'existence d'une monnaie unique.
1.3.3 Les sources de biais
De nombreux travaux de recherche se sont développés en réponse à l'article de Rose.
Ces travaux mettent généralement en évidence l'existence d'autres facteurs, au-delà de la
monnaie unique, qui pourraient expliquer les relations commerciales privilégiées entre pays
membres d'une union monétaire. Comme il existe peu d'unions monétaires dans le monde,
l'échantillon de Rose inclut typiquement des pays petits et pauvres (les pays africains de
la zone CFA, certaines îles des Caraïbes, etc.) et tous types de relations monétaires qui
ressemblent à des unions monétaires mais qui n'en sont pas réellement (la Guadeloupe et
la France par exemple). Pomfret (2005) étudie plus en détail les 82 pays que Rose identie
comme membres d'une union monétaire et souligne que, hormis quelques pays (dont les
pays de la Zone Franc CFA), tous sont de petites îles ou territoires sans statut souverain.
L'analyse économétrique peut alors indiquer que ces pays commercent davantage entre
eux, sans pour autant que ce résultat soit dû spéciquement au partage d'une monnaie
unique. Plus formellement, trois types de biais potentiels peuvent être identiés : un biais
d'agrégation, dû à la prise en compte d'unions monétaires trop hétérogènes, un biais
d'auto-sélection, créé par une corrélation entre la variable d'union monétaire et les autres
variables explicatives du modèle, et un biais de variables omises8. Dans cette section,
nous présentons principalement les contributions qui se réfèrent directement à l'article
original de Rose, utilisant le même échantillon9(le tableau 1.1 propose une synthèse de
8
Baldwin (2005) souligne également l'existence d'un biais de spécication, car, contrairement à l'équa-
tion dérivée du modèle théorique, celle utilisée par Rose (2000) inclut le commerce bilatéral à la place
des exportations et exprime les variables de commerce et de PIB en termes réels au lieu de conserver les
valeurs nominales (voir la section 4.3 du chapitre 4).
9
D'autres articles ont également cherché à estimer l'eet des unions monétaires sur le commerce, en
utilisant d'autres échantillons. Parmi ces articles, Flandreau et Maurel (2005) s'intéressent aux relations
monétaires des pays européens au XIXème siècle, Thom et Walsh (2002) étudient la rupture de l'union
monétaire formée par l'Irlande et le Royaume Uni en 1979, et Micco, Stein et Ordoñez (2003) exploitent
77
Page 96

1.3. LES RÉSULTATS EMPIRIQUES ET LES SOURCES DE BIAIS
ces travaux).
Un biais d'agrégation
Comme le souligne Nitsch (2004), l'échantillon de Rose comprend à la fois des unions
monétaires multilatérales10(par exemple la Zone Franc CFA en Afrique de l'Ouest et en
Afrique Centrale), unilatérales (Panama dollarisé depuis 1904) et d'anciennes colonies qui
ont adopté la monnaie du pays colonisateur (voir le tableau 1.4 en annexe de ce chapitre).
Si ces trois types d'unions monétaires ont un eet diérent sur le commerce, alors l'agré-
gation en une seule variable (la variable d'union monétaire
CU
) produira un biais dans
l'estimation.
Pour éliminer ce biais d'agrégation, deux méthodes sont possibles : réduire la taille
de l'échantillon ou introduire davantage de variables de contrôle dans l'équation estimée.
Nitsch (2004) se restreint à l'étude de deux unions multilatérales : la zone CFA en Afrique
de l'Ouest et en Afrique Centrale11et l'union monétaire des Caraïbes orientales (regrou-
pant huit îles, toutes anciennes colonies britanniques). Ces deux unions monétaires sont
plus homogènes en termes de structures de production et de trajectoires historiques et
culturelles. L'estimation en coupe transversale sur cet échantillon réduit donne des résul-
tats assez diérents de ceux de Rose : les pays de la zone CFA commerceraient nettement
plus entre eux qu'avec d'autres pays (à hauteur de 55%), tandis que dans le cas des îles
des Caraïbes, le coecient estimé est encore plus faible et non signicatif.
L'échantillon de Rose permet également de s'intéresser aux unions monétaires unila-
les données récentes sur l'Union monétaire européenne. Ces références, ainsi que d'autres, sont citées dans
Rose (2004).
10
Une union monétaire multilatérale se caractérise par le partage de la souveraineté monétaire (par
exemple l'UEM), tandis que dans une union unilatérale, la souveraineté monétaire est abandonnée au
prot du pays-ancre.
11
Notons que Nitsch (2004) et Rose (2000) considèrent la Zone Franc CFA comme une seule union
monétaire alors qu'il existe en fait deux unions monétaires avec deux monnaies et deux banques centrales
distinctes (voir chapitre 2). Cette imprécision pourrait conduire à sous-estimer l'eet de l'union moné-
taire puisqu'elle revient à considérer le commerce entre les deux zones comme du commerce intra-union
monétaire.
78
Page 97

1.3. LES RÉSULTATS EMPIRIQUES ET LES SOURCES DE BIAIS
térales. Klein (2002) étudie l'eet d'une dollarisation sur le commerce, et donc élimine
toutes les observations, dans l'échantillon de Glick et Rose (2002), qui n'incluent pas les
États-Unis12. Il montre, grâce à la même méthode, que les États-Unis commercent 65%
plus avec des pays dollarisés. Du point de vue des pays dollarisés, les résultats sont encore
moins concluants puisque ces pays ne commercent pas plus avec les États-Unis qu'avec
d'autres pays comparables. Enn, sur cet échantillon, il ne semble pas y avoir de diérence
signicative entre les régimes de change xe et la dollarisation13.
Il est également possible de réduire le biais d'agrégation en introduisant dans l'équation
estimée diérentes variables muettes permettant d'isoler chaque type d'union monétaire.
On obtient alors un coecient similaire à celui de Rose pour les unions monétaires unilaté-
rales (un accroissement du commerce de 238%), mais le coecient estimé est réduit à 65%
lorsque l'on ne considère que les unions monétaires multilatérales (Levy Yeyati, 2003). Ces
résultats semblent montrer que le coecient élevé obtenu par Rose est en grande partie
dû au poids des unions monétaires unilatérales dans l'échantillon. Comme ce groupe com-
prend principalement des petites entités qui ne sont généralement pas indépendantes et
qui développent des liens institutionnels et politiques étroits avec le pays émetteur de la
monnaie, l'eet strict de l'union monétaire sur le commerce a de grandes chances d'être
en réalité plus faible (Levy Yeyati, 2003).
Un biais d'auto-sélection
On ne peut considérer que l'union monétaire accroît le commerce, toutes choses égales
par ailleurs, que si les pays membres d'une union monétaire sont directement comparables
aux autres pays de l'échantillon. Or, Persson (2001) souligne l'existence possible d'un
biais d'auto-sélection dû à une corrélation systématique entre la variable d'union moné-
12
Glick et Rose (2002) s'appuient sur un échantillon plus grand que Rose (2000). Il inclut 217 pays
entre 1948 et 1997. Klein restreint l'échantillon à la période post-Bretton Woods. Sur cette période, les
pays dollarisés sont les Bahamas, les Bermudes, la République Dominicaine, le Guatemala, le Liberia et
Panama.
13
Les coecients des variables muettes identiant les deux régimes monétaires n'apparaissent pas si-
gnicativement diérents.
79
Page 98

1.3. LES RÉSULTATS EMPIRIQUES ET LES SOURCES DE BIAIS
taire et d'autres déterminants du commerce (mesurés par les variables explicatives du
modèle). Par exemple, dans l'échantillon initial, les pays appartenant à une union moné-
taire sont aussi généralement plus petits, plus pauvres, et plus proches géographiquement.
Les membres d'une union monétaire peuvent alors être amenés à commercer davantage
du fait de leurs caractéristiques spéciques (richesse, distance, etc.) et non parce qu'ils
partagent une même monnaie. L'existence de ce type de corrélation empêche de comparer
directement les pays en union monétaire avec les autres pays de l'échantillon.
An de prévenir ce type de biais, Persson (2001) propose une nouvelle méthodologie
(
matching methods
nomie du travail. Cette méthode consiste à créer un groupe de contrôle parmi les pays
) empruntée à la recherche médicale et utilisée principalement en éco-
qui ont leur propre monnaie, mais qui partagent les caractéristiques des pays en union
monétaire. Pour ce faire, il faut construire un
d'appartenir au groupe des unions monétaires en fonction des autres déterminants du
commerce (les variables explicatives du modèle). La comparaison des ux de commerce
entre les couples de pays qui partagent une même monnaie et ceux du groupe de contrôle
permet de montrer que l'eet des unions monétaires sur le commerce est bien plus faible
(compris entre 13% et 65%).
Rose (2001) souligne que la méthode utilisée par Persson pour modéliser l'appartenance
à une union monétaire est inadaptée pour au moins trois raisons. Tout d'abord, elle ne tient
pas compte de la dimension temporelle des données. Ensuite, elle manque de fondements
théoriques. Enn, elle donne des résultats peu conformes à la réalité ou à l'intuition : elle
prédit par exemple que la signature d'un accord de libéralisation du commerce réduit la
probabilité d'appartenance à une union monétaire. De plus, la corrélation entre la variable
d'union monétaire et les autres variables explicatives du modèle de Rose (2000) est assez
propensity score
évaluant la probabilité
faible : elle est toujours inférieure à
alors peut-être pas dans la corrélation entre la variable d'union monétaire et les variables
observables - tel que suggéré par Persson - mais dans l'existence de variables omises.
0, 3
en valeur absolue. Le problème majeur ne réside
80
Page 99

1.3. LES RÉSULTATS EMPIRIQUES ET LES SOURCES DE BIAIS
Un biais d'endogénéité
Le biais d'endogénéité se traduit par une corrélation entre la variable d'union monétaire
(ou d'autres variables du modèle, comme la volatilité du taux de change ou l'existence
d'un accord d'intégration commerciale) et le terme d'erreur. Il peut prendre plusieurs
formes : biais de simultanéité, erreur de mesure ou biais de variables omises. Le
simultanéité
survient lorsque la variable dépendante et l'une des variables explicatives du
biais de
modèle sont déterminées conjointement. Dans le cas de la variable d'union monétaire, cela
signie que la monnaie unique inuence le commerce mais aussi que ce dernier détermine
la décision de former une union monétaire. Ce risque de biais existe puisque la théorie des
ZMO prédit que plus les échanges sont intenses, plus les gains de l'union monétaire seront
importants (voir par exemple Bayoumi et Eichengreen, 1997). Rose (2000) se défend contre
cette éventualité en soulignant que la formation d'une union monétaire est une décision
importante, qui ne peut se justier par des considérations uniquement commerciales. Mais
cet argument n'est pas très convaincant. Par ailleurs, l'utilisation d'une variable muette
pour représenter l'union monétaire pourrait être à l'origine d'une
erreur de mesure
, puisque
ce type de variable simplie considérablement la réalité (notamment quant à la date de
mise en place et la nature de l'union, voir Fontagné, Mayer et Zignago, 2005).
Enn, le
biais de variables omises
, qui pourrait être le biais le plus sérieux (voir Baier et
Bergstrand, 2005 ; Baldwin, 2005)14, survient lorsque certains déterminants du commerce
ne sont pas pris en compte dans l'équation estimée (soit parce qu'ils sont inobservables,
soit parce qu'ils sont omis) et sont corrélés avec une ou plusieurs des variables explicatives
du modèle. Ainsi, par exemple, il y aura un biais de variables omises si les liens institu-
tionnels ou historiques unissant certains pays renforcent leurs relations commerciales et
inuencent, parallèlement, la décision de former une union monétaire (voir gure 1.1).
Dans le cas où il y a endogénéité (simultanéité, erreur de mesure ou variables omises),
l'estimateur des MCO est biaisé. La première méthode possible pour corriger ce biais est
14
Baldwin (2005) identie trois types de biais dans les estimations à la Rose et celui-ci correspond à
la médaille d'or (
gold-medal of gravity mistakes
).
81
Page 100

1.3. LES RÉSULTATS EMPIRIQUES ET LES SOURCES DE BIAIS
Fig.
1.1 Simultanéité et biais de variables omises
la méthode des variables instrumentales (VI) traditionnelle. Elle consiste à dénir une ou
plusieurs variables extérieures au modèle qui peuvent servir comme instruments pour la
variable supposée endogène15. Mais elle n'est applicable que s'il existe des variables qui
expliquent la formation d'une union monétaire sans être corrélées au résidu de l'équa-
tion de commerce. Rose (2000) propose des instruments simples obtenus à partir des taux
d'ination et de la croissance de l'agrégat monétaire M2. Cependant, les résultats de l'esti-
mation instrumentée sont peu vraisemblables, probablement parce que les instruments ne
sont pas susamment corrélés à la variable d'union monétaire. Pour obtenir de meilleurs
instruments, la démarche intuitive consiste à partir de la principale théorie de l'intégra-
tion monétaire, la théorie des ZMO. A partir du modèle développé par Alesina et Barro
(2002)16, Tenreyro (2001) sélectionne diérents déterminants de la formation des unions
monétaires, parmi lesquels la taille des pays, l'importance des coûts de transaction, la cor-
rélation des prix et des chocs de production, diérentes mesures de la similarité culturelle
et la prédisposition des pays à adopter des politiques inationnistes17. Ces variables per-
15
Cette méthode est également désignée par le terme `doubles moindres carrés'. En fait, cette dénomi-
nation s'utilise uniquement lorsque l'on dispose de plusieurs instruments (Wooldridge, 2000, p. 477).
16
Alesina et Barro (2002) proposent un modèle théorique qui se situe dans la lignée de Mundell (1961).
Dans ce modèle, l'union monétaire réduit les coûts de transaction, assure une stabilité des prix en éliminant
le biais inationniste caractérisant les politiques discrétionnaires, mais provoque la perte d'un instrument
de stabilisation. Des petits pays, ou des pays présentant une ination historiquement élevée et variable,
seront alors davantage incités à ancrer leur monnaie à celle d'un autre pays.
17
Ce dernier facteur est approximé par une variable indicatrice mesurant l'existence d'accords d'inté-
gration commerciale. L'auteur suppose que des pays qui mettent en place des politiques de libéralisation
commerciale seront aussi plus disciplinés, en particulier en termes d'ination.
82
 Loading...
Loading...