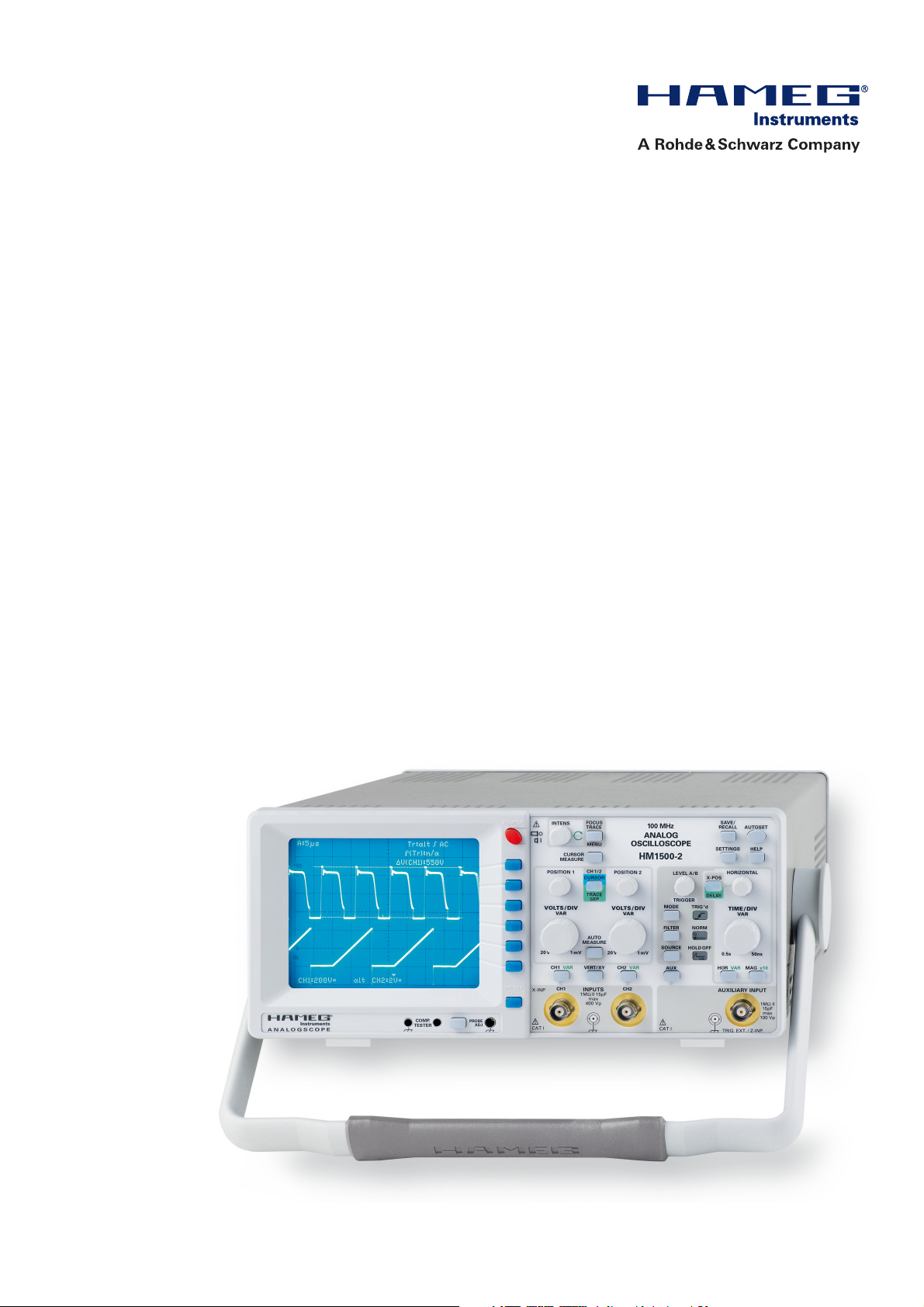
Oscilloscope analogique
150 MHz, HM1500-2
Manuel
Français
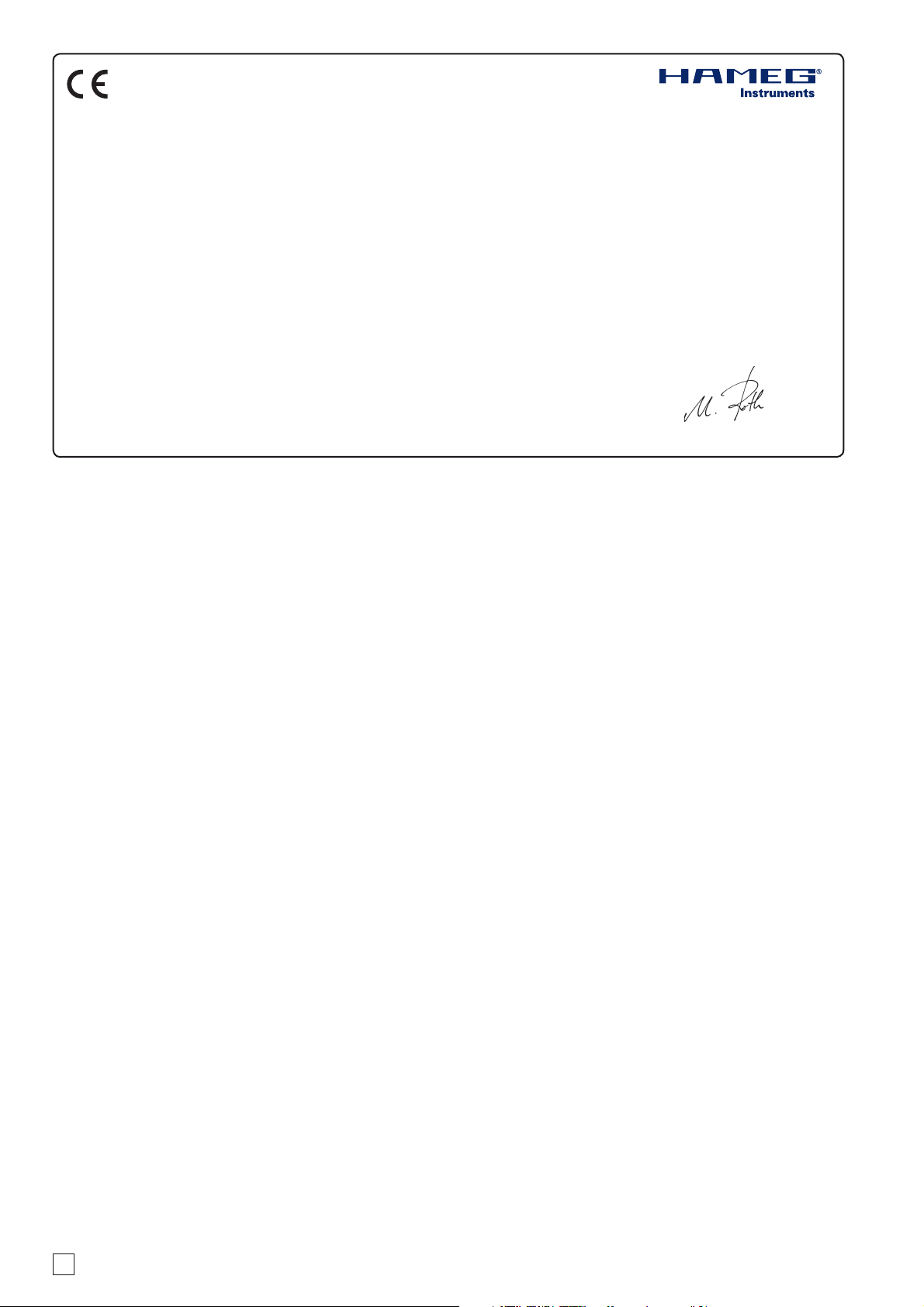
Hersteller HAMEG Instruments GmbH KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Manufacturer Industriestraße 6 DECLARATION OF CONFORMITY
Fabricant D-63533 Mainhausen DECLARATION DE CONFORMITE
Die HAMEG Instruments GmbH bescheinigt die Konformität für das Produkt
The HAMEG Instruments GmbH herewith declares conformity of the product
HAMEG Instruments GmbH déclare la conformite du produit
Bezeichnung / Product name / Designation:
Oszilloskop
Oscilloscope
Oscilloscope
Typ / Type / Type: HM1500-2
mit / with / avec: HO710, HZ200
Optionen / Options / Options: HO720, HO730, HO740
mit den folgenden Bestimmungen / with applicable regulations / avec les
directives suivantes
EMV Richtlinie 89/336/EWG ergänzt durch 91/263/EWG, 92/31/EWG
EMC Directive 89/336/EEC amended by 91/263/EWG, 92/31/EEC
Directive EMC 89/336/CEE amendée par 91/263/EWG, 92/31/CEE
Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG ergänzt durch 93/68/EWG
Low-Voltage Equipment Directive 73/23/EEC amended by 93/68/EEC
Directive des equipements basse tension 73/23/CEE amendée par 93/68/CEE
Angewendete harmonisierte Normen / Harmonized standards applied / Normes
harmonisées utilisées:
Information générale concernant le marquage CE
Les instruments de mesure HAMEG répondent aux exigences de la
directive sur la CEM. Le test de conformité HAMEG répond aux normes
génériques actuelles et aux normes des produits. Lorsque différentes
valeurs limites sont possibles, HAMEG applique les conditions
d’essai les plus sévères. Les valeurs limites employées pour les
émissions parasites sont celles qui s’appliquent aux environnements
commerciaux et artisanaux ainsi qu’aux petites entreprises. Pour
l’immunité, les limites concernant l’environnement industriel sont
respectées.
Les câbles de mesure et de données qu’il est nécessaire de raccorder
à l’instrument ont une infl uence considérable sur les valeurs limites
prédéfinis. Les câbles utilisés sont toutefois différents suivant
l’application. Par conséquent, lors des mesures pratiques, il faut
impérativement respecter les conditions suivantes en matière
d’émission et d’immunité:
1. Câbles de données
La connexion des instruments de mesure ou de leurs interfaces
avec des appareils externes (imprimantes, ordinateurs, etc.) doit
uniquement être réalisée avec des câbles suffi samment blindés. Sauf
indication différente dans le mode d’emploi, la longueur maximale des
câbles de données (entrée/sortie, signal/commande) est de 3 mètres
et ils ne doivent pas sortir des bâtiments. Si l’interface d’un appareil
permet le raccordement de plusieurs câbles, un seul doit être branché
à la fois. Les câbles de données doivent généralement être des câbles
à double blindage. En IEEE-488, le câble HAMEG HZ72 est doté d’un
double blindage et répond donc à ce besoin.
2. Câbles de signaux
Il convient que les cordons de mesure destinés à la transmission des
signaux entre le point de mesure et l’instrument soient généralement
aussi courts que possible. Sauf indication différente, la longueur
maximale des câbles de signaux (entrée/sortie, signal/commande) est
de 3 mètres et ils ne doivent pas sortir des bâtiments.
Tous les câbles de signaux doivent en principe être blindés (câbles
coaxiaux RG58/U). Il faut veiller à une bonne liaison de masse. Dans le
cas des générateurs de signaux, il faut employer des câbles coaxiaux
à double blindage (RG223/U, RG214/U).
Sicherheit / Safety / Sécurité: EN 61010-1:2001 (IEC 61010-1:2001)
Überspannungskategorie / Overvoltage category / Catégorie de surtension: II
Verschmutzungsgrad / Degree of pollution / Degré de pollution: 2
Elektromagnetische Verträglichkeit / Electromagnetic compatibility /
Compatibilité électromagnétique
EN 61326-1/A1 Störaussendung / Radiation / Emission:
Tabelle / table / tableau 4; Klasse / Class / Classe B.
Störfestigkeit / Immunity / Imunitée: Tabelle / table / tableau A1.
EN 61500-3-2/A14 Oberschwingungsströme / Harmonic current emissions /
Émissions de courant harmonique:
Klasse / Class / Classe D.
EN 61500-3-3 Spannungsschwankungen u. Flicker / Voltage fl uctuations and fl icker /
Fluctuations de tension et du fl icker.
Datum /Date /Date
24. 02. 2005
Unterschrift / Signature / Signatur
Manuel Roth
Manager
3. Effets sur les instruments de mesure
Malgré un montage de mesure réalisé avec soin, des composantes
indésirables du signal peuvent pénétrer dans l’instrument par le
biais des cordons de mesure en présence de champs électriques ou
magnétiques puissants à haute fréquence. Il n’existe ici aucun risque
de dommage ni de panne pour les instruments HAMEG, mais de faibles
écarts de la valeur mesurée par rapporte aux spécifi cations indiquées
peuvent apparaître sous des conditions extrêmes.
4. Immunité des oscilloscopes
4.1 Champ HF électromagnétique
De petites superpositions du signal de mesure peuvent apparaître à
l’écran en présence de champs électriques ou magnétiques puissants
à haute fréquence. Ces champs peuvent être induits par le biais du
réseau d’alimentation, des câbles de mesure et de commande et/ou
par rayonnement direct et peuvent affecter aussi bien l’objet mesuré
que l’oscilloscope.
Le rayonnement direct dans l’oscilloscope peut se produire à travers
l’ouverture de l’écran, et ce malgré le blindage par le boîtier métallique.
Comme la bande passante de chaque étage amplifi cateur de mesure est
supérieure à la bande passante totale de l’oscilloscope, des parasites
dont la fréquence est nettement supérieure à la bande passante de
mesure de -3 dB peuvent apparaître à l’écran.
4.2 Transitoires rapides et décharges électrostatiques
L’induction de transitoires rapides (rafales) par le biais du réseau
d’alimentation ou indirecte (capacitive) par le biais des câbles de
mesure et de commande peut, dans certaines circonstances, activer
le déclenchement (Trigger).
Celui-ci peut également être déclenché par un décharge statique (ESD)
directe ou indirecte.
Comme l’oscilloscope doit pouvoir se déclencher et ainsi affi cher des
signaux de faible amplitude (
de signaux de ce type (
< 500 μV), le déclenchement en présence
> 1 kV) est inévitable.
HAMEG Instruments GmbH
2
Sous réserve de modifi cations

Sommaire
Information générale concernant le marquage CE 2
Oscilloscope analogique 150 MHz, HM1500-2 4
Caractéristiques techniques 5
Remarques importantes 6
Symboles 6
Mise en place de l’appareil 6
Sécurité 6
Conditions de fonctionnement 6
CAT I 7
Domaine d’application 7
Conditions ambiantes 7
Garantie et réparation 7
Entretien 7
Circuit de protection 7
Tension du réseau 7
Description sommaire des éléments de commande 8
Principes généraux 10
Nature du signal 10
Amplitude du signal 10
Valeurs de la tension sur une courbe sinusoïdale 10
Valeur totale de la tension d’entrée 11
Valeurs du temps du signal 11
Application du signal 12
Déclenchement externe 20
Indicateur de déclenchement 20
Réglage de la durée d’inhibition (HOLD OFF) 20
Base de temps B (2ème base de temps) /
déclenchement retardé 21
Autoset 21
Testeur de composants 22
Transfert de données 24
Mise à jour du microprogramme 24
Remarqeus générales 25
Menus en incrustation et aide (HELP) 25
Remarques préliminaires 25
Éléments de commande et Readout 26
Mise en route et préréglages 13
Rotation de trace TR 13
Utilisation et compensation des sondes 13
Compensation 1 kHz 14
Compensation 1 MHz 14
Modes de fonctionnement des amplifi cateurs
verticaux 14
Mode XY 15
Comparaison des phases avec une
fi gure de Lissajous 15
Mesure de la différence de phase en mode
double trace (Yt) 16
Mesure d’une modulation d’amplitude 16
Déclenchement et balayage horizontal 17
Déclenchement automatique sur valeur
de crête (menu MODE) 17
Déclenchement normal (menu MODE) 17
Sens du front (menu FILTER) 18
Couplage de déclenchement (menu FILTER) 18
Vidéo (déclenchement sur signal TV) 18
Déclenchement sur impulsion de
synchronisation d’image 19
Déclenchement secteur 19
Déclenchement alterné 19
Sous réserve de modifi cations
3
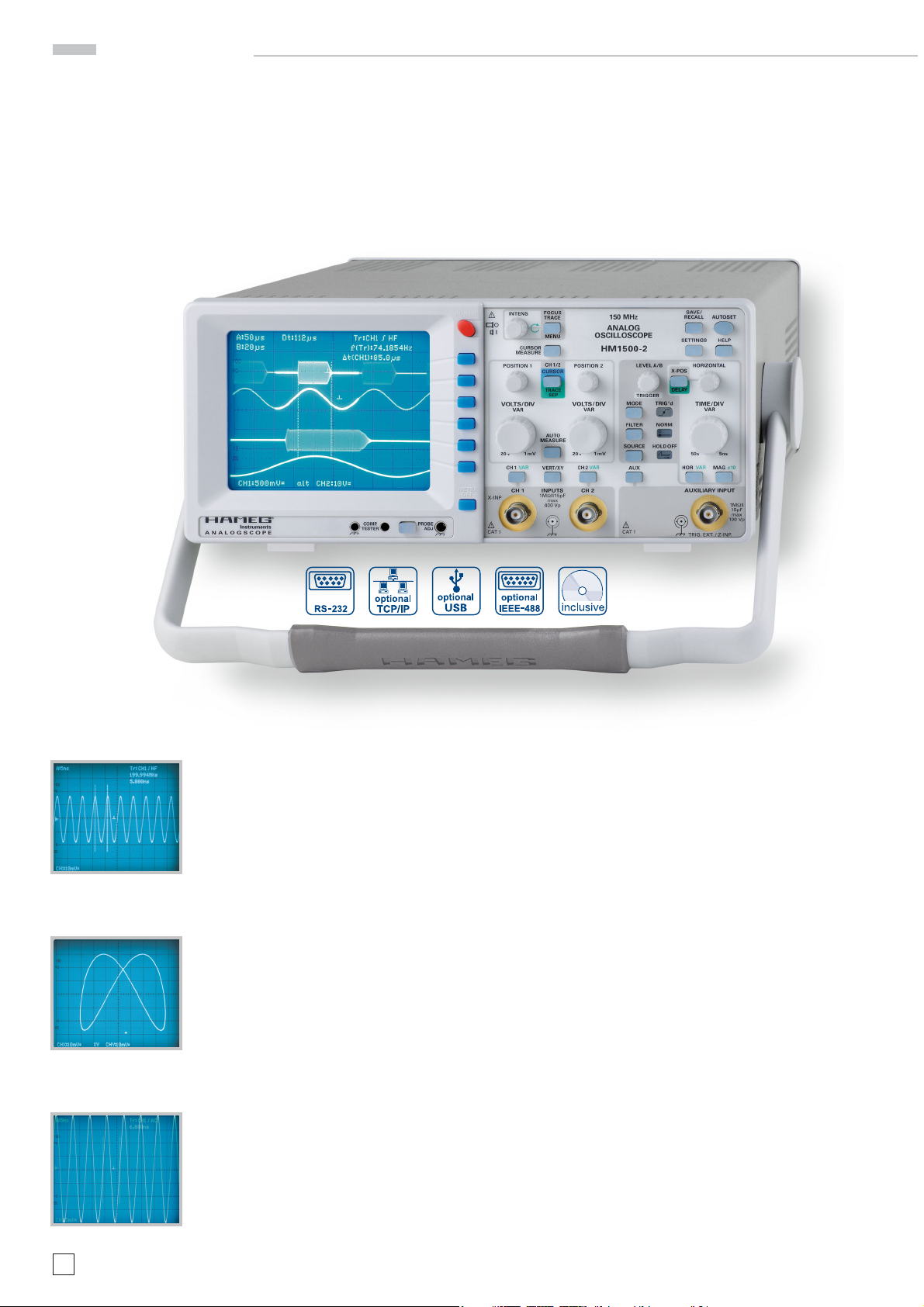
HM1500-2
2 voies avec coefficients de déviation de 1mV/div.…20V/div.
2 bases de temps : 5ns/div…0,5s/div. et 5ns/div.…20ms/div.
Amplificateur de mesure à faible bruit avec reproduction
parfaite d’impulsion
Trigger vidéo : sélection de lignes et trames, paires et impaires,
525/60 et 625/50
Compteur fréquencemètre 200MHz 6 digits,
mesures automatiques et avec curseur
Ecran CRT 14kV à haute vitesse d’écriture, Readout, Autoset,
ligne de retard, sans ventilateur
Mémoire avec modes Save/Recall pour les configurations de
l’appareil
Fonctions d’aide, menu multilingue
Interface RS-232 (uniquement pour la commande et le réglage
des paramètres de mesure)
Oscilloscope analogique 150MHz
HM1500-2
HM1500 2
Représentation sans
défaut d’un signal sinusoïdal
150 MHz
Figure de Lissajous
(mode XY)
Signal sinusoïdal 199.994 MHz
mesuré avec le compteur
fréquencemètre interne
4
Sous réserve de modifi cations
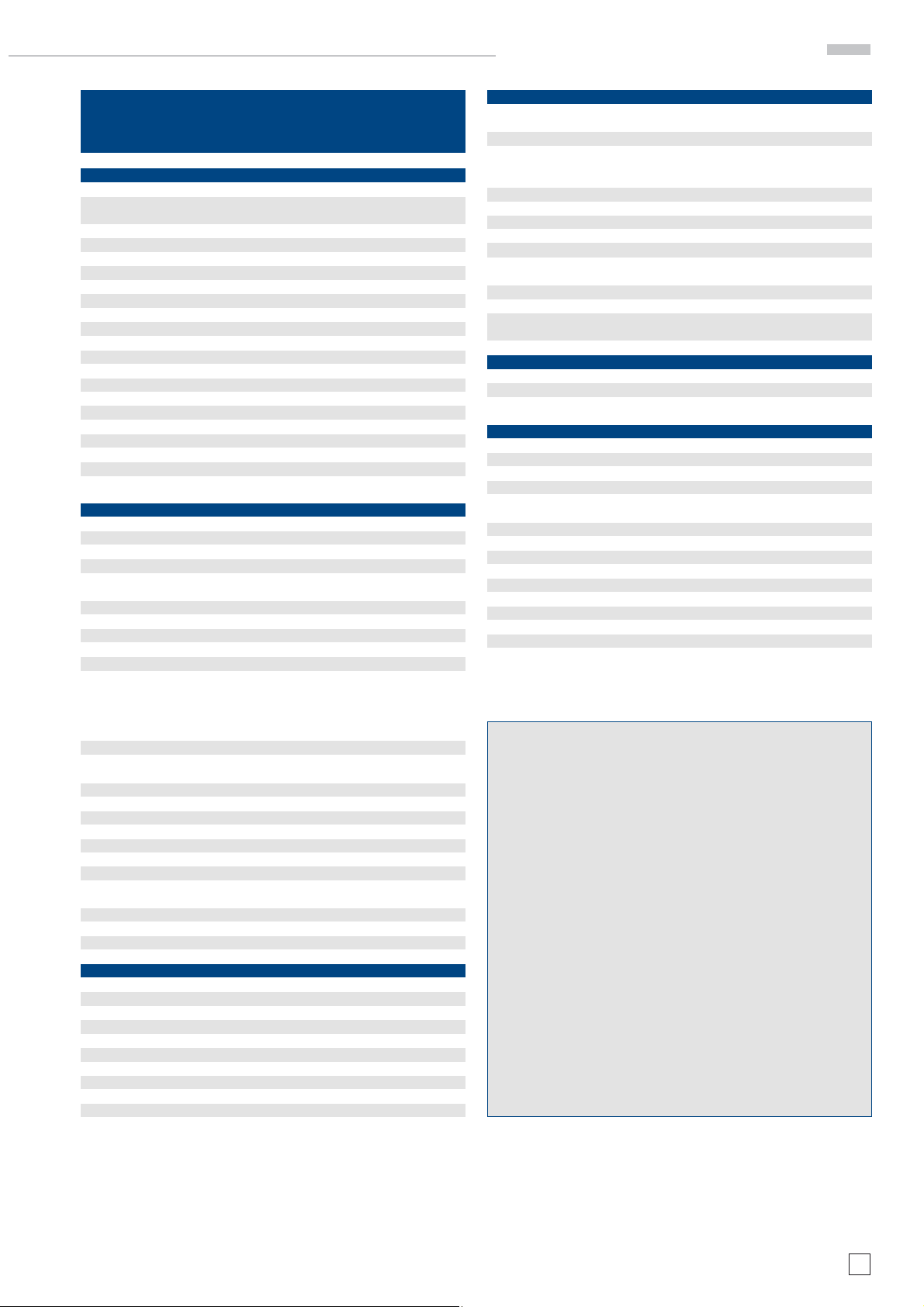
HM1500-2
F/011209/ce · Sous réserve de modifications · © HAMEG Instruments GmbH®· Certifié DQS selon DIN EN ISO 9001:2000, Reg.-No.: DE-071040 QM, fabriqué en Allemagne
HAMEG Instruments France Sarl · Parc Tertiaire de Meudon · 9/11, rue Jeanne Braconnier · 92366 MEUDON LA FORET CEDEX · Tél: 01 41 36 11 60 · Fax: 01 41 36 10 01 ·
www.hameg.com · email: hameg.france@hameg.com
Oscilloscope analogique 150MHz HM1500-2
Caractéristiques à 23°C après une période de chauffe de 30 minutes
Déviation verticale
Voies : 2
Modes de fonctionnement Analogique : Voie 1 ou 2 seule, Dual (1 et 2
alternées ou découpées), addition.
Mode XY : Voie 1
Inversion : Voie 1 et 2
Bande passante (-3dB) : 2 x 0…150MHz
Temps de montée : ‹2,3ns
Limite de bande passante (commutable): env. 20 MHz (5 mV/div.…20V/div.)
Coefficients de déviation (Voies 1, 2) : 14 positions calibrées
1…2 mV/div. : ± 5 % (0…10MHz (-3dB))
5 mV/div.…20V /div. : ± 3 % (séquence 1, 2, 5)
Variable (décalibré) : › 2,5 :1 à › 50 V/div.
Entrées Voies 1, 2 :
Impédance d’entrée : 1MΩ // 15pF
Couplage d’entrée : DC, AC, GND (masse)
Tension d’entrée Max. : 400 V (DC + crête AC)
Ligne à retard Y (analogique) : 70ns
Circuits de mesure : Catégorie I
Entrée auxiliaire :
Fonctions (choix) : déclenchement externe, modulation Z
Couplage d’entrée : AC, DC
Tension d’entrée Max. : 100 V (DC + crête AC)
Déclenchement
Automatique (crête à crête) :
Hauteur minimale du signal : 5mm
Gamme de fréquence : 10 Hz…250MHz
Plage de niveau de contrôle : de crête- à crête+
Normal (sans crête)
Hauteur minimale du signal : 5mm
Gamme de fréquence : 0…250 MHz
Plage de niveau de contrôle : -10…+10div.
Modes de fonctionnement : flanc/vidéo
Flanc : positif, négatif ou les deux
Sources : Voie 1 ou 2, 1/2 alternées (≥ 8mm), secteur, ext.
Couplage : AC : 10Hz…250 MHz
DC : 0…250MHz
HF : 30 kHz…250MHz
LF : 0…5kHz
Rejection de bruit commutable
Vidéo : positif, négatif, synchro, impulsion
Standards : systèmes 525 lignes/60 Hz
systèmes 625 lignes/50 Hz
trames : paire, impaire, les deux
lignes : choix du numéro de ligne/ toutes
sources : Voie 1, 2, externe
Indicateur de déclenchement : par LED
Déclenchement externe : par entrée auxiliaire (0,3 Vcc, 150 MHz)
Couplage d’entrée : AC, DC
Tension d’entrée Max. : 100 V (DC + crête AC)
2edéclenchement
Hauteur minimale du signal : 5mm
Gamme de fréquence : 0…250 MHz
Couplage : DC
Plage de niveau de contrôle : -10…+10div.
Déviation horizontale
Modes de fonctionnement : A, ALT (alterné A/ B), B
Base de temps A : de 50 ns/div.…0,5 s/div. (séquence 1-2-5)
Base de temps B : de 50 ns/div.…20ms/div. (séquence 1-2-5)
Précision A et B : ±3%
Expansion X x10 : jusqu’à 5 ns/div.
Précision : ±5%
Variable, base de temps A/ B : 1:2,5
Durée d'inhibition Hold off : variable 1:10 indication par LED
Bande passante ampli X : 0…3 MHz (-3 dB)
Différence de phase X-Y ‹3° : ‹220kHz
Commandes/Mesures /Interfaces
Commandes : Autoset, Menu et fonctions d’aide
(multilingue)
Sauvegarde/ rappel : 9 configurations
Affichage à l’écran : 4 traces max.
Analogique : Voie 1, 2 (Base de temps A), combinés avec
Voie 1, 2 (Base de temps B)
Compteur fréquencemètre :
Résolution 6 digits : ›1…250MHz
Résolution 5 digits : 0,5 Hz…1MHz
Précision : 50 ppm
Mesures automatiques : fréquence/période,Vdc, Vcc, Vc+, V
c-
Mesures avec curseurs : ΔV, Δt, 1/Δt (f), t montée,V/terre, ratioX (%,°,π),
ratioY
Résolution d’affichage/curseurs : 1000 x 2000 Pts
Interfaces : RS-232
1)
En option : Interface double USB/RS232,IEEE-488,
interface double Ethernet/USB
Affichage/Ecran
Tube cathodique : D14-375GH
Surface d’affichage : 8 div. x 10 div. graticule interne
Tension d’accélération : environ 14 kV
Divers
Testeur de composants :
Tension de test : env. 7V
rms
(circuit ouvert) Fréq. env. 50Hz
Courant de test : max. 7 mA
rms
(court-circuit)
Potentiel de référence : masse (terre de protection)
Calibreur de sondes : 1 kHz/1 MHz signal carré
0,2 Vcc(temps de montée ‹ 4 ns)
Rotation de trace : réglage électronique
Alimentation : 105…253 V, 50/60 Hz ±10 %, CAT II
Consommation : 37Watt à 230 V, 50 Hz
Protection : classe de protection I (EN61010-1)
Temp. de fonctionnement : +5…+40 °C
Temp. pour le stockage : -20…+70 °C
Humidité relative : 5…80% (sans condensation)
Dimensions (L x H x P) : 285 x 125 x 380 mm
Poids : 5,6 kg
1)
Réglage de l'instrument et requête de paramètres, aucun transfert
possible des données présentes à l'écran.
Accessoires fournis : Cordon secteur, notice d’utilisation, 2 sondes 10 :1
avec prise en compte de l’atténuation (HZ200)
Accessoires en option :
HO720 Interface double RS232/ USB
HO730 Interface double Ethernet/ USB
HO740 Interface IEEE-488 (GPIB), isolée galvaniquement
HZ13 Câble d'interface (USB) 1,8m
HZ14 Câble d'interface 1:1
HZ20 Adaptateur pour fiche BNC–prises banane 4mm
HZ33 Câble de mesure 50Ω (BNC -BNC) 0,5 m
HZ34 Câble de mesure 50Ω (BNC -BNC) 1 m
HZ45 Kit pour montage en rack 19" 4U (hauteur de 125mm)
HZ51 Sonde 10:1 (150MHz)
HZ52 Sonde 10:1 HF (250MHz)
HZ53 Sonde 100:1 (100MHz)
HZ56-2 Pince ampèremétrique pour courant continu et alternatif
HZ70 Interface opto-isolée (avec cordon fibre optique)
HZ72 Câble d'interface IEEE-488
HZ100 Sonde différentielle 20:1/ 200:1
HZ109 Sonde différentielle 1:1/ 10:1
HZ115 Sonde différentielle 100:1/ 1000:1
HZ154 Sonde 1:1/10:1 (10 /100 MHz)
HZ350 Sonde 10:1 avec prise en compte de l’atténuation (350MHz)
HZ355 Sondes 10:1 avec id. auto. de l'atténuation
HZO20 Sonde passive 1000:1 (400MHz)
HZO30 Sonde active (1GHz)
HZO50 Pince ampèremétrique AC/ DC 20A, DC…100 kHz
HZO51 Pince ampèremétrique AC/ DC 1000A, DC…20 kHz
Caractéristiques techniques
Sous réserve de modifi cations
5
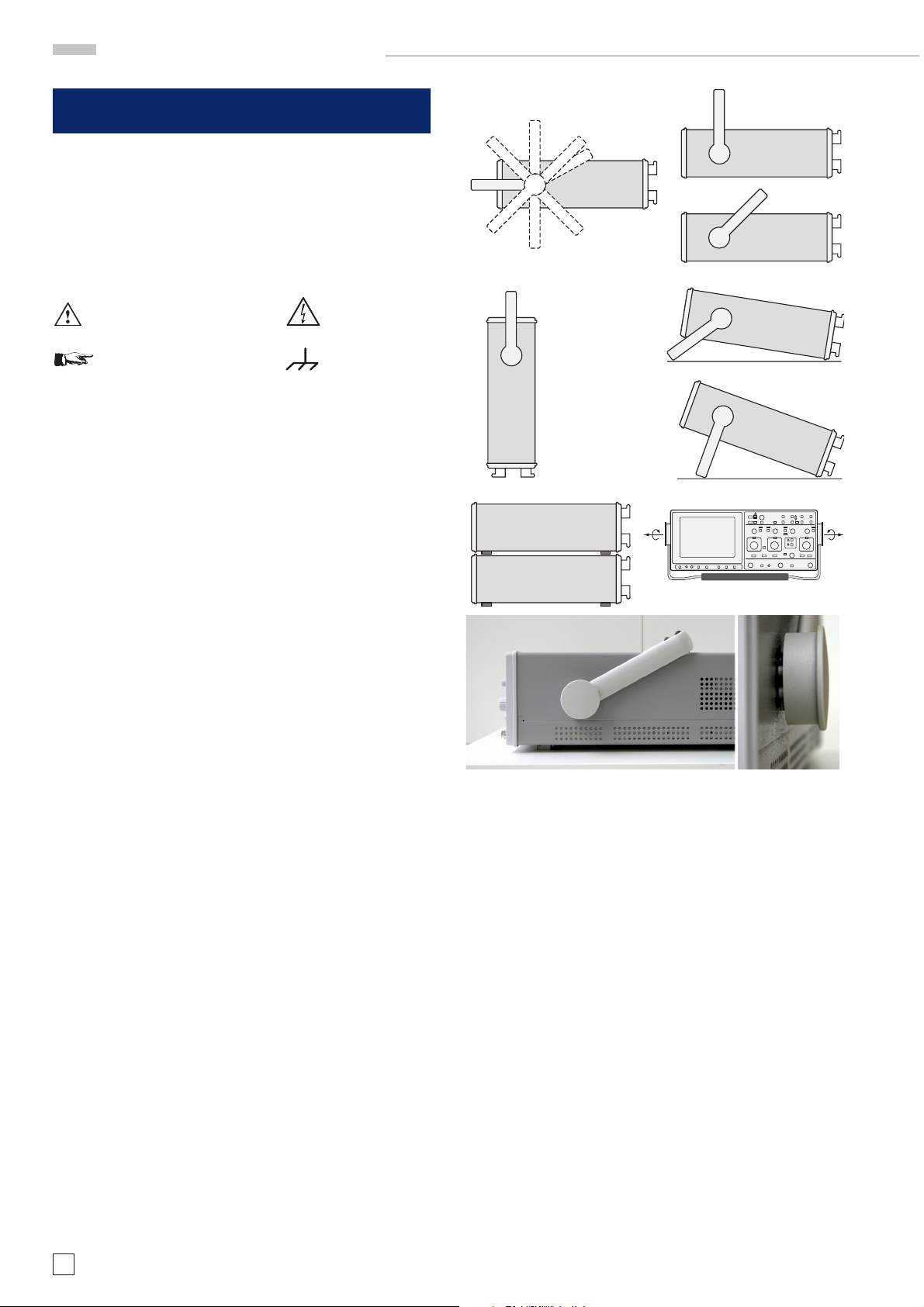
Remarques importantes
Remarques importantes
Examiner l’instrument immédiatement après l’avoir déballé
afi n d’y déceler d’éventuels dommages mécaniques ou des
pièces qui se seraient détachées à l’intérieur. Tout défaut lié
au transport doit être signalé immédiatement au fournisseur.
L’appareil ne doit pas être mis en service dans ce cas.
Symboles
Observer le mode d’emploi Haute tension
Consigne à respecter
impérativement ! Terre
Mise en place de l’appareil
Comme le montrent les images, la poignée peut prendre plusieurs positions
A et B = Position de transport
C = Position horizontale d’utilisation
D et E = Position d’utilisation avec différents angles
F = Position pour ôter la poignée
T = Position pour l’expédition de l’appareil dans son emballage
(boutons non cliqués)
Attention !
Avant tout changement de position de la poignée, l’oscilloscope
doit être posé sur une surface plane comme une table afi n de
prévenir tout risque de chute. Les boutons de chaque côté de
la poignée doivent être tirés simultanément vers l’extérieur et
tournés dans la position désirée. Si tel n’est pas le cas ils se
fi xeront (click) dans la position suivante selon la direction.
B
C
B
T
A
C
D
F
E
D
E
A
PUOPFGkT
PUOPFGkT PUOPFGkT
PUOPFGkT
PUOGkT
PUOPFGkT
PUOPFGkT
HM507
PUOPFGkT
PUOPFGkT
PUOPFGkT PUOPFGkT PUOPFGkT PUOPFGkT
PUOPFGkT
PUOPFGkT PUOPFGkT
PUk PUk PUk PUk PUk PUk
PUkT
HGOPFFD
PUOPFGkT
B
PUOPFGkT
PUkT
PUkT
PUkT
INPUT CHI
OPK
HJ
PUkT
VBN
PUOPFGkT
HJKL
PUOPFGkT
PUkT
PUOPFGkT
HGOFFD
PUkT
PUkT
PUkT
INPUT CHI
INPUT CHI
HAMEG
OPK
OPK
HJ
HJ
VBN
VBN
PUOPFGkT
HJKL
HJKL
T
T
Enlever/ fi xer la poignée
Selon le type d’appareil, la poignée peut être enlevée et de
nouveau fi xée dans les positions B ou F.
Sécurité
Cet appareil a été construit et testé conformément à la norme
VDE 0411, Partie 1, Dispositions de sécurité pour les appareils
de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire et a
quitté l’usine dans un état technique parfait du point de vue de
la sécurité. Il est également conforme aux dispositions de la
norme européenne EN 61010-1 ou de la norme internationale
CEI 1010-1. Pour obtenir cet état et garantir un fonctionnement sans danger, l’utilisateur doit respecter les consignes
et tenir compte des avertissements contenus dans le présent
mode d’emploi. Le boîtier, le châssis et toutes les bornes de
mesure sont reliés à la terre. L’appareil est conforme aux
dispositions de la classe de protection I. L’isolement entre les
parties métalliques accessibles et les bornes du secteur a été
contrôlé avec une tension continue de 2200 V.
Pour des raisons de sécurité, l’oscilloscope doit uniquement
être branché à des prises avec terre conformes à la réglementation. Il faut brancher la fi che secteur avant la connexion
des circuits de mesure. Il est interdit de couper la liaison à
la terre.
La majorité des tubes cathodiques produisent des rayons gamma. Sur cet appareil, le débit de dose ionique reste nettement
inférieur à la valeur autorisée par la loi de 36 pA/kg.
En cas de doute sur l’aptitude de l’appareil à fonctionner sans
danger, il faut le mettre hors service et le protéger contre toute
utilisation involontaire.
Cette supposition est justifi ée dans les cas suivants :
– lorsque l’appareil présente des dommages visibles,
– lorsque des pièces se sont détachées à l’intérieur de
l’appareil,
– lorsque l’appareil ne fonctionne plus,
– après un entreposage prolongé sous des conditions dé-
favorables (par exemple à l’air libre ou dans des locaux
humides),
– après de dégâts importants liés au transport (par exemple
dans un emballage non conforme aux exigences mini-
males pour un transport par voie postale, ferroviaire ou
routière).
Conditions de fonctionnement
ATTENTION!
L’instrument doit exclusivement être utilisé par des personnes familiarisées avec les risques liés à la mesure de
grandeurs électriques.
Pour des raisons de sécurité, l’oscilloscope doit uniquement
être branché à des prises avec terre conformes à la réglementation. Il est interdit de couper la liaison à la terre. Il faut
brancher la fi che secteur avant la connexion des circuits de
mesure.
6
Sous réserve de modifi cations

Remarques importantes
Garantie et réparation
Les instruments HAMEG sont soumis à un contrôle qualité
très sévère. Chaque appareil subit un test «burn-in» de 10
heures avant de quitter la production, lequel permet de détecter
pratiquement chaque panne prématurée lors d’un fonctionnement intermittent. L’appareil est ensuite soumis à un essai de
fonctionnement et de qualité approfondi au cours duquel sont
contrôlés tous les modes de fonctionnement ainsi que le respect
des caractéristiques techniques.
Les condition de garantie du produit dépendent du pays dans
lequel vous l’avez acheté. Pour toute réclamation, veuillez vous
adresser au fournisseur chez lequel vous vous êtes procuré
le produit.
Pour un traitement plus rapide, les clients de l’union européen-
ne (UE) peuvent faire effectuer les réparations directement par
HAMEG. Même une fois le délai de garanti dépassé, le service
clientèle de HAMEG se tient à votre disposition.
Return Material Authorization (RMA)
Avant chaque renvoi d’un appareil, veuillez réclamer un numéro
RMA par Internet: http://www.hameg.com ou par fax. Si vous ne
disposez pas d’emballage approprié, vous pouvez en commander un en contactant le service commercial de HAMEG (tel: +49
(0) 6182 800 500, E-Mail: service@ameg.com).
CAT I
Cet oscilloscope est conçu pour réaliser des mesures sur des
circuits électriques non reliés ou non reliés directement au
réseau. Les mesures directes (sans isolation galvanique) sur des
circuits de mesure de catégorie II, III ou IV sont interdites!
Les circuits électriques d’un objet mesuré ne sont pas reliés
directement au réseau lorsque l’objet mesuré est utilisé par
l’intermédiaire d’un transformateur d’isolement de protection
de classe II. Il est également possible d’effectuer des mesures
quasiment indirectes sur le réseau à l’aide de convertisseurs
appropriés (par exemple pinces ampèremétriques) qui répondent
aux exigences de la classe de protection II. Lors de la mesure, il
faut respecter la catégorie de mesure du convertisseur spécifi ée
par son constructeur.
Conditions ambiantes
La température ambiante admissible pendant le fonctionnement est comprise entre +5 °C et +40 °C. Elle peut être comprise
entre –20 °C et +70 °C pendant le stockage et le transport.
Si de la condensation s’est formée pendant le transport ou
le stockage, il faut laisser l’appareil s’acclimater pendant 2
heures environ avant de le mettre en service. L’oscilloscope
est conçu pour être utilisé dans des locaux propres et secs. Il
ne doit pas être utilisé dans une atmosphère particulièrement
chargée en poussière ou trop humide, dans un environnement
explosible ou en présence d’agression chimique. La position de
fonctionnement est sans importance, mais il faut prévoir une
circulation d’air suffi sante (refroidissement par convection).
En fonctionnement continu, il faut accorder la préférence à la
position horizontale ou inclinée (poignée béquille).
Il ne faut pas couvrir les orifi ces d’aération !
Les caractéristiques nominales avec les tolérances indiquées
ne sont valides qu’après une période de chauffe d’au moins 30
minutes et pour une température ambiante comprise entre
15 °C et 30 °C. Les valeurs sans indication de tolérance sont
celles d’un appareil standard.
Entretien
L’extérieur de l’oscilloscope doit être nettoyé régulièrement avec
un pinceau à poussière. La saleté tenace sur le coffret, la poignée,
les parties en plastique et en aluminium peut être enlevée avec
un chiffon humide (eau +1 % de détergent). De l’alcool à brûler
ou de l’éther de pétrole peut être utilisé pour des impuretés
grasses. L’écran doit uniquement être nettoyé avec de l’eau ou
de l’éther de pétrole (pas d’alcool ni de solvant) et doit ensuite
être essuyé avec un chiffon propre, sec et non pelucheux. Après
l’avoir nettoyé, il est recommandé de le traiter avec une solution
antistatique standard conçue pour les matières plastiques. Le
liquide de nettoyage ne doit en aucun cas pénétrer dans l’appareil.
L’utilisation d’autres produits de nettoyage risque d’attaquer les
surfaces en plastique et vernies.
Circuit de protection
Catégories de mesure
Les catégories de mesure se rapportent aux transitoires sur
le réseau. Les transitoires sont des variations de tension et
de courant courtes et très rapides (raides) qui peuvent se
produire de manière périodique et non périodique. L’amplitude
des transitoires possibles augmente d’autant plus que la distance par rapport à la source de l’installation basse tension
est faible.
Catégorie de mesure IV: mesures à la source de l’installation
basse tension (par exemple sur des compteurs).
Catégorie de mesure III: mesure dans l’installation du bâtiment
(par exemple distributeur, contacteur de puissance, prises
installées à demeure, moteurs installés à demeure, etc.).
Catégorie de mesure II: mesures sur des circuits électriques
qui sont directement relié au réseau basse tension (par exemple
appareils domestiques, outillage électroportatif, etc.).
Catégorie de mesure I: Mesures sur les circuits électriques
non reliés directement au réseau Appareils sur piles, batteries,
isolés galvaniquement.
Domaine d’application
L’oscilloscope est conçu pour être utilisé dans les secteurs
industriel, domestique, commercial et artisanal ainsi que dans
les petites entreprises.
Cet appareil est équipé d’un bloc d’alimentation à découpage
muni de circuits de protection contre les surtensions et les
surintensités. Un bruit de cliquetis périodique peut se faire
entendre en cas de défaut.
Tension du réseau
L’appareil fonctionne avec des tensions alternatives à 50 et 60
Hz comprises entre 105 V et 253 V. Aucun dispositif de commutation des différentes tensions de réseau n’a donc été prévu.
Le fusible d’alimentation est accessible depuis l’extérieur.
L’embase secteur et le porte-fusible forment un seul bloc. Le
remplacement du fusible ne doit et ne peut (si le porte-fusible ne
soit pas endommagé) s’effectuer qu’après avoir retiré le cordon
secteur de l’embase. Il faut ensuite faire sortir le porte-fusible à
l’aide d’un tournevis en prenant appui sur la fente qui se trouve
du côté des contacts. Le fusible peut alors être poussé hors
de son support et remplacé. Enfoncer le porte-fusible jusqu’à
ce qu’il s’enclenche. Vous devez ressentir la résistance d’un
ressort. Il est interdit d’utiliser des fusibles « bricolés » ou de
court-circuiter le porte-fusible. Les dommages qui en résulteraient ne sont pas couverts par la garantie.
Type de fusible: Taille 5 x 20 mm ; 250 V~, C ;
IEC 127, feuille III ; DIN 41 662
(éventuellement. DIN 41 571, feuille 3).
Coupure : temporisée (T), 0,8 A.
Sous réserve de modifi cations
7
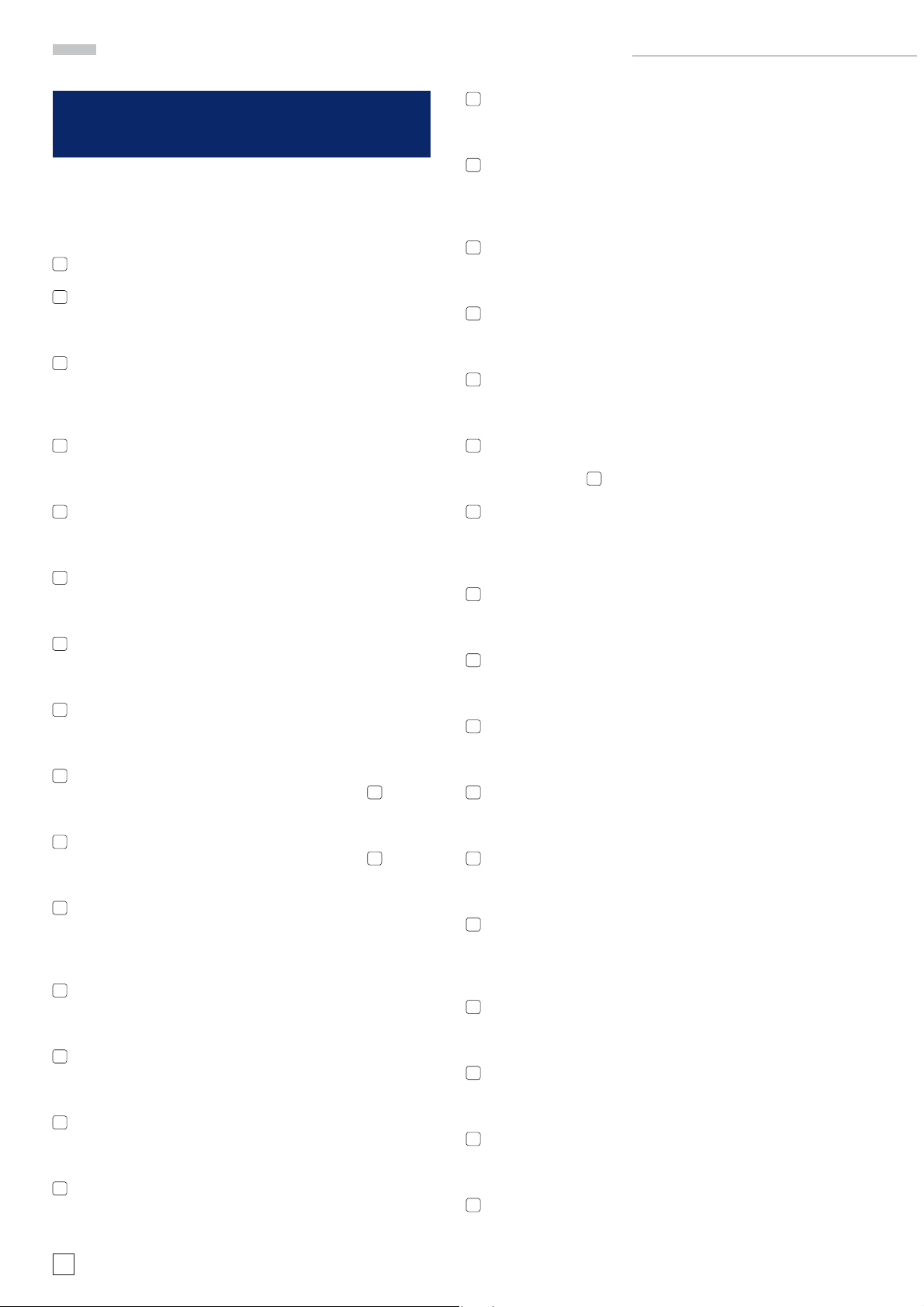
Description sommaire des éléments de commande
Description sommaire des éléments
de commande
Ces numéros de pages renvoient à la description détaillée dans le
chapitre «Eléments de comman
1
POWER (touche) – mise sous tension, Marche/Arrêt. 26
2
INTENS (bouton) 26
Réglage de la luminosité de la trace et autres fonctions
lorsque le symbole du bouton est indiqué.
3
FOCUS, TRACE, MENU (touche) 26
Invocation du menu avec affi chage du Readout, permet de
modifi er différents paramètres (par exemple focus, rotation
de la trace, etc.) avec le bouton INTENS.
de et Readout» !
16
MODE (touche) 31
Invocation du menu de sélection du mode de déclenche-
ment.
17
FILTER (touche) 32
Invocation du menu de sélection du fi ltre de déclenchement
(couplage), de suppression du bruit et du sens du front e
déclenchement.
18
SOURCE (touche) 32
Invocation du menu de sélection des sources de déclenche-
ment (par ex. CH1, CH2, Alt. 1/2, externe secteur).
19
TRIG’d (LED) 33
Ce témoin s’allume lorsque le signal de déclenchement
satisfait aux conditions de déclenchement.
20
NORM (LED) 33
Ce témoin s’allume en présence d’un déclenchement nor-
mal.
4
CURSOR MEASURE (touche) 26
Invocation du menu avec sélection des mesures au curseur
et activation de celles-ci.
5
SAVE/RECALL (touche) 27
Ce menu permet d’accéder à la mémoire des paramètres
de l’appareil.
6
SETTINGS (touche) 27
Menu permettant de défi nir des paramètres généraux ainsi
que la langue.
7
AUTOSET (touche) 28
Permet un réglage automatique de l’appareil en fonction
du signal présent.
8
HELP (touche) 28
Affi che/masque le texte d’aide à propos des éléments de
commande et des menus.
9
POSITION 1 (bouton) 28
Changements de position de la fonction courante
11
: signal,
curseur et séparation de trace (base de temps B).
10
POSITION 2 (bouton) 28
Changements de position de la fonction courante
11
: signal,
curseur et séparation de trace (base de temps B).
11
CH1/2-CURSOR-TRACE SEP (touche) 29
Invocation du menu et affi chage en couleur de la fonc-
tion courante défi nie ici de POSITION 1 et 2 (si CH1/2 est
éteint).
12
VOLTS/DIV-VAR (bouton) 29
Bouton de réglage du calibre vertical, du vernier Y (VAR) et
de mise à l’échelle pour la voie 1.
13
VOLTS/DIV-VAR (bouton) 29
Bouton de réglage du calibre vertical, du vernier Y (VAR) et
de mise à l’échelle pour la voie 2.
14
AUTO MEASURE (touche) 30
Invocation du menu et des sous-menus pour les mesures
automatiques et leur activation.
15
LEVEL A/B (bouton) 30
Réglage du niveau de déclenchement pour le mode base de
temps A et B.
21
HOLD OFF (LED) 33
Ce témoin s’allume si la durée d’inhibition réglée dans le
menu HOR VAR
22
X-POS /DELAY (touche) 34
26
est différente de 0 %.
Invocation du menu et affi chage en couleur de la fonction
courante défi nie ici du bouton HORIZONTAL (si X-POS est
éteint).
23
HORIZONTAL (bouton) 34
Modifi e la position horizontale ou le temps de retard de la
base de temps B.
24
TIME/DIV-VAR (bouton) 34
Bouton de réglage du calibre de la base de temps A et B,
du vernier horizontal (VAR) et de mise à l’échelle.
25
MAG x10 (touche) 34
En mode Yt (base de temps), expansion de l’axe X d’un fac-
teur 10 avec modifi cation simultanée du calibre affi ché.
26
HOR / VAR (touche) 35
Invocation du menu des bases de temps analogiques A et
B, vernier horizontal et durée d’inhibition.
27
CH1 / VAR (touche) 36
Invocation du menu pour la voie 1 : couplage d’entrée (AC,
DC, GND), inversion, sonde atténuatrice et vernier vertical.
28
VERT/XY (touche) 37
Invocation du menu avec sélection des modes suivants de
l’amplifi cateur vertical ou addition et mode XY et limitation
de la bande passante.
29
CH2 / VAR (touche) 38
Invocation du menu pour la voie 2 : couplage d’entrée (AC,
DC, GND), inversion, sonde atténuatrice et vernier vertical.
30
INPUT CH1 (Prise BNC) 39
Entrée du signal de la voie 1 et entrée déviation horizontale
en mode XY.
31
INPUT CH2 (Prise BNC) 39
Entrée du signal de la voie 2 et entrée déviation verticale en
mode XY.
32
AUX (Touche) 39
Invocation du Menu: AUXILIARY INPUT (entrée auxiliaire)
8
Sous réserve de modifi cations
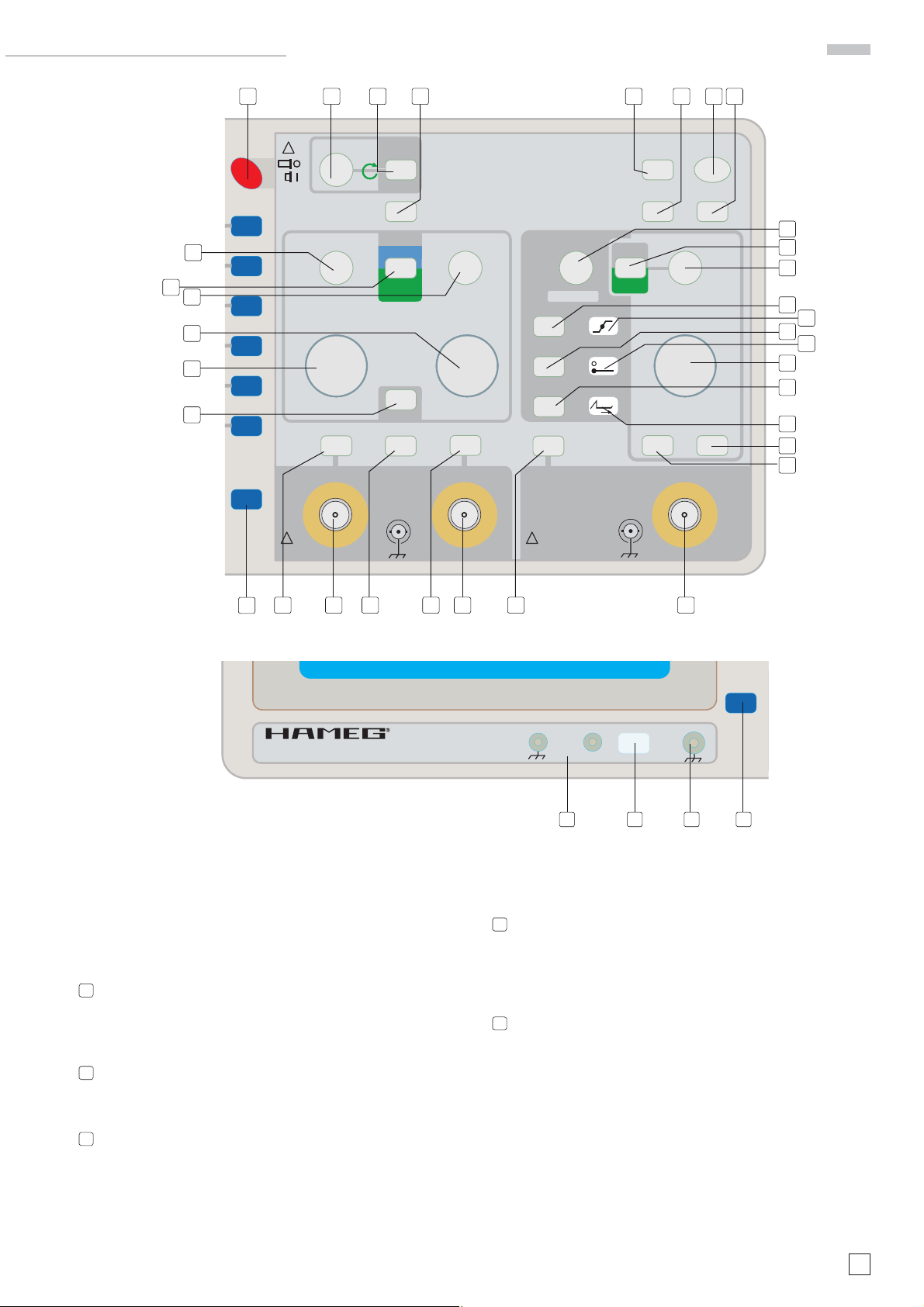
CH I: 500 mV
POWER
MENU
OFF
Description sommaire des éléments de commande
POWER
MENU
OFF
1 2 3 4 5 876
POWER
INTENS
!
FOCUS
TRACE
150 MHz
SAVE/
RECALL
AUTOSET
ANALOG
MENU
CURSOR
MEASURE
9
11
10
13
POSITION 1 POSITION 2
VOLTS / DIV
VAR
12
14
MENU
OFF
20 V 1 mV 20 V 1 mV
CH 1 CH 2 HOR MAG
CH 1 CH 2
X-INP
!
CAT I
CH 1/2
CURSOR
TRACE
SEP
AUTO
MEASURE
VAR VAR VAR x1 0
VERT/XY
INPUTS
1MΩII15pF
max
400 Vp
OSCILLOSCOPE
HM1500-2
VOLTS / DIV
VAR
MODE
FILTER
SOURCE
AUX
!
CAT I
LEVEL A/B
TRIGGER
TRIG ’ d
NORM
HOLD OFF
SETTINGS HELP
HORIZONTAL
X-POS
DELAY
TIME / DIV
VAR
0.5s 50ns
AUXILIARY INPUT
TRIG. EXT. / Z-INP.
1MΩ II
15pF
max
100 Vp
15
22
23
16
19
17
20
24
18
21
25
26
37
27 30 28 29 31 32
ANALOGSCOPE
Instruments
pour l’entrée d’un signal de déclenchement externe,
activation de l’entrée pour la modulation de l‘intensité (Z)
lorsque le déclenchement externe est désactivé.
33
AUXILIARY INPUT (Prise BNC) 40
Entrée pour un signal de déclenchement externe ou pour
la modulation d’intensité du faisceau (modulation de
Wenhelt ou modulation Z).
34
PROBE ADJ (prise) 40
Sortie d’un signal rectangulaire pour la compensation en
fréquence des sondes atténuatrices 10 : 1.
33
MENU
OFF
COMP.
TESTER
PROBE
ADJ
36 35 34 37
36
COMPONENT TESTER
(2 prises de 4 mm de diamètre) 40
Raccordement des cordons de mesure du testeur de com-
posants. La prise de gauche est reliée galvaniquement à la
terre.
37
MENU OFF (touche) 40
Referme le menu ou ramène au niveau de menu supéri-
eur.
35
PROBE COMPONENT TESTER (touche) 40
Invocation du menu pour l’activation ou la désactivation du
testeur de composants, la sélection de la fréquence du signal sur la prise PROBE ADJ., l’affi chage d’informations sur
le matériel et le logiciel de l’instrument ainsi que l’interface
(face arrière de l’appareil), si installée.
Sous réserve de modifi cations
9
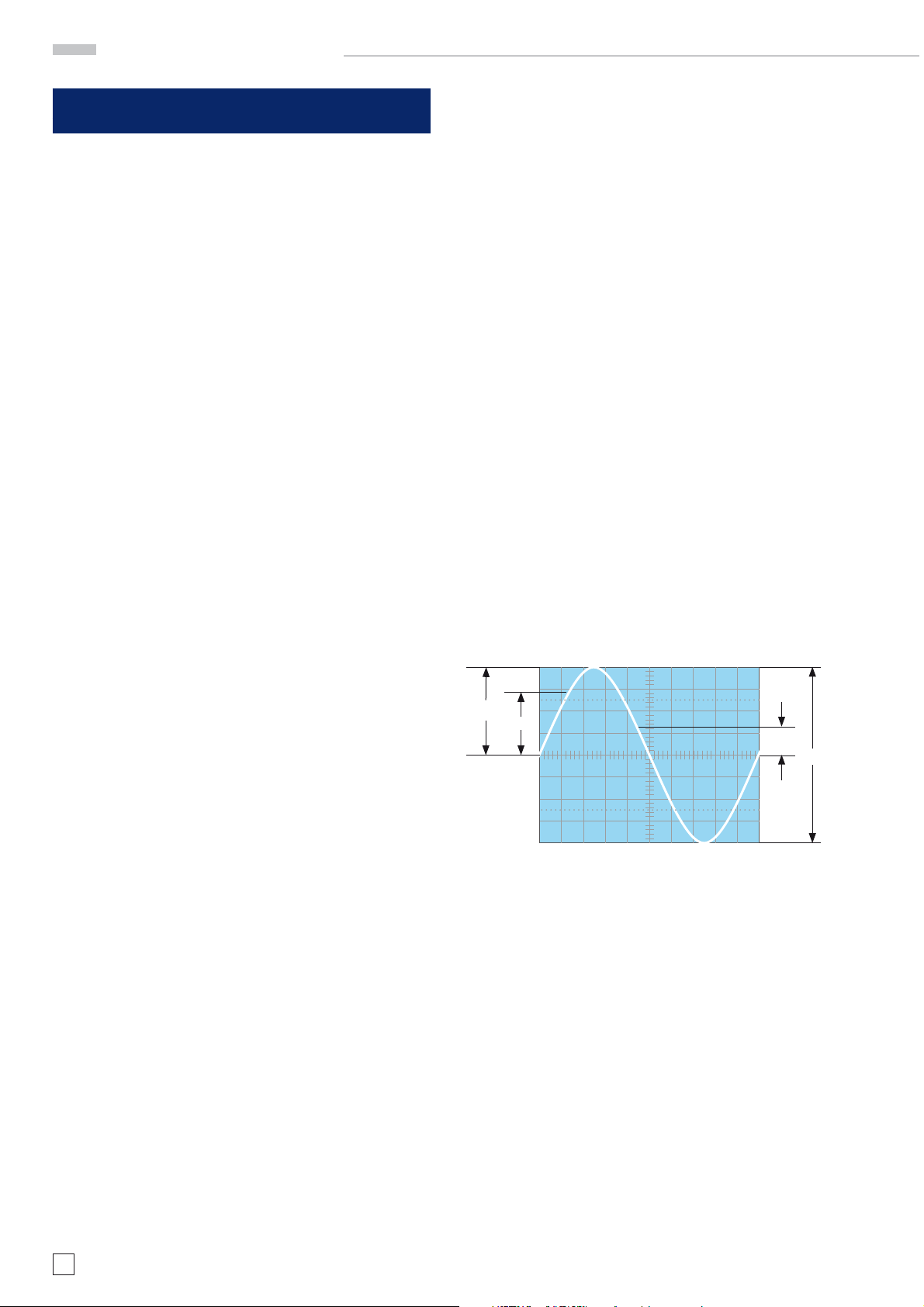
Principes généraux
Principes généraux
Nature du signal
L’oscilloscope HM1500-2 détecte en temps réel pratiquement
tous les types de signaux qui se répètent périodiquement (tensions alternatives) jusqu’à des fréquences d’au moins 100 MHz
(–3 dB) ainsi que les tensions continues.
L’amplifi cateur vertical est conçu de façon à ce que la qualité
de la transmission ne soit pas infl uencée par ses propres
suroscillations.
La représentation de phénomènes électriques simples tels que
des signaux sinusoïdaux HF et BF ou les tensions d’ondulation
fréquentes sur le secteur ne pose aucun problème particulier.
Lors des mesures à partir de 70 MHz environ, il faut tenir compte
d’une erreur de mesure de plus en plus importante liée à la
chute de l’amplifi cation. La chute est d’environ 10 % à 100 MHz,
dans quel cas la valeur réelle de la tension est environ 11 %
supérieure à la valeur affi chée. Il est impossible de défi nir avec
exactitude l’erreur de mesure en raison des bandes passantes
différentes des amplifi cateurs verticaux (-3 dB entre 150 MHz
et 170 MHz)
Dans le cas des phénomènes sinusoïdaux, la limite de –6 dB
du HM1500-2 se situe à 140 MHz.
Lors de l’acquisition de signaux rectangulaires ou impulsionnels, il faut tenir compte du fait qu’il faut également transmettre
leurs composantes harmoniques. Par conséquent, la fréquence
de récurrence du signal doit être nettement inférieure à la
fréquence limite supérieure de l’amplifi cateur vertical (environ
5 à 10 fois). Il faut tenir compte de ce fait lors de l’analyse de
signaux de ce type.
La représentation de signaux mélangés est plus difficile,
notamment lorsqu’ils ne contiennent pas de niveaux élevés
qui se répètent à la fréquence de récurrence et sur lesquels
l’oscilloscope pourrait être déclenché. C’est le cas des signaux
en rafale (burst), par exemple. Une modifi cation de la durée
d’inhibition (HOLD OFF) est nécessaire dans certains cas pour
obtenir là aussi une image bien synchronisée.
Le séparateur synchro TV actif permet un déclenchement aisé
sur les signaux vidéo-composites.
La résolution horizontale ne pose aucun problème. À une
fréquence de 100 MHz, par exemple, et avec le plus petit calibre
possible de la base de temps (5 ns/cm), la période tracée du
signal est supérieure à 2 cm.
L’entrée de chaque amplifi cateur vertical peut être utilisée
en couplage AC ou DC (DC = direct current ; AC = alternating current) permettant un fonctionnement au choix en tant
qu’amplificateur de tension alternative ou continue. Il est
conseillé de n’utiliser le couplage courant continu DC qu’avec
une sonde atténuatrice ou à des fréquences très basses ou
alors lorsqu’il faut impérativement détecter la composante
continue du signal.
Des inclinaisons de palier parasites peuvent apparaître lors
de la mesure d’impulsions à très basse fréquence avec un
couplage AC (courant alternatif) de l’amplifi cateur vertical
(fréquence limite en AC 1,6 Hz pour -3 dB). Il faut alors accorder
la préférence au couplage DC, sous réserve qu’aucune tension
continue élevée ne soit superposée au signal. Le cas contraire,
il faut brancher un condensateur de valeur appropriée avant
l’entrée de l’amplifi cateur de mesure commuté sur couplage
DC. Celui-ci doit posséder une rigidité diélectrique suffi samment élevée. Le couplage DC est également à recommander
pour la représentation de signaux logiques et d’impulsions,
notamment lorsque le rapport cyclique varie constamment. Le
cas contraire, l’image se déplace vers le haut ou vers le bas à
chaque modifi cation. Les tensions continues pures ne peuvent
être mesurées qu’en couplage DC.
Le couplage d’entrée sélectionné est indiqué dans le READOUT
(écran). Le symbole « = » indique le couplage DC alors que le
couplage AC est indiqué par le symbole « ~ » (voir « Éléments
de commande et Readout »).
Amplitude du signal
En électrotechnique, les tensions alternatives sont généralement indiquées en valeur effi cace. La valeur crête à crête Vcc
est cependant utilisée pour désigner les amplitudes et les
tensions mesurées avec un oscilloscope. Celle-ci correspond
à la différence de potentiel réelle entre le point le plus positif
et le point le plus négatif d’une tension telle qu’elle est représentée à l’écran.
Si l’on veut convertir une grandeur sinusoïdale représentée
sur l’écran de l’oscilloscope en valeur effi cace, il faut diviser
la valeur Vcc par 2 x √2 =2,83. À l’inverse, il faut tenir compte
du fait que les tensions sinusoïdales indiquées en Veff ont une
différence de potentiel 2,83 fois supérieure en V
. La fi gure
cc
ci-dessous représente les relations entre les différentes amplitudes de tension.
Valeurs de la tension sur une courbe sinusoïdale
V
c
V
eff
V
mom
V
cc
V
= valeur effi cace;
eff
V
= valeur de crête simple;
c
V
= valeur crête à crête;
cc
V
= valeur momentanée (en fonction du temps)
mom
La tension de signal minimale requise à l’entrée Y pour une
image de 1 cm de hauteur est de 1 mVcc (±5 %) lorsque le coeffi cient de déviation indiqué par le READOUT (écran) est de
1 mV et que le vernier de réglage fi n est en position calibrée.
Il est toutefois possible d’enregistrer des signaux encore plus
petits. Les coeffi cients de déviation possibles sont indiqués en
mV
/cm ou en Vcc/cm. La grandeur de la tension du signal peut
cc
être déterminée à l’aide du curseur en tenant auto-matiquement compte de la sonde atténuatrice et elle est indiquée par
le Readout. Dans le cas des sondes atténuatrices avec identifi cation du facteur d‘atténuation, la prise en compte s’effectue
automatiquement et avec une priorité supérieure à la détermination manuelle, également possible, du facteur d’atténuation.
Le coeffi cient de déviation est affi ché dans le Readout en tenant
compte du facteur d’atténuation.
Le vernier de réglage fi n doit se trouver en position calibrée
pour les mesures de l’amplitude. Hors calibrage, la sensibilité
10
Sous réserve de modifi cations
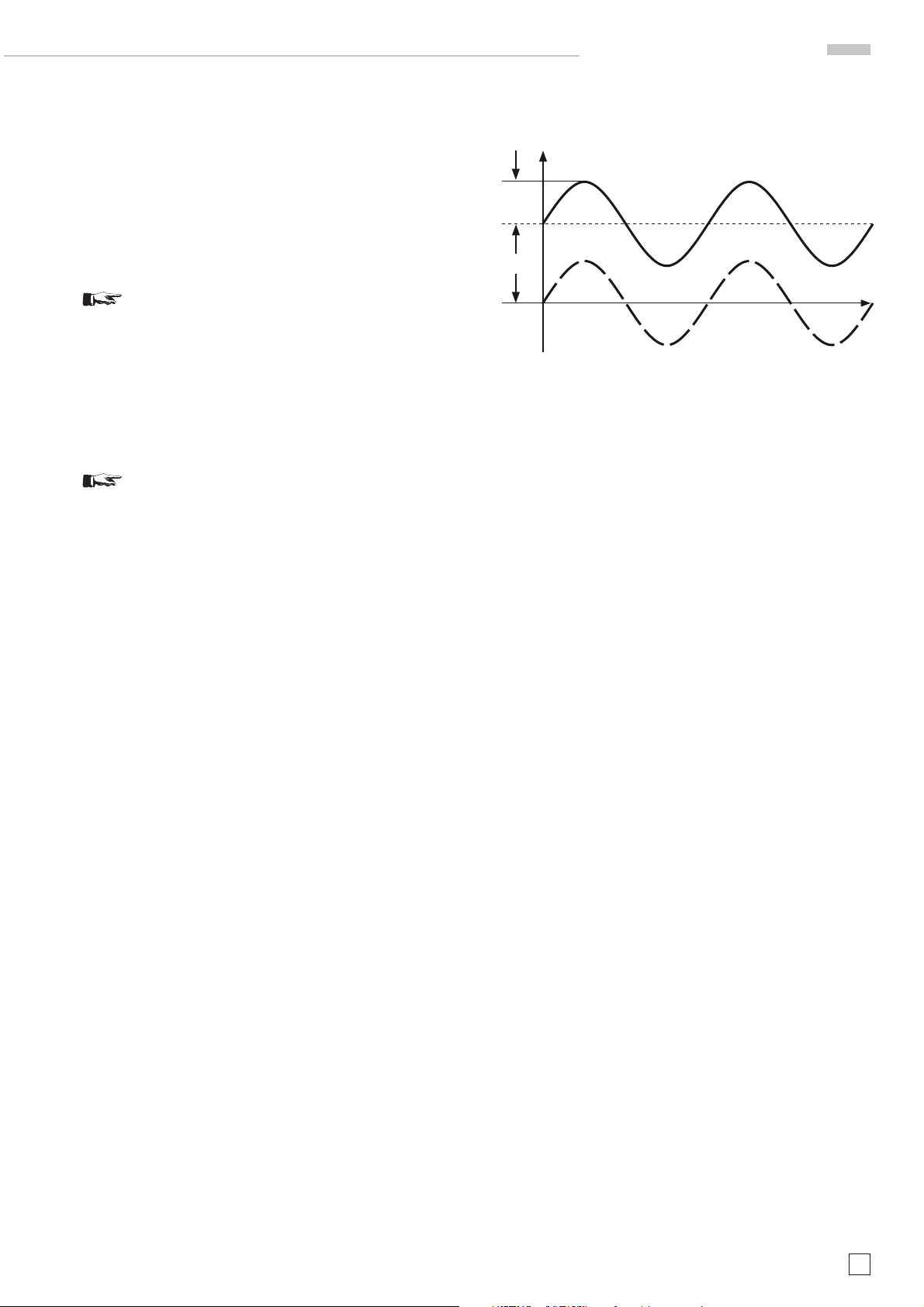
Principes généraux
de déviation peut être réduite continuellement (voir «Éléments
de commande et Readout»). Il est ainsi possible de régler
toutes les valeurs intermédiaires au sein des positions 1-2-5
du commutateur d’atténuation. Des signaux jusqu’à 400 V
cc
environ peuvent ainsi être représentés sans sonde atténuatrice
(coeffi cient de déviation 20 V/cm – réglage fi n 2,5:1 – hauteur
de la grille 8 cm).
S’il faut déterminer l’amplitude du signal sans les curseurs,
il suffi t de multiplier sa hauteur en cm par le coeffi cient de
déviation (calibré) affi ché.
En l’absence de sonde atténuatrice, la tension à
l’entrée Y ne doit pas dépasser 400 V (quelle que
soit la polarité).
Si le signal à mesurer est une tension alternative à laquelle est
superposée une tension continue (tension mixte), la valeur maximale admissible des deux tensions (tension continue et valeur
de crête simple de la tension alternative) est également de +
ou de –400 V. Les tensions alternatives dont la valeur moyenne
est nulle ne doivent pas dépasser 800 V
.
cc
Lors d’une mesure avec des sondes atténuatrices,
leurs valeurs limites éventuellement plus élevées
ne s’appliquent que si l’entrée de l’oscilloscope est
en couplage DC.
Si une tension continue est appliquée à l’entrée et que le
couplage d’entrée se trouve sur AC, la tension ne doit pas
être supérieure à la valeur limite la plus basse de l’entrée
de l’oscilloscope (400 V). Le diviseur de tension constitué de
la résistance dans la sonde et de la résistance d’entrée de
1 MΩ de l’oscilloscope est sans effet pour les tensions continues en raison du condensateur qui y est intercalé dans le cas
d’un couplage AC. La tension continue non divisée est alors
en même temps appliquée au condensateur. Dans le cas des
tensions mixtes, il faut tenir compte du fait que leur composante
continue n’est pas non plus divisée avec un couplage AC alors
que la composante alternative subit une division dépendante de
la fréquence et liée à la résistance capacitive du condensateur
de couplage. Le facteur d’atténuation de la sonde peut être
supposé exact pour les fréquences ≥40 Hz.
En considération des conditions décrites précédemment, les
sondes atténuatrices HAMEG 10:1 de type HZ200 permettent de
mesurer des tensions continues jusqu’à 400 V ou des tensions
alternatives (dont la valeur moyenne est nulle) jusqu’à 800 V
cc
Les sondes spéciales 100:1 (par exemple la HZ53) permettent de
mesurer des tensions continues jusqu’à 1200 V ou des tensions
alternatives (dont la valeur moyenne est nulle) jusqu’à 2400
V
. Cette valeur diminue cependant aux fréquences élevées
cc
(voir les caractéristiques techniques de la HZ53). Avec une
sonde atténuatrice 10:1 normale, des tensions aussi élevées
risquent de provoquer un claquage du trimmer C qui shunte la
résistance série de la sonde et ainsi d’endommager l’entrée Y
de l’oscilloscope.
Une sonde 10:1 est cependant suffi sante s’il faut seulement
mesurer l’ondulation résiduelle d’une haute tension, par exemple. Celle-ci doit alors être précédée d’un condensateur
haute tension approprié (environ 22-68 nF).
Une ligne horizontale du graticule peut être prise comme ligne
de référence du potentiel de masse avant la mesure en plaçant
le couplage d’entrée sur GND et en se servant du bouton de réglage POSITION. Elle peut se trouver n’importe où par rapport à
la ligne médiane, en fonction de la valeur positive et/ou négative
des écarts à mesurer par rapport au potentiel de masse.
Valeur totale de la tension d’entrée
Tension
crête
AC
DC
DC + AC
DC
AC
crête
= 400 V
max
La courbe discontinue montre une tension alternative qui oscille
autour de 0 volt. Si une tension continue (DC) est superposée à
cette tension, l’addition de la crête positive et de la tension continue donne la tension maximale appliquée (DC + crête AC).
Valeurs du temps du signal
Les signaux mesurés avec un oscilloscope sont généralement
des courbes de tension qui se répètent dans le temps et qui
seront appelée ci-après des périodes. Le nombre de périodes
par seconde est la fréquence de récurrence. Plusieurs périodes du signal peuvent être représentées ou alors une partie
seulement d’une période, suivant le réglage de la base de temps
(TIME/DIV.). Les calibres de la base de temps sont affi chés dans
le Readout (écran) et indiqués en s/cm, ms/cm, μs/cm et ns/cm
(1 cm correspond à 1 division sur la grille à l’écran). La durée de
la période ou la fréquence du signal peuvent être déterminées
en toute simplicité à l’aide des curseurs en mode mesure du
Δt ou du Δ1/t (fréquence).
S’il faut déterminer la durée d’un signal sans les curseurs, il
suffi t de multiplier sa durée relevée en cm par le coeffi cient de
déviation (calibré) affi ché.
ème
La 2
peuvent être utilisées si l’intervalle de temps à mesurer est relativement court par rapport à la période complète du signal.
L’intervalle de temps intéressant peut être amené au centre
de l’écran à l’aide du bouton HORIZONTAL.
.
La réaction du système à une tension impulsionnelle est
déterminée par son temps de montée. Les temps de montée
et de descente d’une impulsion sont mesurés entre 10 et
90% de son amplitude totale.
L’exemple suivant décrit la lecture à l’aide du graticule de
l’écran. La lecture peut toutefois également être effectuée de
manière considérablement plus simple à l’aide des curseurs
en mode mesure du temps de montée (voir «Éléments de
commande et Readout»).
Mesure:
– Le front de l’impulsion est réglé exactement à une hauteur
– Le front est positionné en symétrie par rapport à la ligne mé-
– Relever les points d’intersection du front du signal avec
base de temps ou l’expansion horizontale (MAGX10)
inscrite de 5 cm (à l’aide du calibre Y et du vernier de réglage
fi n).
diane X et Y (avec les boutons de réglage X-Pos. et Y-Pos.).
les lignes 10% et 90% et déterminer leur écart dans le
temps.
Sous réserve de modifi cations
11
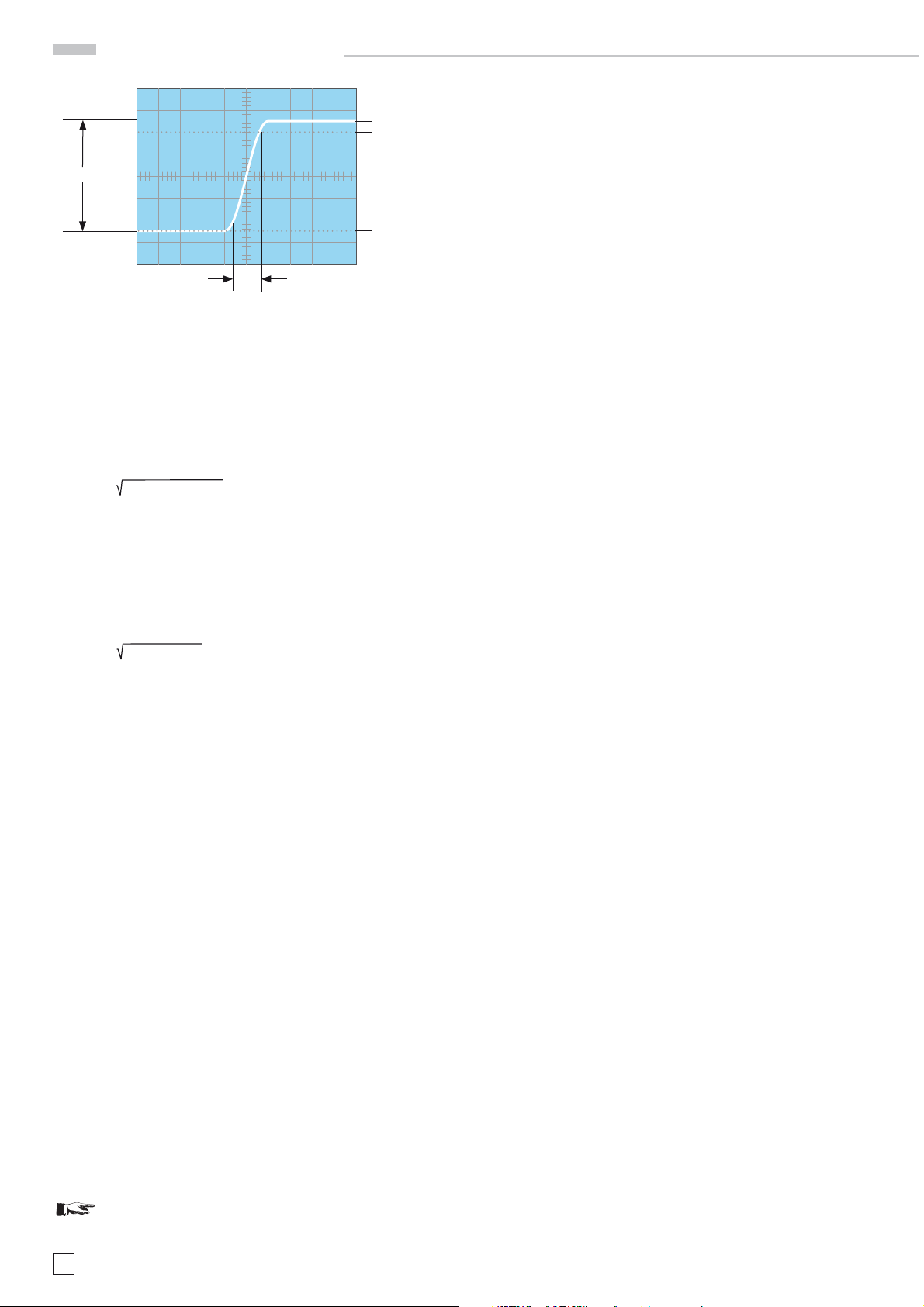
Principes généraux
100%
90%
5 cm
10%
0%
t
mes
Si le calibre de la base de temps est de 5 ns/cm, l’exemple
d’image donne un temps de montée mesuré total de
t
= 1,6 cm x 5 ns/cm = 8 ns
mes
Avec des temps très courts, le temps de montée de l’amplifi cateur
vertical de l’oscilloscope et celui de la sonde atténuatrice éventuellement utilisée sont à déduire géométriquement de la valeur
mesurée. Le temps de monté du signal est alors de
2
2
ta= t
t
correspond ici au temps de montée total mesure, t
tot
mes
– t
de l’oscilloscope (environ 2,3 ns pour le HM1500-2) et t
de la sonde atténuatrice, par exemple 2 ns. Si t
osc
– t
2
t
à celui
osc
à celui
t
est supérieur à
tot
22 ns, le temps de montée de l’amplifi cateur vertical peut alors
être négligé (erreur <1 %).
L’exemple ci-dessus donne ainsi un temps de montée du
signal de
ta= 82 - 2,32 - 22 = 7,4 ns
La mesure du temps de montée ou de descente ne se limite
naturellement pas au réglage de l’image illustré ci-dessus,
celle-ci ne fait que la simplifi er. La mesure peut en principe
être effectuée quelles que soient la position de l’image et
l’amplitude du signal. Le plus important est que le front intéressant du signal soit visible sur toute sa longueur avec une
pente pas trop raide et que l’écart horizontal soit mesuré à
10 % et à 90 % de l’amplitude. Si le front présente des préou des suroscillations, il ne faut pas rapporter les 100 % aux
valeurs de crête, mais au niveau de régime établi. De même,
il ne faut pas tenir compte des creux ou des pointes à côté du
front. La mesure du temps de montée ou de descente perd
toutefois tout son sens en présence de fortes distorsions
transitoires. La relation suivante entre la valeur numérique du
temps de montée t
(en ns) et la bande passante B (en MHz)
r
s’applique aux amplifi cateurs ayant un temps de propagation
de groupe quasiment constant (c’est-à-dire un bon comportement impulsionnel):
350 350
t
=
——
a
B t
B =
——
a
Application du signal
Une brève pression sur la touche AUTOSET suffi t pour obtenir
automatiquement un réglage approprié de l’appareil en fonction
du signal (voir AUTOSET). Les explications suivantes se rapportent à des applications spéciales qui nécessitent une commande
manuelle. La fonction des éléments de commande est décrite
dans la partie «Éléments de commande et Readout».
Prudence lors de l’application de signaux inconnus
à l’entrée verticale !
Il est recommandé de toujours effectuer la mesure avec une
sonde atténuatrice ! En l’absence de sonde atténuatrice, il
convient de commencer par le couplage AC et le calibre 20
V/cm. Si la trace disparaît brutalement après l’application du
signal, il est possible que l’amplitude du signal soit beaucoup
trop importante et sature complètement l’amplifi cateur vertical. Il faut alors augmenter le coeffi cient de déviation (réduire
la sensibilité) jusqu’à ce que la déviation verticale ne soit plus
que de 3-8 cm. En cas de mesure calibrée de l’amplitude et
avec des signaux dont l’amplitude est supérieure à 160 Vcc,
il faut impérativement utiliser une sonde atténuatrice dont la
rigidité diélectrique doit supporter le signal mesuré. La trace
s’assombrit si la durée de la période du signal mesuré est nettement supérieure au calibre choisi de la base de temps. Il faut
alors augmenter le coeffi cient de déviation horizontale.
Le signal à enregistrer peut être appliqué à l’entrée Y de
l’oscilloscope directement avec un câble de mesure blindé tel
que HZ 32 ou HZ 34, par exemple, ou par le biais d’une sonde
atténuatrice 10:1. L’utilisation des câbles de mesure indiqués
sur des objets à haute impédance n’est cependant recommandée qu’en travaillant avec des signaux sinusoïdaux à des
fréquences relativement faibles (jusqu’à 50 kHz environ). Pour
les fréquences plus élevées, la source de tension de mesure
doit être de faible résistance, c’est-à-dire adaptée à l’impédance
du câble (généralement 50 Ω).
Plus particulièrement lors de la transmission de signaux
rectangulaires et impulsionnel, le câble doit être muni d’une
terminaison ayant une résistance égale à l’impédance du
câble et montée directement à l’entrée Y de l’oscilloscope. La
charge de passage 50 Ω HAMEG HZ22 peut être utilisée ici en
combinaison avec un câble de 50 Ω tel que le HZ34, par exemple. Des distorsions transitoires parasites peuvent notamment
apparaître sur les fronts et les crêtes lors de la transmission de
signaux rectangulaires à temps de montée court. Les signaux
sinusoïdaux à haute fréquence (>100 kHz) doivent eux aussi en
principe seulement être mesurés avec une charge de passage.
Les amplifi cateurs, les générateurs ou leurs atténuateurs ne
peuvent généralement maintenir leur tension de sortie nominale indépendamment de la fréquence que si leurs câbles de
raccordement sont munis d’une terminaison ayant la résistance
préconisée.
Il faut ici tenir compte du fait que la charge de passage HZ22
supporte une charge maximale de 1 watt. Cette puissance est
atteinte avec une tension de 7 V
ou de 19,7 Vcc dans le cas d’un
eff
signal sinusoïdal.
Aucune terminaison n’est requise en cas d’utilisation d’une
sonde atténuatrice 10:1 ou 100:1. Le câble de raccordement
est alors directement adapté à l’entrée haute impédance de
l’oscilloscope. Les sondes atténuatrices ne représentent en
outre qu’une faible charge pour les sources de tension à haute
impédance (environ 10 MΩ II 12 pF pour une sonde 10:1 ou
100 MΩ II 5 pF pour une sonde 100 : 1). Par conséquent, il faut
toujours travailler avec une sonde atténuatrice dès la chute de
tension qu’elle entraîne peut de nouveau être compensée par un
réglage approprié de la sensibilité. De plus, l’impédance série
de la sonde constitue également une protection pour l’entrée de
l’amplifi cateur vertical. Du fait de leur fabrication individuelle,
les sondes atténuatrices sont seulement pré-compensées. Il
faut donc effectuer un réglage précis de la compensation sur
l’oscilloscope (voir «Compensation des sondes»).
Les sondes atténuatrices standard diminuent plus ou moins la
bande passante de l’oscilloscope et augmentent le temps de
montée. Dans tous les cas où il faut utiliser la totalité de la bande
passante de l’oscilloscope (par exemple pour des impulsions
12
Sous réserve de modifi cations
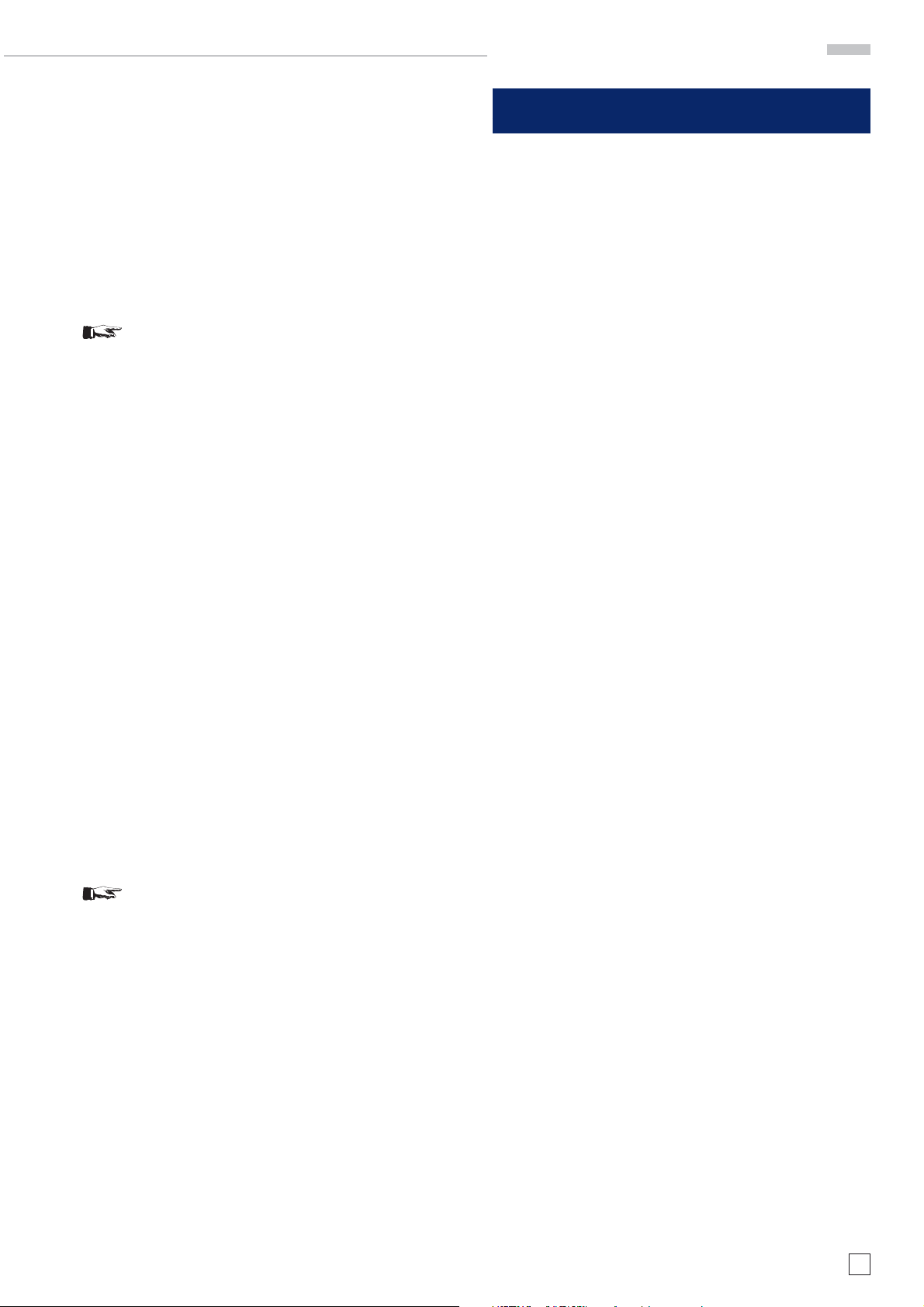
Mise en route et préréglages
aux fronts très raides), il est fortement recommandé d’utiliser
les sondes HZ200 fournies (10:1 avec identifi cation automatique
du facteur de division). La HZ200 dispose en outre de 2 points
de compensation HF en plus du réglage de la compensation en
basse fréquence. Une correction du temps de propagation de
groupe peut ainsi être réalisé à la fréquence limite supérieure
de l’oscilloscope à l’aide d’un calibreur commutable sur 1 MHz,
par exemple le HZ 60-3. Ce type de sonde modifi e en fait à peine la bande passante et le temps de montée de l’oscilloscope
et, dans certaines circonstances, améliore même la fi délité
de restitution de la forme du signal. Cela permet de corriger
ultérieurement des défauts spécifi ques dans la transmission
des impulsions.
Il faut toujours appliquer le couplage d’entrée DC
en présence de tensions continues supérieures à
400 V, même en utilisant une sonde atténuatrice. Il
faut en outre tenir compte de la tension maximale
admissible de la sonde.
Lors du couplage AC avec des signaux à basse fréquence,
l’atténuation devient indépendante de la fréquence. Les impulsions peuvent présenter des inclinaisons de palier, les tensions
continues sont supprimées mais chargent le condensateur
concerné de couplage d’entrée de l’oscilloscope.
Sa rigidité diélectrique est de 400 V max. (DC + AC crête). Il
est donc particulièrement important de choisir le couplage
d’entrée DC avec une sonde atténuatrice 100:1 qui possède
généralement une rigidité diélectrique de 1200 V max. (DC + AC
crête). Il est cependant possible de brancher un condensateur
ayant une capacité et une rigidité diélectrique en conséquence
avant la sonde atténuatrice pour supprimer la tension continue
parasite (par exemple pour une mesure de la tension de ronfl ement). Quelle que soit la sonde atténuatrice, au-dessus de 20
kHz la tension alternative d’entrée admissible est limitée par la
fréquence. Il faut donc tenir compte de la courbe de réduction
de charge « Derating curve » du modèle de sonde.
Le choix du point de masse sur l’objet à contrôler est important
pour l’acquisition de signaux de faible tension. Il doit toujours se
trouver le plus près possible du point de mesure. Le cas contraire, les courants éventuellement présents peuvent circuler
dans les lignes de masse ou des parties du châssis et fausser
fortement le résultat de la mesure. Les fi ls de masse des sondes
sont eux aussi particulièrement sensibles. Ils doivent être aussi
courts et gros que possible.
Il convient d’utiliser un adaptateur BNC lors du rac-
cordement de la tête de la sonde atténuatrice à une
prise BNC. Les problèmes de masse et d’adaptation
sont ainsi éliminés.
L’apparition dans le circuit de mesure de tensions de ronfl ement ou parasites (notamment aux faibles coeffi cients de
déviation verticale) peut être provoquée par une mise à la terre
en plusieurs points, car des courants d’équilibrage peuvent
alors circuler dans les blindages des câbles de mesure (chute
de tension entre les mises à la terre provoquée par d’autres
appareils banchés sur le réseau, par exemple générateurs de
signaux munis de condensateurs d’anti-parasitage).
Mise en route et préréglages
Avant la première mise en service, il faut tout d’abord établir
la liaison de terre (c’est-à-dire brancher le cordon secteur), et
ce avant toute autre liaison.
L’oscilloscope est mis en service avec la touche rouge POWER,
plusieurs voyants s’allument alors initialement. L’oscilloscope
reprend ensuite le paramétrage qu’il avait lors du dernier arrêt.
Il faut appuyer sur la touche AUTOSET si la trace ou le Readout
restent invisibles après environ 20 secondes.
Lorsque le balayage apparaît, régler une luminosité moyenne
avec le bouton INTENS, un astigmatisme maximum après être
passé en mode FOCUS puis régler la trace en position horizontale avec le bouton de rotation de la trace.
Pour ménager le tube cathodique, il est conseillé de toujours
travailler avec une luminosité adaptée à la mesure à effectuer et à la luminosité ambiante. Il faut être particulièrement
prudent dans le cas d’un faisceau ponctuel fi xe. S’il est trop
lumineux, il peut endommager la couche luminescente du
tube. Des arrêts et des mises en marche successifs fréquents
de l’oscilloscope peuvent en outre endommager la cathode
du tube.
Les cordons de mesure peuvent ensuite être branchés aux
entrées de l’oscilloscope après avoir sélectionné le coeffi cient de déviation maximum (20 V/cm). Ils sont ensuite à relier
à l’objet à mesurer qui peut alors être mis sous tension. Si
aucune trace n’apparaît, il est recommandé d’appuyer sur la
touche AUTOSET.
Rotation de trace (TRACE)
Malgré le blindage en mumétal du tube cathodique, il est impossible d’éviter totalement les infl uences du champ magnétique
terrestre sur la position horizontale du faisceau. Celle-ci dépend
de l’orientation de l’oscilloscope au poste de travail. Le balayage
de la ligne horizontale du faisceau au centre de l’écran n’est
alors pas parfaitement parallèle aux lignes du graticule. Le
bouton INTENS en mode «Rotation de trace» permet d’apporter
une correction de quelques degrés.
Utilisation et compensation des sondes
Pour que la sonde utilisée restitue le signal sans déformation, elle doit être adaptée exactement à l’impédance d’entrée
de l’amplificateur vertical. Un générateur intégré dans
l’oscilloscope délivre à cet effet un signal rectangulaire au
temps de montée très court qui peut être prélevé sur la prise
concentrique sous l’écran. Elle délivre une tension de 0,2 V
±1% pour les sondes atténuatrices 10:1. Cette tension correspond à une amplitude d’écran de 4 cm lorsque l’atténuateur
d’entrée est réglé sur le calibre 5 mV/cm.
cc
Le diamètre intérieur de la prise est de 4,9 mm, ce qui correspond au diamètre extérieur (mis à la masse) du tube de blindage des têtes de sonde modernes de la série F (uniformisation
internationale). C’est la seule manière de garantir une liaison
de masse courte, laquelle est une condition indispensable pour
des signaux à haute fréquence et une restitution fi dèle de la
forme des signaux non sinusoïdaux.
Sous réserve de modifi cations
13
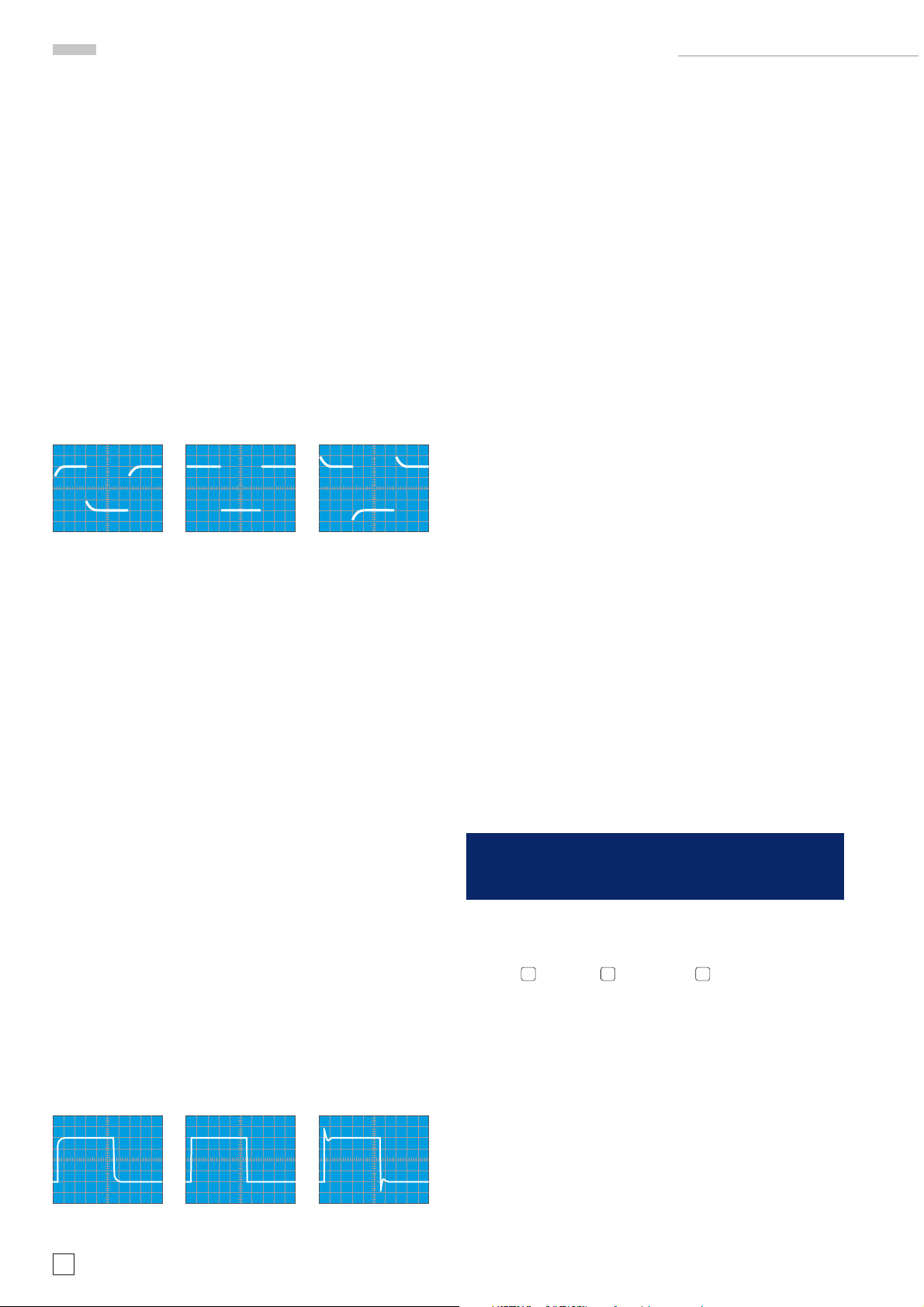
Modes de fonctionnement des amplificateurs verticaux
Compensation 1 kHz
Ce réglage par trimmer C (compensation BF) compense la
charge capacitive de l’entrée de l’oscilloscope. Grâce à la
compensation, le diviseur capacitif atteint le même rapport de
division que le diviseur ohmique.
La division de tension aux hautes et aux basses fréquences est
ainsi la même qu’en tension continue. Cette compensation n’est
ni nécessaire ni possible pour les sondes 1:1 ou commutées
sur 1:1. La condition nécessaire à la compensation est que la
trace soit parallèle aux lignes horizontales du graticule (voir
Rotation de trace TR).
Raccorder la sonde atténuatrice 10:1 à l’entrée sur laquelle
doit être appliquée la compensation. Sélectionner le couplage d’entrée DC, régler une hauteur de signal de 4 cm avec
l’atténuateur d’entrée (VOLTS/DIV) et commuter la base de
temps (TIME/DIV) sur 0,2 ms/cm (tous deux calibrés), puis
introduire la pointe de la sonde (diviseur 10:1) dans la prise
«PROBE ADJ.».
faux correct faux
Deux périodes de signal sont visibles à l’écran. Il faut à présent
régler le trimmer de compensation BF dont la position est
indiquée dans la notice d’utilisation de la sonde.
Régler le trimmer avec le tournevis isolé fourni jusqu’à ce que
les crêtes supérieures du signal rectangulaire soient parfaitement parallèles aux lignes horizontales du graticule (voir fi gure
4). La hauteur du signal devrait alors être de 4 cm ±1,2 mm. Les
fronts du signal sont invisibles lors de ce réglage.
Compensation 1 MHz
Les sondes fournies possèdent des circuits de compensation
de distorsion-résonance qui permettent une compensation
optimale de la sonde dans la plage de fréquence supérieure
de l’amplifi cateur vertical.
Raccorder la sonde atténuatrice 10:1 à l’entrée sur laquelle
doit être appliquée la compensation. Sélectionner le signal de 1
MHz sur la prise PROBE ADJ, couplage d’entrée DC, positionner
l’atténuateur d’entrée (VOLTS/DIV) sur 5 mV/cm et la base de
temps (TIME/DIV) sur 0,1 μs/cm (tous deux calibrés). Introduire
la pointe de la sonde dans la prise PROBE ADJ. Les fronts du
signal de tension rectangulaire apparaissent à présent aussi
à l’écran. La compensation HF est à présent effectuée. Il faut
ici observer le front montant et le coin supérieur gauche de la
crête de l’impulsion.
La position des éléments de compensation HF est là aussi
indiquée dans la notice d’utilisation de la sonde.
Critères pour la compensation HF:
– Un temps de montée court, c’est-à-dire un front montant
raide.
– Des suroscillations minimales avec une crête la plus recti-
ligne possible et ainsi une réponse en fréquence linéaire.
La compensation HF doit être réalisée de manière à ce que la
transition entre le front montant et la crête du signal rectangulaire ne soit ni trop arrondie, ni ne présente des suroscillations.
Après avoir terminé la compensation HF, il faut également
contrôler l’amplitude du signal de 1 MHz à l’écran. Elle doit
avoir la même valeur que précédemment lors de la compensation 1 kHz.
L’attention est attirée sur le fait qu’il faut effectuer le réglage
de la compensation en respectant la séquence 1 kHz – 1 MHz,
sans toutefois la répéter, et que les fréquences de 1 kHz et
de 1 MHz du calibreur ne peuvent pas être utilisées pour
l’étalonnage de la base de temps. De plus, le rapport cyclique
est différent de 1 : 1.
Les conditions nécessaires à une compensation simple et
précise des sondes atténuatrices (ou d’un contrôle des coeffi cients de déviation) sont des crêtes d’impulsion horizontales,
des hauteurs d’impulsion calibrées et un potentiel nul pour la
crête d’impulsion négative. La fréquence et le rapport cyclique
sont ici sans importance.
Après avoir effectué cette compensation, on obtient non seulement la bande passante maximale possible avec la sonde
atténuatrice, mais aussi un temps de propagation de groupe
quasiment constant en fi n de plage. Cela permet de limiter à un
minimum les distorsions transitoires (suroscillations, arrondis,
trous ou bosses dans la crête) à proximité du front montant.
La condition nécessaire à cette compensation HF est un
générateur de signaux rectangulaires ayant un faible temps
de montée (généralement de 4 ns) et une sortie à basse impédance (environ 50 Ω) et qui délivre une tension de 0,2 V
à une
cc
fréquence de 1 MHz. La sortie «PROBE ADJ» de l’oscilloscope
remplit ces conditions lorsque la fréquence sélectionnée du
signal est de 1 MHz.
faux correct faux
14
Sous réserve de modifi cations
Modes de fonctionnement des amplifi cateurs
verticaux
Les principaux éléments de commande qui interviennent dans
l’utilisation des amplificateurs verticaux sont les touches
VERT/XY
d’accéder aux menus dans lesquels peuvent être sélectionnés
les modes de fonctionnement des amplifi cateurs verticaux ainsi
que les paramètres des voies utilisées.
La sélection du mode de fonctionnement est décrite dans la
partie « Éléments de commande et Readout ».
Remarque préliminaire: L’expression «les deux voies» se
rapporte toujours aux voies «CH1» et «CH2».
La façon la plus courante de représenter des signaux avec un
oscilloscope est le mode Yt. En fonctionnement analogique,
l’amplitude du signal ou des signaux à mesurer provoque une
déviation du faisceau dans le sens Y. Le faisceau est simultanément dévié de la gauche vers la droite (base de temps).
28
, CH1 VAR 27, et CH2 VAR 29. Celles-ci permettent

Modes de fonctionnement des amplificateurs verticaux
Le ou les amplifi cateurs verticaux offrent les possibilités suivantes :
– La représentation d’un seul signal en mode voie 1.
– La représentation d’un seul signal en mode voie 2.
– La représentation de deux signaux en mode DUAL (double
trace).
– La représentation de deux signaux en mode ADD (addition)
(soustraction possible en inversant une voie)
En mode DUAL, les deux voies fonctionnent. En mode analogique, le mode de représentation des signaux des deux voies
dépend de la base de temps (voir «Éléments de commande et
Readout »). L’inversion des voies peut avoir lieu après chaque
balayage horizontal (mode alterné), mais elle peut également
se produire à une fréquence élevée au sein d’une période de
balayage (mode choppé). Même les phénomènes lents peuvent
ainsi être visualisés sans scintillements.
Le mode alterné n’est généralement pas adapté pour la visualisation avec l’oscilloscope de phénomènes lents à des calibres
de base de temps ≥ 0,5 ms/cm. L’écran scintille alors trop
ou semble vaciller. Le mode choppé n’a généralement aucun
intérêt pour les signaux ayant une fréquence de récurrence
élevée et qui sont ainsi observés aux petits calibres de la base
de temps.
Le mode addition (ADD) réalise la somme algébrique des signaux des deux voies (±CH1 plus ±CH2). Le signe « ± » indique
la voie non inversée (+) ou inversée (–). Le résultat obtenu, à
savoir la somme ou la différence des tensions des signaux,
dépend de la phase ou de la polarité des signaux eux-mêmes et de l’application ou non d’une inversion du signal dans
l’oscilloscope.
Mode XY
Ce mode de fonctionnement est activé avec VERT/XY 28 > XY. La
base de temps est désactivée dans ce mode de functionnement.
La déviation horizontale est réalisée par le signal à l’entrée de
la voie 1 (X-INP. = entrée horizontale). En mode XY, le diviseur
d’entrée et le vernier de réglage fi n de la voie 1 (CH1) sont utilisés pour le réglage de l’amplitude dans le sens horizontal.
Le réglage de la position horizontale s’effectue avec les boutons
HORIZONTAL et POSITION 1. En mode XY, la déviation verticale
est réalisée par la voie 2 (CH2).
Comme l’expansion horizontale (MAG x10) est sans effet en
mode XY, il n’existe aucune différence entre les deux voies
au niveau de leur sensibilité maximale et de leur impédance
d’entrée. Lors des mesures en mode XY, il faut tenir compte à la
fois de la fréquence limite supérieure (–3 dB) de l’amplifi cateur
X et de la différence de phase entre X et Y qui augmente aux
fréquences supérieures (voir la fi che technique). L’inversion du
signal X (CH 1 = X-INP.) est impossible en mode XY.
La fonction XY combinée avec des fi gures de Lissajous facilite
ou permet certaines opérations de mesure:
– Comparaison de deux signaux de fréquences différentes
ou calage d’une fréquence sur la fréquence de l’autre
signal jusqu’à la synchronisation. Cela s’applique également aux multiples ou aux fractions entiers de l’une des
fréquences.
– Comparaison des phases de deux signaux de même
fréquence.
Tensions d’entrée en phase:
Aucun des deux canaux n’est inversé = somme
Les deux canaux sont inversés = somme
Un seul canal inversé = différence
Tensions d’entrée en opposition de phase:
Aucun des deux canaux n’est inversé = différence
Les deux canaux sont inversés = différence
Un seul canal inversé = somme
En mode addition, la position verticale de la trace dépend
du réglage Y-POSITION des deux voies. Cela veut dire que le
réglage Y-POSITION est additionné, mais il ne peut pas être
infl uencé par INVERT.
Les tensions du signal entre deux points chauds du circuit
sont souvent mesurées en mode différence des deux voies. Il
est ainsi également possible de déterminer les courants entre
deux parties sous tension du circuit en mesurant la chute de
tension aux bornes d’une résistance connue. La règle générale
à appliquer est que lors de la représentation de signaux différentiels, la mesure des deux tensions doit exclusivement être
effectuée avec des sondes identiques (impédance et rapport
de division). Pour certaines mesures différentielles, il s’avère
avantageux de ne pas relier le câble de masse des sondes, qui
est relié galvaniquement à la terre, avec l’objet à mesurer. Cela
permet de réduire les éventuels ronfl ements ou parasites de
mode commun.
Comparaison des phases avec une fi gure de Lissajous
Les fi gures suivantes montrent deux signaux sinusoïdaux de
même fréquence et amplitude, mais ayant des angles de phase
différents.
ab
0° 35° 90° 180°
Le calcul de l’angle de phase ou du déphasage entre les tensions d’entrée X et Y (après avoir mesuré les distances a et b
sur l’écran) peut être effectué très facilement avec les formules
suivantes et une calculatrice de poche possédant des fonctions
trigonométriques et peut en outre être réalisé indépendamment
des amplitudes de déviation à l’écran.
a
sin ϕ =
b
a
cos ϕ = 1 –
b
a
ϕ = arc sin
b
Il faut ici tenir compte des points suivants:
– Du fait de la périodicité des fonctions trigonométriques, le
calcul doit se limiter aux angles ≤90°. C’est justement là
que résident les avantages de la méthode.
– Ne pas utiliser une fréquence de mesure trop élevée. Les
amplifi cateurs de mesure utilisés en mode XY présentent
un déphasage qui augmente avec la fréquence et qui peut
—
2
(—)
—
Sous réserve de modifi cations
15

Modes de fonctionnement des amplificateurs verticaux
dépasser 3° au-dessus de la fréquence indiquée sur la fi che
technique.
– Il est impossible de déterminer à partir de la seule image
à l’écran si la tension testée est en avance ou en retard de
phase par rapport à la tension de référence. Un élément
RC placé avant l’entrée de l’oscilloscope sur laquelle est
appliquée la tension testée peut ici s’avérer utile. La résistance d’entrée de 1 MΩ peut faire offi ce de résistance R,
il suffi t alors de rajouter un condensateur C approprié. Si
l’ouverture de l’ellipse augmente (par rapport à C courtcircuité), la tension testée est alors en avance de phase
et inversement. Cela ne s’applique cependant que pour
un déphasage jusqu’à 90°. Par conséquent, C doit être
suffi samment grand et ne provoquer qu’un déphasage
relativement faible mais suffi sant pour être remarqué.
En mode XY, lorsque les deux tensions d’entrée sont absentes
ou disparaissent, un spot très lumineux apparaît à l’écran. Ce
point risque de brûler la couche de luminophore si la luminosité réglée (INTENS) est excessive, ce qui peut provoquer une
perte défi nitive de luminosité ou, dans les cas extrêmes, une
destruction complète de la couche de luminophore à l’endroit
du point.
Mesure de la différence de phase en mode double
trace (Yt)
Attention: la mesure de la différence de phase en
mode double trace Yt est impossible avec le déclenchement alterné.
En mode double trace Yt (DUAL), il est très facile de mesurer
une différence de phase importante entre deux signaux d’entrée
de même fréquence et de même forme. Le balayage est ici
déclenché par le signal qui sert de référence (phase 0). L’autre
signal peut alors être en avance ou en retard de phase. La
précision de lecture sera élevée en affi chant à l’écran un peu
plus d’une période et en réglant à peu près la même hauteur
d’image pour les deux signaux. Le vernier de réglage fi n de
l’amplitude et de la déviation horizontale ainsi que le bouton
LEVEL peuvent également être utilisés pour ce réglage sans
infl uencer le résultat. Il faut alors amener les deux traces sur
la ligne médiane horizontale du graticule avant la mesure avec
les boutons POSITON 1 et 2, sous réserve que ceux-ci servent
de bouton de réglage de la position verticale pour les voies 1
et 2. Dans le cas des signaux sinusoïdaux, il faut observer les
passages par zéro, les valeurs de crête étant moins précises.
Le couplage AC est recommandé pour les deux voies lorsqu’un
signal sinusoïdal est sensiblement déformé par des harmoniques pairs (demi-ondes non symétriques par rapport à l’axe X)
ou en présence d’une tension continue de décalage. S’il s’agit
de signaux impulsionnels de même forme, la lecture s’effectue
sur les fronts raides.
ou, exprimée en degrés d’arc:
t 3
arc ϕ° =
T 10
—
· 2π = — · 2π = 1,885 rad
Les angles de phase relativement faibles à des fréquences pas
trop élevées peuvent être mesurés avec plus de précision en
mode XY à l’aide d’une fi gure de Lissajous.
Mesure d’une modulation d’amplitude
L’amplitude momentanée u à l’instant t d’une tension porteuse
HF non déformée et modulée en amplitude par une tension BF
sinusoïdale est défi nie par l’équation:
u = UT · sinΩt + 0,5 m · UT · cos (Ω - ω) t - 0,5 m · UT · cos (Ω - ω) t
où: UT = amplitude de la porteuse non modulée,
Ω = 2πF = fréquence angulaire de la porteuse,
ω = 2πF = fréquence angulaire de modulation,
m = taux de modulation (généralement ≤1° 100 %).
Outre la fréquence porteuse F, la modulation donne lieu à la
bande latérale inférieure F – f et à la bande latérale supérieure
F + f.
0,5 m · U
T
F – f F F + f
Fig. 1 Amplitudes et fréquences spectrales en modulation
d’amplitude (m = 50 %)
L’image du signal HF modulé en amplitude peut être visualisée
sur l’oscilloscope et exploitée lorsque le spectre des fréquences
est inclus dans la bande passante de l’oscilloscope. Régler la
base de temps de manière à visualiser plusieurs périodes de la
fréquence de modulation. Plus précisément, il est recommandé
de choisir le déclenchement externe avec la fréquence de modulation (à partir d’un générateur BF ou d’un démodulateur).
Le déclenchement interne est souvent possible en utilisant le
vernier de réglage fi n de la base de temps.
ba
U
T
0,5 m · U
m · U
T
U
T
T
t = écart horizontal entre les
passages par zéro en cm
T = écart horizontal pour une
période en cm
Dans l’exemple, t = 3 cm et T = 10 cm, ce qui donne une différence de phase en degrés d’angle de:
5 3
ϕ° =
—
T 10
16
Sous réserve de modifi cations
· 360° = — · 360° = 108°
Fig. 2 Signal modulé en amplitude:
F = 1 MHz ; f = 1 kHz ; m = 50 % ; U
= 28,3 mV
T
.
eff
Réglage de l’oscilloscope pour un signal selon la fi gure 2:
Voie 1 en mode Y: CH. 1 ; 20 mV/cm ; AC.
TIME/DIV.: 0,2 ms/cm.
Déclenchement: NORMAL; AC; int. avec vernier de
réglage fi n de la base de temps (ou déclenchement ex
terne).
En relevant les deux valeurs a et b à l’écran, le taux de modulation se calcule par
a – b a – b
m =
——
a + b a + b
où: a = U
(1 + m) et b = UT (1 – m).
T
bzw. m =
—— · 100 [%]

Déclenchement et balayage horizontal
Les verniers de réglage fi n de l’amplitude et de la base de
temps peuvent se trouver dans une position quelconque lors
de la mesure du taux de modulation. Leur position n’intervient
pas dans le résultat.
Déclenchement et balayage horizontal
Les principaux éléments de commande et indicateurs de ces
fonctions se trouvent dans la zone grisée TRIGGER. Il sont
décrits dans la partie «Éléments de commande et Readout».
La variation dans le temps d’une tension à mesurer (tension
alternative) peut être visualisée en mode Yt. Le signal mesuré
provoque ici une déviation du faisceau d’électrons dans le sens
vertical alors que la base de temps produit un balayage horizontal (déviation temporelle) du faisceau d’électrons de la gauche
vers la droite à une vitesse constante mais réglable.
Les variations périodiques répétitives de la tension sont généralement visualisées avec une déviation temporelle qui se
répète périodiquement. Pour obtenir une trace «fi xe» exploitable, le prochain début de la déviation temporelle ne doit avoir lieu
qu’à la position du signal (amplitude et sens du front) identique
à celle à laquelle a eu lieu le déclenchement précédent du
balayage horizontal.
Une tension constante (tension continue) ne peut
pas provoquer un déclenchement, car en l’absence
de variation de tension il n’existe pas non plus de
front qui pourrait provoquer le déclenchement.
Le déclenchement peut être provoqué par le signal mesuré
lui-même (déclenchement interne) ou par une tension externe
synchrone au signal mesuré (déclenchement externe).
DC et en déclenchement alterné, alors que le déclenchement
automatique est maintenu.
En déclenchement automatique, un nouveau balayage horizontal a lieu à la fi n du balayage précédent et à la fi n de la durée
d’inhibition qui le suit, et ce même en l’absence de signal de
déclenchement. Une ligne horizontale, laquelle peut également
correspondre à une tension continue, est donc toujours visible
même en l’absence de tension alternative mesurée, c’est-à-dire
en l’absence de déclenchement.
Lorsque la tension mesurée est appliquée, les actions se
limitent essentiellement au réglage correct de l’amplitude
et de la base de temps avec une trace toujours visible. En
présence de signaux dont la fréquence est inférieure à
20 Hz, la durée de leur période est supérieure au temps d’attente
du début automatique – non provoqué par le déclenchement – du
balayage horizontal. Par conséquent, les signaux <20 Hz sont
représentés non déclenchés, et ce même si le signal remplit
les conditions de déclenchement.
Le bouton de réglage du seuil de déclenchement est opérationnel en déclenchement automatique sur valeur de crête. Sa
plage de réglage se cale automatiquement entre l’amplitude
crête à crête du signal actuellement appliqué, ce qui la rend
indépendante de l’amplitude et de la forme du signal.
Le rapport cyclique d’une tension rectangulaire, par exemple,
peut varier entre 1 : 1 et environ 100 : 1 sans que le signal disparaisse. Dans certaines circonstances, il est ainsi nécessaire
d’amener le bouton LEVEL A/B pratiquement en butée alors que
la mesure suivante exigera de le positionner différemment.
Cette facilité d’utilisation amène à recommander le déclenchement automatique sur valeur de crête pour toutes les opérations de mesure non complexes. Mais il convient également
pour aborder des problèmes de mesure diffi ciles, notamment
lorsque l’amplitude, la fréquence ou la forme du signal mesuré
lui-même ne sont pas vraiment connues.
L’amplitude minimale du signal de déclenchement qui est
nécessaire pour le déclenchement est appelée seuil de déclenchement et elle peut être défi nie avec un signal sinusoïdal. En
déclenchement interne, la tension de déclenchement est prélevée (après l’atténuateur) du signal mesuré par l’amplifi cateur
de mesure qui fait offi ce de source de déclenchement (interne).
En déclenchement interne, l’amplitude minimale (seuil de déclenchement) est indiquée en mm et se rapporte à la déviation
verticale sur l’écran. Cela permet d’éviter de devoir prendre
en compte des valeurs différentes de la tension pour chaque
position de l’atténuateur d’entrée.
Si la tension de déclenchement est amenée depuis l’extérieur,
elle doit être mesurée en V
sur la prise correspondante.
cc
Dans certaines limites, la tension de déclenchement peut
être nettement supérieure au seuil de déclenchement. Elle
ne devrait généralement pas dépasser 20 fois cette valeur.
L’oscilloscope possède deux modes de déclenchement qui
sont décrits ci-après.
Déclenchement automatique sur valeur de crête
(menu MODE)
Les informations spécifi ques à l’appareil se trouvent dans
les rubriques MODE
SOURCE
18
de la section «Éléments de commande et Readout».
Ce mode de déclenchement est automatiquement activé en appuyant sur la touche AUTOSET. La détection de la valeur de crête
est automatiquement désactivée en couplage de déclenchement
16
, >AUTO, LEVEL A/B 15, FILTER 17 et
Le déclenchement automatique sur valeur de crête est indépendant de la source de déclenchement et peut être utilisé aussi
bien en déclenchement interne qu’en déclenchement externe.
Il permet la représentation synchronisée de signaux >20 Hz.
Déclenchement normal (menu MODE)
Les informations spécifi ques à l’appareil se trouvent dans les
rubriques MODE
18
CE
de la section « Éléments de commande et Readout». Les
fonctions vernier de réglage fi n de la base de temps (VAR), le
réglage de la durée d’inhibition (HOLD OFF) et le mode base
de temps B qui se trouvent dans le menu de la base de temps
constituent des aides utiles pour le déclenchement sur des
signaux très diffi ciles. Pour affi cher le menu, appuyez sur la
touche HOR VAR
En déclenchement normal et avec un réglage
approprié du seuil de déclenchement, le balayage
horizontal peut être activé ou déclenché en tout
point d’un front du signal. La plage de déclenchement couverte par le bouton de réglage du seuil de
déclenchement dépend fortement de l’amplitude du
signal de déclenchement.
En déclenchement interne, si la hauteur d’image est inférieure à
1 cm, le réglage nécessite quelque doigté en raison de la petite
taille de la zone d’accrochage. Si le seuil de déclenchement est
mal réglé et/ou si le signal de déclenchement est absent, la base
16
, >AUTO, LEVEL A/B 15, FILTER 17 et SOUR-
26
.
Sous réserve de modifi cations
17

Déclenchement et balayage horizontal
de temps ne démarre pas et aucune trace n’est représentée.
Le déclenchement normal permet également de déclencher
sur des signaux compliqués. En présence d’une combinaison
de signaux, la possibilité de déclenchement dépend de certaines
valeurs de seuil qui se répètent périodiquement et qui, dans
certaines circonstances, ne peuvent être trouvées que par un
réglage au doigté du bouton du seuil de déclenchement.
Sens du front (menu FILTER)
Après avoir affi ché le menu FILTER 17, les touches de fonction
permettent de défi nir le sens du front (de déclenchement).
Voir aussi «Éléments de commande et Readout». Le réglage
du sens du front n’est pas affecté par la fonction AUTOSET.
Lors d’un déclenchement sur double front, AUTOSET permet
de commuter sur le front montant.
En déclenchement normal et automatique, le déclenchement
peut avoir lieu, au choix, sur un front de tension montant ou
descendant. Mais il est également possible de déclencher sur
le front suivant, indépendamment de son sens, en choisissant
la position «les deux».
Cette dernière possibilité est notamment intéressante lors
de l’acquisition d’éléments uniques pour lesquels il n’est pas
toujours possible de prévoir le sens du front initial et de risquer ainsi de déclencher non pas sur le début de l’événement,
mais sur sa fi n. Il est généralement inapproprié de déclencher
sur les deux sens de front en présence de signaux répétitifs,
car le fonctionnement ainsi obtenu semble erratique (double
représentation).
Les fronts montants correspondent au moment où la tension
passe d’un potentiel négatif à un potentiel positif. Cela n’a rien
à voir avec le potentiel zéro ou un potentiel de masse ni avec
les valeurs absolues de la tension. Le front positif peut très
bien se trouver dans la partie négative d’un signal. Un front
descendant provoque le déclenchement de la même façon. Cela
s’applique aussi bien en déclenchement automatique qu’en
déclenchement normal.
Couplage de déclenchement (menu FILTER)
une valeur de seuil donnée du signal mesuré ou lorsqu’il faut
représenter des signaux impulsionnels dont le rapport cyclique
varie constamment pendant l’observation.
HF:
Dans ce mode de couplage de déclenchement, la bande passante correspond à celle d’un fi ltre passe-haut. Le couplage HF
convient pour tous les signaux à haute fréquence. Les fl uctuations de la tension continue et les bruit (rose) à basse fréquence
de la tension de déclenchement sont atténués, ce qui infl uence
favorablement la stabilité du déclenchement.
Du fait de leur réponse en fréquence, les modes de couplage
de déclenchement décrits précédemment ont également l’effet
de fi ltres de fréquences. Ceux-ci peuvent être combinés avec
d’autres fi ltres si cela s’avère approprié.
Suppression du bruit:
Ce fi ltre (mode de couplage de déclenchement) se comporte
comme un fi ltre passe-bas, ce qui veut dire que seules sont supprimées ou atténuées les composantes à très haute fréquence
du signal de déclenchement. Cela permet d’éviter ou de réduire
les perturbations provoquées par ce type de composantes du
signal. Le fi ltre peut être utilisé en combinaison avec le couplage de déclenchement AC et DC, ce qui permet en plus de
déterminer également la réponse en fréquence aux basses
fréquences. Combiné avec le couplage de déclenchement AC,
il existe alors une fréquence limite inférieure.
LF:
Le couplage de déclenchement LF (BF) se comporte comme
un fi ltre passe-bas dont la fréquence limite supérieure est très
basse. Le couplage de déclenchement LF convient généralement mieux aux signaux à basse fréquence que le couplage DC,
car il atténue fortement les composants de bruit dans la tension
de déclenchement. Dans les cas extrêmes, cela permet d’éviter
les phénomènes de gigue ou de doublon, notamment avec des
tensions d’entrée très faibles. Le seuil de déclenchement augmente constamment au-dessus de la bande passante. Combiné
avec le couplage de déclenchement AC, ce fi ltre permet de
supprimer les composantes continues et, contrairement à la
combinaison avec le coupage de déclenchement DC, il existe
alors également une fréquence limite inférieure.
Les informations spécifi ques à l’appareil se trouvent dans
les rubriques MODE
SOURCE
18
de la section « Éléments de commande et Rea-
dout ». La fonction AUTOSET
16
, >AUTO, LEVEL A/B 15, FILTER 17 et
7
active toujours le couplage de
déclenchement DC, sous réserve que le couplage AC n’était
pas sélectionné au préalable. La bande passante des différents couplages de déclenchement est indiquée dans la «fi che
technique».
En couplage de déclenchement DC interne avec ou sans fi ltre
BF, il convient de toujours travailler avec un déclenchement
normal et le réglage du seuil de déclenchement. Le mode de
couplage et la bande passante du signal de déclenchement
qui en résulte peuvent être déterminés avec le couplage de
déclenchement.
AC:
Il s’agit du mode de couplage le plus souvent utilisé pour le
déclenchement. Le seuil de déclenchement augmente constamment au-dessus et au-dessous de la bande passante.
DC:
Combiné avec le déclenchement normal, le couplage DC ne fi xe
aucune limite inférieure à la bande passante car le signal de
déclenchement est relié galvaniquement au dispositif de déclenchement. Ce couplage de déclenchement est recommandé
en présence de phénomènes lents, lorsqu’il faut déclencher sur
Vidéo (déclenchement sur signal TV)
La fonction de déclenchement vidéo (MODE > Video) active le
séparateur d’impulsions de synchronisation TV intégré. Il sépare les impulsions de synchronisation de l’image et permet
un déclenchement des signaux vidéo indépendamment des
variations du contenu de l’image.
Suivant le point de mesure, les signaux vidéo (signaux vidéocomposites) se mesurent sous la forme de signaux orientés
positivement ou négativement. Un réglage correct de la polarité
est indispensable pour que les impulsions de synchronisation
soient séparées de l’image. La polarité est défi nie comme suit :
si le contenu de l’image se trouve au-dessus des impulsions de
synchronisation (visualisation originale non inversée), il s’agit
alors d’un signal vidéo à orientation positive. Le cas contraire,
lorsque le contenu de l’image se trouve sous l’impulsion de
synchronisation, il s’agit d’un signal vidéo à orientation négative.
En déclenchement vidéo, le réglage de la polarité peut être
effectué après avoir ouvert le menu FILTER.
Si le sens du front sélectionné est incorrect, la trace sera instable ou non synchronisée, car le déclenchement s’effectuera
alors sur le contenu de l’image. En cas de déclenchement
externe, la hauteur de l’impulsion de synchronisation doit être
d’au moins 5 mm.
18
Sous réserve de modifi cations

Déclenchement et balayage horizontal
Le signal de synchronisation PAL se compose d’impulsions de
synchronisation de ligne et d’image qui se distinguent notamment par leur durée. Les impulsions de synchronisation de
ligne durent environ 5 μs et se produisent à intervalles de 64 μs.
Les impulsions de synchronisation d’image se composent de
plusieurs impulsions d’environ 28 μs chacune qui apparaissent
à chaque changement de trame à intervalle de 20 ms.
Les deux types d’impulsions de synchronisation se différentient
ainsi par leur durée et par leur fréquence de récurrence. Le
déclenchement peut être effectué aussi bien avec les impulsions de synchronisation de ligne qu’avec les impulsions de
synchronisation d’image.
Déclenchement sur impulsion de synchronisation
d’image
Remarque préliminaire :
La combinaison du déclenchement sur impulsion de synchronisation d’image avec le mode DUAL choppé peut faire apparaître des interférences dans le signal représenté. Il faut alors
passer en mode DUAL alterné. Dans certaines cir-constances,
il faut également couper le Readout.
L’option de déclenchement «Image» apparaît dans le menu
FILTER après avoir activé le déclenchement sur signal vidéo
avec MODE. Il est alors possible de préciser si le déclenchement
doit se produire sur « toutes » les trames ou seulement sur
les trames «paires» ou «impaires». Pour un fonctionnement
parfait, il est essentiel de choisir la norme (625/50 ou 525/60)
correspondant au signal.
Il faut choisir un calibre de base de temps approprié pour la mesure à effectuer. Le calibre 2 ms/div. permet de représenter une
trame complète. Les impulsions de synchronisation d’image se
composent de plusieurs impulsions séparées d’une trame.
Déclenchement sur impulsion
de synchronisation de ligne
L’option de déclenchement «Ligne» apparaît dans le menu
FILTER après avoir activé le déclenchement sur signal vidéo
avec MODE.. Pour un fonctionnement parfait, il est essentiel de
choisir la norme (625/50 ou 525/60) correspondant au signal.
En sélectionnant «Toutes», le déclenchement sur impulsion de
synchronisation de ligne sera activé par chaque impulsion de
synchronisation. Mais il est également possible de ne déclencher que sur une ligne prédéfi nie («Ligne N°»).
la plage de tension (voir «Fiche technique») du déclenchement
externe. Il faut également veiller à choisir le bon sens de front,
lequel ne coïncide par forcément au sens de l’impulsion de
synchronisation appliquée à l’entrée Y dans le cas d’un déclenchement externe. Il est facile de contrôler ces deux aspects en
commençant par affi cher la tension de déclenchement externe
elle-même (avec déclenchement interne).
Déclenchement secteur
Les informations spécifi ques à l’appareil se trouvent dans la
rubrique SOURCE
out ».
Ce mode de déclenchement est activé lorsque le Readout
affi che Tr:Line. Une tension prélevée du bloc d’alimentation
est utilisée comme signal de déclenchement à la fréquence
du réseau (50/60 Hz).
Le déclenchement secteur est indépendant de l’amplitude et
de la fréquence du signal Y et il est recommandé pour tous les
signaux synchrones avec le secteur. Cela s’applique également
dans certaines limites aux multiples ou aux fractions entiers
de la fréquence du secteur. Le déclenchement secteur permet de représenter des signaux même au-dessous du seuil
de déclenchement. Il convient donc particulièrement pour
mesurer les petites tensions de ronfl ement des redresseurs
ou les perturbations à fréquence secteur dans un circuit.
Contrairement au déclenchement en fonction du sens du front
classique, l’inversion du sens du front dans le cas du déclenchement secteur consiste à sélectionner la demi-onde positive
ou négative (au besoin, intervertir la fi che secteur). Le seuil de
déclenchement peut être décalé au-dessus d’une zone donnée
de la demi-onde sélectionnée à l’aide du bouton de réglage
prévu à cet effet.
Le sens (lieu) et l’amplitude des perturbations magnétiques à la
fréquence du secteur dans un circuit peuvent être déterminés
à l’aide d’une sonde à bobine. La bobine doit judicieusement
comporter le plus grand nombre possible de spires de fi l émaillé
mince enroulé sur une petite armature et raccordée à une fi che
BNC (pour l’entrée de l’oscilloscope) par le biais d’un câble
blindé. Il faut intégrer une petite résistance d’au moins 100 Ω
(découplage haute fréquence) entre l’âme du câble et la broche
de la fi che. Il peut également s’avérer approprié de réaliser un
blindage statique externe de la bobine en veillant à éviter les
spires en court-circuit. Le maximum et le minimum au point de
mesure peuvent être déterminés en faisant tourner la bobine
dans deux directions axiales.
18
sous «Éléments de commande et Read-
Le calibre TIME/DIV. de 10 μs/div. est recommandé pour la représentation de lignes individuelles et permet alors de visualiser
environ 1½ lignes. Le signal vidéo possède généralement une
forte composante continue. Lorsque le contenu de l’image est
constant (par exemple mire de test ou générateur de barres
en couleur), la composante continue peut facilement être
supprimée par le couplage d’entrée AC de l’amplifi cateur de
l’oscilloscope.
Le couplage d’entrée DC est cependant recommandé si le
contenu de l’image change (par exemple programme normal),
sinon la position verticale de la trace à l’écran change à chaque
fois que le contenu de l’image change. Le bouton de réglage
de la position verticale permet de toujours compenser la composante continue de manière à ce que la trace se trouve dans
la surface du graticule.
Le circuit séparateur de synchronisation agit également en cas
de déclenchement externe. Il faut, bien évidemment, respecter
Déclenchement alterné
Ce mode de déclenchement peut être activé avec SOURCE 18
>Alt. 1/2. Ce mode de déclenchement est activé lorsque le
Readout affi che Tr:alt. De plus, le Readout n’affi che alors plus
que l’instant du déclenchement (fl èche vers le haut si l’instant
du déclenchement se trouve dans la grille de mesure) à la
place du symbole du point de déclenchement (seuil et instant
de déclenchement).
Le déclenchement alterné est justifi é lorsqu’il faut réaliser une
représentation synchronisée de deux signaux asynchrones.
Le déclenchement alterné ne peut fonctionner correctement
que lorsque l’inversion des voies est elle aussi alternée. En
déclenchement alterné, il n’est plus possible de déterminer
une différence de phase entre les deux signaux d’entrée. Pour
éviter les problèmes de déclenchement liés aux composantes
continues, il est recommandé de choisir le couplage d’entrée
AC pour les deux voies.
Sous réserve de modifi cations
19

Déclenchement et balayage horizontal
Dans ce mode de déclenchement, les deux sources de déclenchement (CH1 et CH2) sont utilisées en alternance pour
déclencher le balayage horizontal avec lequel CH1 et CH2 sont
représentées en alternance.
Exemple: Si CH2 est la source de déclenchement et qu’un signal appliqué sur CH2 provoque le déclenchement, le balayage
horizontal commence et le signal de la voie 2 apparaît. À la fi n
du balayage, la source de déclenchement et la voie de mesure
passent de la voie 1 à la voie 2. Le prochain signal qui sera appliqué sur CH1, la déclenchera et provoquera ainsi le balayage
horizontal sera représenté sur la voie 1. L’appareil commute
ensuite de nouveau sur la CH2 qui devient alors la source de
déclenchement et la voie de mesure.
Le déclenchement alterné n’est ni possible ni justifi é en mode
simple trace ou en déclenchement «externe» et «secteur».
Déclenchement externe
Ce mode de déclenchement peut être activé à tout moment en
mode oscilloscope analogique avec SOURCE
Readout affi che alors «Tr:ext». AUXILIARY INPUT
l’entrée du signal de déclenchement externe et les sources
de déclenchement internes sont sans effet. La sélection de
ce mode de déclenchement désactive le symbole du point de
déclenchement (niveau et instant de déclenchement) et seul
l’instant du déclenchement est encore affi ché. Le symbole du
déclenchement ne s’affi che PAS ! Le déclenchement interne
est désactivé lorsque ce mode de déclenchement est sélectionné. Le déclenchement externe peut à présent être réalisé
par le biais de la prise BNC correspondante en y appliquant
une tension comprise entre 0,3 et 3 V
cc
mesurer. Cette tension de déclenchement peut avoir une forme
totalement différente de celle du signal mesuré.
Dans certaines limites, le déclenchement est même possible
avec des multiples ou des fractions entiers de la fréquence
mesurée, la condition étant le verrouillage de phase. Il faut
cependant tenir compte du fait que le signal mesuré et la
tension de déclenchement peuvent malgré tout présenter un
certain déphasage. Un déphasage de 180°, par exemple, a pour
effet que la représentation du signal mesuré commence par un
front négatif malgré la sélection d’un front (de déclenchement)
positif.
18
> Extern. Le
33
devient
synchrone au signal à
Indicateur de déclenchement
Les impulsions qui provoquent le déclenchement sont mémorisées et indiquées par l’indicateur de déclenchement pendant
environ 100 ms. Dans le cas des signaux ayant un taux de
répétition très faible, la LED s’allume alors de façon plus ou
moins impulsionnelle. De plus, l’indicateur clignote alors non
seulement au début du balayage horizontal au bord gauche
de l’écran, mais aussi à chaque nouveau tracé dans le cas de
l’affi chage de plusieurs courbes.
Réglage de la durée d’inhibition (HOLD OFF)
Les informations spécifi ques à l’appareil se trouvent dans la
rubrique HOR VAR
et Readout».
Un balayage horizontal complet et le retour du faisceau associé
(mais invisible) à sa position de départ (à gauche) sont suivis par
des opérations internes indispensables qui prennent un certain
temps. Pendant cette période, la base de temps est bloquée
(durée d’inhibition) et n’est donc pas déclenchée, et ce même
si un signal approprié pour le déclenchement est présent. Il
s’agit ici de la durée d’inhibition minimale.
Le réglage de la durée d’inhibition permet d’augmenter graduellement la durée d’inhibition du déclenchement entre deux
périodes de balayage horizontal dans un rapport d’environ 10:1.
Les impulsions de déclenchement qui se produisent pendant
cette période ne peuvent pas provoquer le démarrage de la
base de temps.
La mesure de signaux constitués de données transmises en
série et envoyées par paquets peut donner lieu à une représentation qui semble non synchronisée, et ce malgré que les
conditions de déclenchement soient remplies. Cela est généralement lié au fait que le démarrage de la base de temps ne
coïncide par toujours avec le début d’un paquet de données,
mais se produit de manière aléatoire en différents moments
au sein du paquet ou, du fait du déclenchement automatique,
déjà avant le début d’un paquet de données. Dans ces cas, le
réglage de la durée d’inhibition permet d’obtenir un réglage
stable en la réglant de telle sorte qu’elle se termine tout juste
avant le début du paquet.
La fi n de la durée d’inhibition peut alors être réglée à l’instant à
chaque fois le plus favorable ou le plus nécessaire, notamment
en présence de signaux en rafale ou de trains d’impulsions
apériodiques.
26
>Holdoff sous «Éléments de commande
Les explications suivantes se rapportent au voyant à LED TRIG´d
mentionné au point
23
dans la partie «Éléments de commande
et Readout». La LED s’allume aussi bien en déclenchement automatique qu’en déclenchement normal lorsque les conditions
suivantes sont remplies:
1. Le signal de déclenchement interne ou externe appliqué au
comparateur de déclenchement doit avoir une amplitude
suffi sante.
2. Le symbole du point de déclenchement ne se trouve pas
au-dessus ou au-dessous de la trace (au moins 1 période
du signal).
Des impulsions permettant de démarrer la base de temps et
d’activer l’indicateur de déclenchement sont alors présentes
à la sortie du comparateur de déclenchement. L’indicateur de
déclenchement facilite le réglage et le contrôle des conditions
de déclenchement, notamment en présence de signaux de très
basse fréquence (utiliser alors le déclenchement normal) ou
d’impulsions très courtes.
20
Sous réserve de modifi cations
Un signal à fort niveau de bruit ou fortement perturbé par
une composante HF sera parfois représenté en double. Dans
certains cas, le réglage du niveau de déclenchement agit
uniquement sur le déphasage mutuel et non sur la double représentation. La représentation stable du signal nécessaire à
son exploitation est cependant facile à obtenir en augmentant
la durée d’inhibition. Pour ce faire, augmenter lentement la
durée d’inhibition jusqu’à ce qu’il n’y ait plus qu’un seul signal
à l’écran. Une représentation double peut se produire avec certains signaux impulsionnels dont les impulsions présentent en
alternance une petite différence d’amplitude de crête. Seul un
réglage parfaitement précis du seuil de déclenchement permet
la représentation d’un signal unique. Le réglage de la durée
d’inhibition (HOLD OFF) simplifi e là aussi le réglage.
Lorsque ce travail est terminé, il faut impérativement ramener
la durée d’inhibition au minimum, sinon la luminosité de l’image
risque d’être considérablement réduite dans certaines circonstances. La procédure à appliquer est illustrée ci-après.

Autoset
Periode
Rampe de
déviation de temps
Modifi cation de la
durée d‘inhibition
Les parties accentées seront affi chées
Signal
Fig. 1
Fig. 2
La fi gure 1 représente l’écran avec une durée d’inhibition
minimale (réglage de base). L’image n’est pas stable, car
différentes parties de la courbe sont affi chées (doublon)
Fig. 2: la durée d’inhibition est ici réglée de telle sorte que
ce sont toujours les mêmes parties de la courbe qui sont
affi chées. L’image est stable.
alors la vitesse de balayage et ainsi le facteur d’expansion. Plus
l’expansion augmente, plus la luminosité du signal représenté
diminue. La luminosité du Readout reste inchangée.
Si l’expansion X est importante, le signal peut apparaître instable dans le sens X en raison d’un phénomène de gigue. Si
un front approprié apparaît après que le temps de retard se
soit écoulé, le déclenchement peut être effectué sur ce front
(post-déclenchement).
Autoset
Les informations spécifi ques à l’appareil se trouvent dans la
rubrique AUTOSET
out». La fonction AUTOSET ne permet un réglage automatique
approprié de l’oscilloscope que si la fréquence du signal
mesurée appliqué se situe dans les limites prédéfi nies pour le
déclenchement automatique.
7
sous «Éléments de commande et Read-
Base de temps B (2
ème
base de temps) / déclenche-
ment retardé
Les informations spécifi ques à l’appareil se trouvent dans les
rubriques HOR VAR
commande et Readout».
Comme décrit dans le paragraphe Déclenchement et balayage
horizontal, le déclenchement provoque le démarrage du balayage horizontal. Le faisceau d’électrons qui était précédemment
rendu invisible est allumé et dévié de la gauche vers la droite
jusqu’à la déviation horizontale maximale. Le faisceau est ensuite de nouveau éteint et il se produit un retour de trame (retour
au point de départ du faisceau). Le balayage horizontal peut
de nouveau être provoqué par le déclenchement automatique
ou un signal de déclenchement après écoulement de la durée
d’inhibition. Pendant toute la durée (aller et retour du faisceau),
le signal d’entrée peut en même temps provoquer une déviation
dans le sens vertical. Mais celle-ci n’est visible que pendant
l’aller du faisceau, lorsqu’il est allumé.
Comme le point de déclenchement, en mode analogique, se
trouve toujours du début de la trace, une expansion horizontale
du signal en accélérant la vitesse de balayage horizontal (en
réduisant le calibre de la base de temps TIME/DIV.) ne peut être
appliquée qu’à partir de ce point.
Pour les parties du signal qui se trouve au niveau du bord droit
de la trace, l’augmentation de la vitesse de balayage horizontal
a pour effet qu’elles ne sont plus visibles. Cela veut dire qu’une
expansion dans le sens horizontal est seulement possible avec
la fonction MAG x10. Une expansion plus importante est impossible sans deuxième base de temps.
La déviation retardée avec la base de temps B permet de résoudre ces problèmes. Elle se rapporte au signal représenté
avec la base de temps A. La représentation avec la base de
temps B ne commence qu’après écoulement d’une durée
donnée, rapportée à la représentation A, que l’utilisateur peut
placer en n’importe quel endroit sur la représentation A. Il
existe ainsi la possibilité de commencer le balayage horizontal B pratiquement en n’importe quel endroit de la trace de la
base de temps A. Le calibre de la base de temps B détermine
26
et TIME/DIV. 24 sous «Éléments de
Tous les éléments de commande à l’exception de la touche
POWER sont interrogés électroniquement et peuvent donc
également être commandés.
Il est ainsi possible de confi gurer automatiquement l’appareil
en fonction du signal en mode Yt (base de temps). Aucun réglage manuel supplémentaire n’est nécessaire dans la majorité
des cas. La fonction AUTOSET active toujours le mode Yt. Une
pression sur la touche AUTOSET ne modifi e pas le mode de
fonctionnement si celui-ci était préalablement monovoie (CH1
ou CH2) ou DUAL. Si c’est le mode Addition ou XY qui est actif,
l’appareil passe automatiquement en mode DUAL.
Le ou les coeffi cients de déviation verticale (VOLTS/DIV.) sont
sélectionnés automatiquement de manière à ce que l’amplitude
du signal en mode monovoie ne dépasse par 6 cm environ alors
qu’en mode DUAL chaque signal soit représenté sur environ 4
cm de hauteur. Cette explication ainsi que celles relatives au
réglage automatique du calibre de la base de temps (TIME/DIV.)
concernent les signaux dont le rapport cyclique est approximativement de 1:1. Le réglage automatique du calibre de la base
de temps est effectué de manière à affi cher environ 2 périodes
du signal. Ce réglage est aléatoire en présence de signaux
complexes composés de plusieurs fréquences tels que les
signaux vidéo, par exemple.
Une pression sur la touche AUTOSET produit les conditions de
fonctionnement suivantes:
– Le couplage d’entrée (AC ou DC) est conservé ou reprend
le dernier réglage adopté avant la commutation à la masse
(GND).
– Déclenchement interne (dérivé du signal mesuré)
– Déclenchement automatique
– Sélection automatique de la source de déclenchement
– Réglage du niveau de déclenchement au centre de la plage
– Calibres verticaux (Y) calibrés
– Calibre de la base de temps calibré
– Couplage de déclenchement AC ou DC inchangé
– Le couplage de déclenchement HF est désactivé (et devient
DC)
– Filtre BF et de suppression du bruit inchangé
– Mode base de temps A
Sous réserve de modifi cations
21

Testeur de composants
– Pas d’expansion horizontale x10
– Réglage automatique de la position X et Y de la trace
– Le front de déclenchement est conservé même en cas de
déclenchement sur double front
Attention:
La représentation automatique du signal est géné-
ralement impossible en présence d’un signal impulsionnel dont le rapport cyclique est de 400:1 ou
plus. Le coeffi cient de déviation verticale est alors
trop petit et le coeffi cient de déviation horizontale
trop grand, ce qui a pour conséquence que seule la
trace apparaît et l’impulsion est invisible.
Dans ces cas, il est recommandé de revenir au déclenchement
normal et de régler le point de déclenchement environ 5 mm
au-dessus ou au-dessous de la trace. Un signal de ce type est
présent si la LED de déclenchement s’allume. Pour rendre le
signal visible, il faut tout d’abord sélectionner un calibre de base
de temps plus faible et ensuite un calibre vertical plus grand.
La luminosité de la trace risque alors toutefois de diminuer au
point que l’impulsion n’est plus visible.
Testeur de composants
Le principe de test est des plus simples. Un générateur intégré dans l’oscilloscope délivre une tension sinusoïdale dont
la fréquence est de 50 Hz (±10 %). Il alimente un circuit série
composé de l’objet à tester et d’une résistance intégrée. La
tension sinusoïdale est utilisée pour la déviation horizontale
et la chute de tension aux bornes de la résistance pour la
déviation verticale.
Si l’objet à tester est une grandeur réelle (par exemple une
résistance), les deux tensions de déviation sont alors en phase. Un trait plus ou moins incliné apparaît à l’écran. Si l’objet
testé est en court-circuit, le trait est vertical. Un circuit ouvert
ou l’absence d’objet à tester produit une ligne horizontale.
L’inclinaison indique la valeur de la résistance, ce qui permet
de tester les résistances ohmiques entre 20 Ω et 4,7 kΩ.
Les condensateurs et les inductances (bobines, enroulements
de transformateur) produisent une différence de phase entre
le courant et la tension, c’est-à-dire entre les tensions de
déviation, ce qui donne lieu à une image elliptique. La position
et l’ouverture de l’ellipse caractérisent l’impédance à une
fréquence de 50 Hz. Les condensateurs peuvent être affi chés
entre 0,1 μF et 1500 μF.
– Une ellipse dont l’axe longitudinal est horizontal indique une
impédance élevée (faible capacité ou forte inductance).
– Une ellipse dont l’axe longitudinal est vertical indique une
faible impédance (capacité élevée ou faible inductance).
– Une ellipse inclinée indique une résistance ohmique rela-
tivement élevée en série avec la réactance.
Les informations spécifi ques à l’appareil se trouvent dans les
rubriques COMPONENT/PROBE et COMPONENT TESTER sous
«Éléments de commande et Readout».
L’oscilloscope est équipé d’un testeur de composants intégré.
Deux cordons de mesure simples munis de fi ches bananes de
4 mm sont nécessaires pour relier l’objet à tester à l’oscilloscope.
Les amplifi cateurs Y ainsi que la base de temps sont désactivés
en mode testeur de composants. Des tensions ne peuvent être
appliquées aux prises BNC que lors du test de composants
isolés (composants non montés dans un circuit). Lors du test
de composants en circuit, celui-ci doit être hors tension et
déconnecté de la terre. À part les deux cordons de mesure, il
ne doit exister aucune autre liaison entre l’oscilloscope et le
circuit voir «Test direct en circuit»).
Seules les fonctions «A-Int.» (intensité de la trace), «Focus»
(astigmatisme) et «Rotation de la trace» présentes dans le
menu FOCUS/TRACE ainsi que le bouton HORIZONTAL (position
X) permettent de modifi er l’image représentée.
Comme décrit dans la partie SÉCURITÉ, toutes les bornes
de mesure sont reliées à la terre et, de ce fait, également les
douilles du testeur de composants. Cela est sans importance
pour le test de composants isolés (qui ne sont pas montés dans
un appareil ou dans un circuit).
Lors du test de composants montés dans des circuits d’essai
ou des appareils, ceux-ci doivent impérativement être préalablement mis hors tension. Si l’objet à tester est alimenté par
le secteur, il faut également débrancher sa fi che secteur afi n
d’éviter tout contact entre l’oscilloscope et l’objet à tester par
le biais de la terre, ce qui risquerait de fausser les résultats
de la mesure.
Dans le cas des semiconducteurs, on reconnaît le coude de la
courbe au niveau de la transition entre l’état passant et l’état
bloqué. Si la tension le permet, l’appareil affi che la caractéristique directe et inverse (par exemple d’une diode Zener inférieure à 10 V). Comme il s’agit toujours d’un contrôle bipolaire,
il est impossible de tester le gain d’un transistor, par exemple,
mais seulement les jonctions B-C, B-E et C-E. Le courant de
test qui n’est que de quelques mA permet de contrôler sans
Il faut uniquement tester des condensateurs
!
déchargés !
22
Sous réserve de modifi cations

Transfert de données
risque les zones individuelles de pratiquement tous les semiconducteurs. Il n’est pas possible de déterminer une tension
de claquage et une tension de blocage de semiconducteur > 10
V. Cette limitation ne constitue cependant pas un inconvénient
majeur, car les écarts qui se produisent de toute façon dans le
circuit en cas de défaut permettent d’identifi er explicitement
le composant défectueux.
Il faut vérifi er la tension de service maximale de
tout composant avant de le raccorder au testeur
de composants. De nombreux composants ont
une tension de service de 7 V ou inférieure et le
testeur de composants, qui peut dans certaines
circonstances délivrer des tensions de l’ordre de
±10 V, risquerait de les détruire !
Des résultats relativement précis peuvent être obtenus en effectuant une comparaison avec des composants fonctionnels
de même type et de même valeur. Cela est notamment vrai
pour les semiconducteurs. Il est ainsi possible de déterminer
rapidement la cathode d’une diode dont le marquage est inconnu, la différence entre un transistor PNP et le modèle NPN
complémentaire ou encore l’ordre correct des broches B-C-E
d’un modèle de transistor inconnu.
Il faut ici tenir compte du fait que l’inversion des bornes d’un
semiconducteur (inversion des cordons de mesure) provoque
une rotation de l’image de 180° autour du point central du
graticule.
pour les composants MOS en matière de décharges statiques
ou de triboélectricité. Un ronfl ement peut apparaître à l’écran
si la liaison de base ou de gâchette d’un transistor est coupée,
c’est-à-dire non testée (sensibilité de la main).
Les tests effectués directement dans le circuit sont possibles
dans de nombreux cas, mais pas vraiment explicites. Le circuit
parallèle composé de grandeurs réelles et/ou complexes, notamment si celles-ci présentent une impédance particulièrement
faible à une fréquence de 50 Hz, donne généralement lieu des
différentes importantes par rapport aux composants isolés. Si
l’on travaille souvent avec des circuits de même type (entretien),
une comparaison avec un circuit en état de fonctionnement
est ici suffi sante. Cette méthode est même particulièrement
rapide, car il est inutile (et interdit !) de mettre le circuit de
référence sous tension. Il suffi t d’appliquer les cordons de
mesure successivement sur les mêmes paires de points de
mesure et de comparer les images obtenues. Sous certaines
conditions, le circuit testé contient déjà lui-même le circuit de
référence, par exemple dans le cas des canaux stéréo, d’un
étage push-pull, d’un pont symétrique. En cas de doute, il est
possible de dessouder l’une des broches du composant. Il faut
alors raccorder cette broche au cordon de mesure qui n’est pas
relié à la masse afi n de réduire le ronfl ement. La prise de test
qui comporte le signe moins est à la masse de l’oscilloscope
et donc insensible au ronfl ement.
Les images de test montrent quelques exemples pratiques
d’application du testeur de composants.
Un autre aspect important est la facilité de détection des composants coupés ou en court-circuit, ce qui est la fonction la
plus couramment utilisée lors d’un dépannage. Il est fortement
recommandé d’adopter les mesures de précaution d’usage
Sous réserve de modifi cations
23

Remarques générales
Transfert de données
Consignes de sécurité
Attention !
Toutes les bornes des interfaces sur l’oscilloscope
sont reliées galvaniquement à l’oscilloscope. Il est
interdit d’effectuer des mesures avec un potentiel
de référence élevé qui risque de présenter un risque pour l’oscilloscope, l’interface et les appareils
qui y sont connectés.
Attention !
Il faut impérativement éteindre l’appareil et
le débrancher du secteur avant de monter ou
de remplacer une interface. – L’ouverture de
l’interface dans l’oscilloscope doit toujours être
fermée en fonctionnement !
Les dommages provoqués aux produits HAMEG ne sont
pas couverts par la garantie si les consignes de sécurité
ne sont pas respectées. HAMEG n’assume en outre aucune
responsabilité pour les lésions corporelles ou les dommages
aux produits tiers.
Mise à jour du microprogramme
La mise à jour du microprogramme (fi rmware) de l’oscilloscope
peut être téléchargée sur l’Internet. Le fi chier correspondant
qui permet de procéder à la mise à jour de l’oscilloscope peut
être sélectionné à l’adresse www.hameg.de.
Indication:
Du fait des progrès techniques certains changements
et de nouvelles fonctions peuvent survenir. Si tel est le
cas, un manuel actualisé est disponible sur le site Web
de HAMEG.
La face arrière de l’appareil comporte une ouverture dans
laquelle peuvent être insérées différentes interfaces. D’origine,
l’ouverture est équipée d’un couvercle que ne doit être retiré
que pour insérer une interface avec laquelle l’ouverture
sera de nouveau fermée. Comme il s’agit d’un oscilloscope
analogique, l’interface sert uniquement à le commander et
à lire ses réglages. Si l’oscilloscope est équipé de l’interface
RS-232 HO710, celle-ci permet d’effectuer une mise à jour du
microprogramme.
L’interface RS-232 se présente sous la forme d’une prise
SUB-D à 9 broches. Cette interface bidirectionnelle permet
d’envoyer ou d’interroger les paramètres de réglage de
l’oscilloscope depuis un appareil externe (par exemple un PC).
Les données des signaux ne sont ni acquises ni enregistrées et
ne peuvent donc pas non plus être consultées. Le port série du
PC peut être relié directement à l’interface de l’oscilloscope
par le biais d’un câble blindé à 9 points (branchement direct
1:1). Il faut exclusivement utiliser des câbles blindés ayant une
longueur maximale inférieure à 3 m.
Le brochage de l’interface RS-232 (prise femelle Sub-D 9
broches) est le suivant:
Broche
2 Tx Data (transmission des données de l’oscilloscope vers
l’appareil externe)
3 Rx Data (réception des données de l’appareil externe vers
l’oscilloscope)
7 CTS prêt à émettre
8 RTS prêt à recevoir
5 Masse (potentiel de référence relié à la terre par
l’oscilloscope et le cordon secteur (classe de protection I).
9 Tension d’alimentation +5 V pour appareils externes (max.
400 mA).
L’excursion de tension maximale admissible aux bornes Tx,
Rx, RTS et CTS est de ± 12 volts. Les paramètres par défaut de
l’interface RS-232 sont les suivants : N-8-2 (sans parité, 8 bits
de données, 2 bits d’arrêt, protocole matériel RTS/CTS).
Ces paramètres peuvent être réglés sur l’oscilloscope.
24
Sous réserve de modifi cations

COMP.
TESTER
CH I MENU
AC/DC/50 Ω
GND
50 Ω / 1 MΩ
INVERT
ON / OFF
VARIABLE
ON / OFF
PROBE
1 : 1 / 10 / 100
CH I: 500 mV
POWERPOWER
PROBE
ADJ
ANALOGSCOPE
Instruments
MENUMENU
OFFOFF
Remarques générales
Interrupteur Marche/Arrêt
Titre du Menu
6 touches de fonctions (bleu)
Menu
Symbole du bouton INTENS
Flèches de direction permettant le
déplacement vers le haut ou le bas
dans les touches de fonctions
Touche de fonction basculant vers
un sous-menu
Remarques générales
Menus en incrustation et aide (HELP)
Dans la majorité des cas, une pression sur une touche affi che
un menu qui contient différentes commandes associées aux
touches de fonction bleues qui se trouvent en regard. Vous
pouvez activer, désactiver ou permuter (On/Off) la fonction en
appuyant sur la touche de fonction correspondante.
Pour quitter le menu, vous pouvez procéder comme suit:
1. Automatiquement après écoulement d’une durée programmable par l’utilisateur (réglage de la durée: touche
SETTINGS
affi chée).
2. Avec la touche MENU OFF
3. Par une nouvelle pression sur la touche de menu avec
laquelle le menu a préalablement été invoqué.
4. En invoquant un autre menu.
Certaines commandes de menu affi chent le symbole d’un
bouton. Celui-ci se rapporte au bouton INTENS
alors de modifi er les paramètres. Les autres commandes du
menu affi chent une fl èche dirigée vers la touche de fonction et
signalent ainsi qu’une pression sur cette touche affi chera un
sous-menu.
Certaines fonctions des touches ou du bouton sont sans objet
dans certains modes de fonctionnement et ne sont donc pas
disponibles. Leur actionnement n’affi che aucun menu.
Attention !
6
> Généraux > Arrêt du menu après la durée
37
.
2
qui permet
Du fait de la présence d’un menu, toutes les informations ne sont plus affi chées par le Readout. Mais
celles-ci réapparaissent dès que vous quittez le
menu.
On Off
Commutation vers la commande en
surbrillance
MENU OFF
Aide (HELP)
Chaque commande du menu est accompagnée d’explications
(textes d’aide) qui peuvent être consultées avec la touche HELP
8
et qui sont également affi chées avec le Readout. Lorsque la
fonction d’aide est activée et que vous actionnez un bouton, une
explication de la fonction de ce bouton s’affi che. Pour désactiver
l’aide, appuyez de nouveau sur la touche HELP.
Attention !
Certains menus sont accompagnés d’une «case de
sélection» qui s’affi che à gauche de ceux-ci. C’est
là que s’affi che le texte d’aide lorsque vous appuyez
sur HELP. Il n’y a plus de représentation du signal
lorsqu’une boîte de sélection ou un texte d’aide est
affi ché.
Remarques préliminaires
Lorsque l’oscilloscope est allumé, tous les réglages des paramètres de mesure importants sont affi chés à l’écran (Readout). Ceci sous réserve que le réglage d’intensité actuel du
Readout (RO-Int.) le permette et que le Readout soit activé.
Les LED qui se trouvent sur la grande face avant facilitent
l’utilisation et donnent des informations supplémentaires. Les
positions fi nales des boutons rotatifs sont matérialisées par un
signal sonore, sous réserve que le signal de contrôle soit activé
dans le menu Settings.
À l’exception de la touche de mise sous tension rouge (POWER
1
), tous les autres éléments de commande peuvent être interrogés électroniquement. Il est donc possible de mémoriser
ou de commander les fonctions ainsi que leur paramétrage
courant.
Sous réserve de modifi cations
25

Éléments de commande et Readout
Éléments de commande et Readout
La description suivante suppose que l’appareil n’est pas en
mode TESTEUR DE COMPOSANTS.
1
POWER
Interrupteur secteur et symboles correspondants pour les
positions Marche I et Arrêt O.
À la mise sous tension, le logo HAMEG, le type d’appareil et le
numéro de version s’affi chent après le délai de chauffe du tube
cathodique. Ces informations ne s’affi chent pas si la fonction
«Démarrage rapide On» (touche SETTINGS
activée au moment de l’arrêt. L’oscilloscope reprend ensuite
le paramétrage qu’il avait lors du dernier arrêt.
2
INTENS-bouton
Le bouton INTENS sert à régler différentes fonctions :
2.1 Il permet de régler l’intensité de la trace (luminosité) du
ou des signaux si la touche FOCUS/TRACE/MENU
pas allumée ni ne clignote. Une rotation à gauche diminue la
luminosité, une rotation à droite l’augmente.
2.2 Si la touche FOCUS/TRACE/MENU
le bouton INTENS
2
permet alors de modifi er, lorsqu’elles sont
activées, les fonctions affi chées dans le menu et identifi ées par
le symbole du bouton.
3
FOCUS/TRACE/MENU – touche.
6
>Généraux) était
3
n’est
3
est allumé en continu,
en continu et signale ainsi que le bouton INTENS 2 possède
une fonction qui est associée à la commande sélectionnée du
menu Curseurs.
Les fonctions de mesure au curseur qui peuvent être sélectionnées dans ce menu dépendent du mode de fonctionnement
(Yt ou XY) et concernent à la fois les lignes du curseur et leur
alignement.
Les lignes du curseur et le résultat de la mesure au curseur sont
affi chés en quittant le menu «Curseurs» avec la touche MENU
37
OFF
après avoir sélectionné le type de mesure. Le résultat
de la mesure au curseur est affi ché dans le Readout dans la
troisième ligne à partir du haut (exemple: ΔV(CH2):16.6 mV).
Si le bouton a la fonction de vernier de réglage fi n (Variable) et
que la voie de mesure n’est pas calibrée, la valeur mesurée est
précédée de «>» à la place de «:».
Positionnement du curseur
Le positionnement des lignes du curseur s’effectue à l’aide
des boutons POSITION 1 et POSITION 2 s’ils se trouvent en
mode «Curseurs». La sélection de la fonction de ces boutons
s’effectue dans le menu Pos./Échelle qui s’affi che en appuyant
sur la touche CH1/2–CURSOR–TRACE SEP
11
. Vous pouvez
alors défi nir avec les touches de fonction «Curseurs» (lignes
longues du curseur), «Curseur secondaire» (ligne(s) courte(s)
du curseur ou autres symboles) et «Paire cur.» (déplacement
simultané des deux lignes du curseur = tracking) les lignes à déplacer avec les boutons POSITION 1 et POSITION 2 (
9
et 10).
Commandes du menu
Les commandes et mesures au curseur suivantes sont disponibles, suivant le mode de fonctionnement (Yt, XY), lorsque le
menu Curseurs est affi ché. «Off» désactive le curseur, ferme
le menu «Curseurs» et désactive l’affi chage des résultats des
mesures au curseur dans le Readout.
Le menu «Bouton INTENS» s’affiche simultanément si le
symbole du bouton s’allume après avoir appuyé sur cette
touche. Les commandes du menu dépendent du mode de
fonctionnement:
A-Int.: réglage de la luminosité de la trace du signal rep-
résenté avec la base de temps A
B-Int.: réglage de la luminosité de la trace du signal rep-
résenté avec la base de temps B
RO-Int.: réglage de l’intensité du Readout
Focus: réglage de l’astigmatisme du signal et du Readout
Rot. trace: rotation de la trace (voir «Rotation de la trace TR»
dans la partie «Mise en route et préréglages»)
Readout On Off:
Les interférences provoquées par le Readout peuvent
être éliminées en le désactivant OFF. Le symbole
du bouton clignote lorsque le Readout est désactivé
et seuls les menus et le texte d’aide sont encore
affi chés.
Le Readout est toujours activé ON à la mise sous tension de
l’oscilloscope!
4
CURSOR MEASURE (Touche)
La touche CURSOR MEASURE fait apparaître les lignes Cursor
si elles étaient désactivées et les résultats des mesures au
curseur sont simultanément affi chés par le Readout. Si les
lignes du curseur sont déjà affi chées, une nouvelle pression
sur la touche CURSOR MEASURE fait apparaître le menu Curseurs. De plus, la touche FOCUS TRACE MENU
3
s’allume
4.1 Type de mesure
Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez sélectionner
l’un des types de mesure affi chés dans la fenêtre de sélection
avec le bouton INTENS
2
. Dans la majorité des cas, l‘unité
correspondant s‘affi che automatiquement lors de la sélection
du type de mesure. Les fonctions des types de mesure sont
explicites.
4.2 Unité
Si le type de mesure sélectionné est «Rapport X» ou «Rapport Y»,
le symbole du bouton INTENS s’affi che alors en plus de l’unité
et cette dernière peut alors être déterminée par l’utilisateur.
4.2.1 «Rat» (ratio), affi chage du rapport
Ce type de mesure permet de déterminer des rapports de sonde et d’amplitude à l’aide du curseur. L’écart entre les lignes
longues du curseur correspond à 1.
4.2.2 «%» affi chage du pourcentage
L’écart entre les lignes longues du curseur correspond à 100 %.
Le résultat de la mesure est déterminé à partir de l’écart entre
la ligne courte du curseur secondaire et la ligne de référence
longue (en bas ou à gauche) et, le cas échéant, affi ché avec un
signe négatif.
4.2.3 «°» mesure d’angle
L’écart entre les lignes longues du curseur correspond à 360° et
doit être égal à une période du signal. Le résultat de la mesure
est déterminé à partir de l’écart entre la ligne de référence et
la ligne courte du curseur secondaire et, le cas échéant, affi ché avec un signe négatif. Vous trouverez plus d’informations
à ce sujet dans le paragraphe «Mesure de différence de phase
26
Sous réserve de modifi cations

Éléments de commande et Readout
POWER
MENU
OFF
1 2 3 4 5 876
POWER
INTENS
!
FOCUS
TRACE
150 MHz
SAVE/
RECALL
AUTOSET
ANALOG
MENU
CURSOR
MEASURE
9
11
10
13
POSITION 1 POSITION 2
VOLTS / DIV
VAR
12
14
MENU
OFF
20 V 1 mV 20 V 1 mV
CH 1 CH 2 HOR MAG
VAR VAR VAR x1 0
CH 1 CH 2
X-INP
!
CAT I
CH 1/2
CURSOR
TRACE
SEP
AUTO
MEASURE
VERT/XY
INPUTS
1MΩII15pF
max
400 Vp
OSCILLOSCOPE
HM1500-2
VOLTS / DIV
VAR
MODE
FILTER
SOURCE
AUX
!
CAT I
LEVEL A/B
TRIGGER
TRIG ’ d
NORM
HOLD OFF
SETTINGS HELP
HORIZONTAL
X-POS
DELAY
TIME / DIV
VAR
0.5s 50ns
AUXILIARY INPUT
TRIG. EXT. / Z-INP.
1MΩ II
15pF
max
100 Vp
15
22
23
16
19
17
20
24
18
21
25
26
37
27 30 28 29 31 32
en mode double trace (Yt)», dans la section «Mise en route et
préréglages».
4.2.4 «π»
Mesure de la valeur de π en fonction de l’écart entre les lignes
du curseur. Une période d’une sinusoïde (ondulation complète)
est égale à 2π. L’écart entre les deux lignes longues du curseur doit donc être égal à 1 période. Si l’écart entre la ligne de
référence et la ligne courte du curseur est de 1,5 périodes, le
résultat affi ché est 3π. Si la ligne courte du curseur se trouve à
gauche de la ligne de référence, la valeur de π et alors précédée
d’un signe négatif.
4.3 Référence
Le symbole du bouton INTENS s’affi che en plus de la désignation de la voie lorsque la mesure au curseur peut se rapporter
à plusieurs signaux. Cela vous permet de déterminer la voie ou
le calibre auquel doit se rapporter la mesure au curseur. Bien
évidemment, les lignes du curseur doivent alors se trouver sur
le signal ou la partie de signal affi ché avec cette voie.
4.4 Off (curseurs désactivés)
Une pression sur cette touche de fonction désactive le curseur,
l’affi chage des résultats de la mesure et ferme le menu Curseurs. Pour fermer le menu Curseurs et affi cher ensuite les
résultats de la mesure au curseur, il faut quitter le menu avec
la touche MENU OFF
37
.
33
5.1 Sauvegarde (Régl. act.)
La touche de fonction «Sauvegarde» affi che le sous-menu
«Sauvegarder Régl. act.». La touche de fonction «Page 1 2» permet de sélectionner la page, le numéro de la page sélectionné
étant le plus lumineux. La page 1 contient les mémoires 1 à 5
et la page 2 les mémoires 6 à 9. Les réglages de l’oscilloscope
sont sauvegardés dans la mémoire dont la touche de fonction
est enfoncée.
5.2 Charger (Régl. act.)
La touche de fonction «Charger» affi che le sous-menu «Charger Régl. act.». La touche de fonction «Page 1 2» permet de
sélectionner la page, le numéro de la page sélectionné étant le
plus lumineux. La page 1 contient les mémoires 1 à 5 et la page
2 les mémoires 6 à 9. L’oscilloscope adopte les réglages de la
mémoire dont la touche de fonction est enfoncée.
6
SETTINGS – touche
La touche SETTINGS affi che le menu Réglages qui contient
différents sous-menus que vous pouvez invoquer avec les
touches de fonction associées.
6.1 Langue
Ce sous-menu vous permet de sélectionner la langue. Les
menus et les textes d’aide existent en allemand, en anglais et
en français.
5
SAVE/RECALL – touche
La fonction «Sauv./Charg» permet de sauvegarder les réglages
actuels de l’appareil ou de charger des réglages sauvegardés
précédemment. Vous disposez à cet effet de 9 mémoires dont le
contenu est conservé même après avoir éteint l‘oscilloscope.
6.2 Généraux
6.2.1 Signal de contrôle On Off
Off: les signaux (bips) sonores qui signalent la position fi nale
d’un bouton, par exemple, sont désactivés.
Sous réserve de modifi cations
27

Éléments de commande et Readout
6.2.2 Signal de défaut On Off
Off: les signaux (bips) sonores qui signalent les situations de
défaut sont désactivés.
6.2.3 Démarrage rapide On Off
Off: le logo HAMEG, le type d’appareil et le numéro de version
ne s’affi chent pas et l’appareil est plus rapidement prêt pour
les mesures.
6.2.4 Menu Off time
Le bouton INTENS 2 permet de défi nir le délai après lequel
un menu affi ché se referme automatiquement. Pour quitter le
menu avant l’écoulement de ce délai, il suffi t d’appuyer sur la
touche MENU OFF
37
.
Si l’option choisie est «Man.» (manuel), vous pouvez quitter le
menu comme suit:
– Avec la touche MENU OFF
37
– En appuyant sur une autre touche
– En appuyant sur la touche avec laquelle le menu a préalab-
lement été invoqué.
6.3 Interface
Si une interface est installée, ce sous-menu permet d’en affi cher les paramètres.
6.4 Auto-calibrage
Cette touche de fonction affi che le menu «Réglages Auto-calibrage». Vous pouvez lancer une compensation automatique
avec la touche de fonction «Démarrer» si les entrées de
l’oscilloscope ne sont pas connectées. Celle-ci peut être interrompue prématurément avec la touche MENU OFF
37
.
La compensation automatique optimise le comportement
de l’oscilloscope aux températures actuelles. Il convient de
ne lancer l’auto-calibrage qu’après au moins 30 minutes de
fonctionnement.
CH1/2-CURSOR-TRACE SEP
11
et de la commande active dans
le menu.
9.1 Position Y
9.1.1 Position Y – voie 1
Le bouton POSITION 1 permet de régler la position verticale (Y)
de la voie 1 en mode Yt (base de temps) et si la touche CH1/2CURSOR-TRACE SEP
9.1.2 Position Y – 2
11
n’est pas allumée.
ème
base de temps (TRACE SEP) (voie 1 et
voie 2)
Le bouton POSITION 1 permet de modifi er la position du signal
expansé de la base de temps B en mode base de temps alternée afi n de le séparer de la base de temps A (séparation des
traces). Pour ce faire, il faut activer la fonction «Rechercher»
(touche HOR VAR
26
>Rechercher) et sélectionner la fonction
TB B après avoir appuyé sur la touche CH1/2-CURSOR-TRACE
11
SEP
(la touche s’allume en vert).
9.2 Position X en mode XY (voie 1)
Le bouton POSITION 1 permet de régler la position horizontale
(X) de la voie 1 en mode XY et si la touche CH1/2-CURSORTRACE SEP
11
n’est pas allumée.
Remarque: en mode XY, la position horizontale (X)
peut également être réglée avec le bouton HORIZONTAL
23
.
9.3 Position CURSOR
Le bouton POSITION 1 peut être utilisé pour régler la position
des curseurs à condition que ceux-ci soient activés (en appuyant sur la touche CURSOR MEASURE
4
et si la fonction
Curseurs ou Paire cur. a ensuite été sélectionnée après avoir
appuyé sur la touche CH1/2–CURSOR–TRACE SEP
11
(celle-ci
s’allume en bleu).
7
AUTOSET – touche
AUTOSET réalise un réglage automatique de l’appareil en fonction du signal (voir AUTOSET). Cela concerne la position de la
trace, l‘amplitude du signal et le calibre de la base de temps. En
mode testeur de composants, XY ou ADD (addition), la fonction
AUTOSET active le mode DUAL. Elle ne modifi e pas les modes
de fonctionnement DUAL, CH1 ou CH2.
Une pression sur AUTOSET règle la luminosité du signal à une
valeur moyenne si le réglage était précédemment inférieur à
celle-ci. Si un menu est affi ché, AUTOSET le ferme. AUTOSET
est sans effet lorsqu’un texte d’aide est affi ché.
8
HELP – touche
Une pression sur la touche HELP affi che un texte d’aide et
simultanément masque le signal.
Si un menu est affi ché, le texte d’aide se rapporte à celui-ci ou
à la fonction ou au sous-menu sélectionné. Si vous actionnez
un bouton, le texte d’aide correspondant s’affi che alors également. Une nouvelle pression sur la touche HELP fait disparaître
le texte.
9
POSITION 1 – bouton
Le bouton sert à régler différentes fonctions. Celles-ci dépendent du mode de fonctionnement, de la position de la touche
Attention!
La fonction «Paire cur.» n’est disponible que si 2
curseurs sont affi chés. Ceux-ci peuvent alors être
déplacés simultanément sans que l’écart entre eux
ne se modifi e.
10
POSITION 2 – bouton
Le bouton sert à régler différentes fonctions. Celles-ci dépendent du mode de fonctionnement, de la position de la touche
CH1/2-CURSOR-TRACE SEP
11
et de la commande active dans
le menu.
10.1 Position Y
10.1.1 Position Y – voie 2
Le bouton POSITION 2 permet de régler la position verticale (Y)
de la voie 2 en mode Yt (base de temps) et si la touche CH1/2CURSOR-TRACE SEP
11
n’est pas allumée.
10.2 Position X en mode XY (voie 2)
Le bouton POSITION 2 permet de régler la position horizontale
(X) de la voie 2 en mode XY et si la touche CH1/2-CURSORTRACE SEP
11
n’est pas allumée.
10.3 Position CURSOR
Le bouton POSITION 2 peut être utilisé pour régler la position des
curseurs à condition que ceux-ci soient activés (en appuyant sur la
touche CURSOR-MEASURE
4
et si la fonction Curseurs ou Paire
cur. a ensuite été sélectionnée après avoir appuyé sur la touche
CH1/2–CURSOR–TRACE SEP
11
(celle-ci s’allume en bleu).
28
Sous réserve de modifi cations

Éléments de commande et Readout
POWER
MENU
OFF
1 2 3 4 5 876
POWER
INTENS
!
FOCUS
TRACE
150 MHz
SAVE/
RECALL
AUTOSET
ANALOG
MENU
CURSOR
MEASURE
9
11
10
13
POSITION 1 POSITION 2
VOLTS / DIV
VAR
12
14
MENU
OFF
20 V 1 mV 20 V 1 mV
CH 1 CH 2 HOR MAG
VAR VAR VAR x1 0
CH 1 CH 2
X-INP
!
CAT I
CH 1/2
CURSOR
TRACE
SEP
AUTO
MEASURE
VERT/XY
INPUTS
1MΩII15pF
max
400 Vp
OSCILLOSCOPE
HM1500-2
VOLTS / DIV
VAR
MODE
FILTER
SOURCE
AUX
!
CAT I
LEVEL A/B
TRIGGER
TRIG ’ d
NORM
HOLD OFF
SETTINGS HELP
HORIZONTAL
X-POS
DELAY
TIME / DIV
VAR
0.5s 50ns
AUXILIARY INPUT
TRIG. EXT. / Z-INP.
1MΩ II
15pF
max
100 Vp
15
22
23
16
19
17
20
24
18
21
25
26
37
27 30 28 29 31 32
Attention !
La fonction «Paire cur.» n’est disponible que si
2 curseurs sont affi chés. Ceux-ci peuvent alors être
déplacés simultanément sans que l’écart entre eux
ne se modifi e.
11
CH1/2-CURSOR-TRACE SEP – touche
Après avoir affi ché un menu avec cette touche, vous pouvez
choisir, selon les conditions de fonctionnement actuelles, la
fonction des boutons POSITION 1
9
et POSITION 2
10
.
La touche indique la fonction courante correspondant à
l’inscription en face avant:
éteinte = réglage de la position verticale et du calibre de la
voie 1 et/ou 2.
bleue = réglage des curseurs
verte = réglage de la position verticale
du ou des signaux de la base de temps B
12
VOLTS/DIV-VAR – bouton
Ce bouton agit sur la voie 1 et possède plusieurs fonc-
tions.
12.1 Réglage des calibres
Cette fonction est active lorsque la touche CH1 VAR
27
n’est
pas allumée.
Tournez le bouton vers la gauche pour augmenter le calibre, vers
la droite pour le réduire. Les calibres disponibles sont compris
entre 1 mV/div. et 20 V/div. (lorsque la sonde n’est pas branchée,
sinon en fonction de l’atténuateur de cette dernière, par exemple
10:1 / 100:1, ou du facteur d’atténuation réglé) selon une séquence
1-2-5. Le calibre est indiqué par le Readout (par ex. «CH1:5mV»)
et il est calibré. Le signal est représenté avec une amplitude
plus ou moins grande en fonction du calibre sélectionné.
33
Attention!
Le calibre réglé s’applique même lorsque la voie 1
n’est pas représentée, par exemple en mode monovoie par la voie 2. La voie 1 peut alors être utilisée
comme entrée pour la synchronisation interne.
12.2 Réglage (fi n) variable
Cette fonction est activée en appuyant sur la touche CH1 VAR
27
puis en sélectionnant Variable On avec la touche de fonction
dans le menu CH1. La touche CH1 VAR
signale ainsi que le bouton VOLTS/DIV–VAR
27
s’allume alors et
12
sert au réglage
fi n. Vous pouvez ensuite faire varier le calibre entre 1 mV/cm
et >20 V/div. (lorsque la sonde n’est pas branchée, sinon en
fonction de l’atténuateur de cette dernière, par exemple 10:1
/ 100:1, ou du facteur d’atténuation réglé) et ainsi l’amplitude
du signal représenté.
Si le coeffi cient de déviation n’est pas calibré, le Readout indique
par exemple «...>5mV...» et les résultats des mesures au curseur ne sont pas non plus calibrés. S’il est calibré, le Readout
affi che «...:5mV...» par exemple.
Si vous désactivez le réglage fi n (Variable Off) dans le menu CH1,
le coeffi cient de déviation est alors calibré, la touche CH1 VAR
27
ne s’allume pas et le bouton VOLTS/DIV–VAR 12 change le
calibre selon la séquence 1-2-5.
13
VOLTS/DIV-SCALE-VAR – bouton
Ce bouton agit sur la voie 2 et possède plusieurs fonc-
tions.
13.1 Réglage des calibres
Cette fonction est active lorsque la touche CH2 VAR
29
n’est pas allumée. Tournez le bouton vers la gauche pour
augmenter le calibre, vers la droite pour le réduire. Les
Sous réserve de modifi cations
29

Éléments de commande et Readout
calibres disponibles sont compris entre 1 mV/div. et 20 V/div.
(lorsque la sonde n’est pas branchée, sinon en fonction de
l’atténuateur de cette dernière, par exemple 10:1 / 100:1, ou
du facteur d’atténuation réglé) selon une séquence 1-2-5.
Le calibre est indiqué par le Readout (par ex. «CH2:5mV») et
il est calibré. Le signal est représenté avec une amplitude
plus ou moins grande en fonction du calibre sélectionné.
Attention !
Le calibre réglé s’applique même lorsque la voie 2
n’est pas représentée, par exemple en mode monovoie par la voie 1. La voie 2 peut alors être utilisée
comme entrée pour la synchronisation interne.
13.2 Réglage (fi n) variable
Cette fonction est activée en appuyant sur la touche CH2 VAR
29
puis en sélectionnant Variable On avec la touche de fonction
dans le menu CH2. La touche CH2 VAR
signale ainsi que le bouton VOLTS/DIV–VAR
29
s’allume alors et
13
sert au réglage
fi n. Vous pouvez ensuite faire varier le calibre entre 1 mV/cm
et >20 V/div. (lorsque la sonde n’est pas branchée, sinon en
fonction de l’atténuateur de cette dernière, par exemple 10:1
/ 100:1, ou du facteur d’atténuation réglé) et ainsi l’amplitude
du signal représenté.
Si le coeffi cient de déviation n’est pas calibré, le Readout indique
par exemple «...>5mV...» et les résultats des mesures au curseur ne sont pas non plus calibrés. S’il est calibré, le Readout
affi che «...:5mV...» par exemple.
Si vous désactivez le réglage fi n (Variable Off) dans le menu CH2,
le coeffi cient de déviation est alors calibré, la touche CH2 VAR
29
ne s’allume pas et le bouton VOLTS/DIV–VAR 13 change le
calibre selon la séquence 1-2-5.
d’entrée de la voie à laquelle est appliquée le signal mesuré
doit être DC (tension/courant continu) et le couplage de
déclenchement DC doit être sélectionné pour les mêmes
raisons.
Il faut également tenir compte des points suivants :
– La précision de mesure diminue avec les signaux à fré-
quence plus élevée en raison de la bande passante de
l’amplifi cateur de déclenchement.
– Il existe des variations au niveau de la représentation du
signal, car la bande passante de l’amplifi cateur vertical est
différente de celle de l’amplifi cateur de déclenchement.
– Lors de la mesure de tensions alternatives à très basse fré-
quence (< 20 Hz), l’affi chage suit l’évolution de la tension.
– Lors de la mesure de tensions impulsionnelles, la valeur
affi chée peut présenter des variations. Le niveau de variation
dépend du rapport cyclique du signal mesuré et du front de
déclenchement choisi.
– Pour éviter les erreurs de mesure, la trace doit se trouver
à l’intérieur du quadrillage, ce qui veut dire qu’il ne doit y
avoir aucune saturation de l’amplifi cateur de mesure.
– Lorsque la fonction Variable est activée, le coeffi cient de
défl ection et/ou la base de temps n’est pas calibrée. Ceci
est signalisé par le symbole «>» dans le Readout.
Attention !
Du fait du risque d’erreurs de mesure, il convient
de réaliser la mesure de signaux complexes avec
les curseurs.
14.1 Type de mesure
Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez sélectionner l’un
des types de mesure affi chés dans la fenêtre de sélection avec
le bouton INTENS
2
. Dans la majorité des cas, l’unité correspondant s’affi che automatiquement lors de la sélection du type
de mesure. La fonction des types de mesure est explicite.
14
AUTO MEASURE – touche.
La touche AUTO MEASURE est sans effet en mode XY. La touche
AUTO MEASURE active la fonction du même nom si celle-ci était
désactivée et fait en même temps apparaître les résultats de
la mesure automatique en haut à droite dans le Readout, sous
les informations de déclenchement.
Une nouvelle pression sur la touche AUTO MEASURE affi che
le menu «Mesure» ainsi qu’un menu de sélection. De plus, la
touche FOCUS TRACE MENU
ainsi que le bouton INTENS
3
s’allume en continu et signale
2
possède une fonction qui est
associée à la commande sélectionnée du menu «Mesure».
Les résultats de la fonction AUTO MEASURE sont affi chés en
haut à droite dans le Readout, dans la ligne sous la source, le
front et le couplage de déclenchement.
Les mesures automatiques qui peuvent être sélectionnées dans
ce menu se rapportent au signal de déclenchement et varient
en fonction du mode de fonctionnement.
Il faut en principe remplir les conditions suivantes :
a) Les conditions de déclenchement doivent être remplies lors
des mesures de fréquence et de période. Le déclenchement
normal est nécessaire pour les signaux inférieurs à 20 Hz.
Attention ! Un temps de mesure de plusieurs secondes est
nécessaire pour les signaux à très basse fréquence.
b) Pour pouvoir acquérir également les tensions continues
ou la composante continue des tensions mixte, le couplage
14.2 Référence Tr
L’information «Référence Tr» sert uniquement à indiquer que le
signal de déclenchement est en cours d’interprétation, ce qui a
pour conséquence que la touche de fonction est sans effet.
14.3 Off
Une pression sur la touche de fonction «Off» désactive la fonction AUTO MEASURE et referme le menu.
Pour quitter le menu sans désactiver la fonction AUTO MEASURE, appuyez sur la touche MENU OFF
15
LEVEL A/B – bouton
37
.
Le bouton LEVEL permet de régler le point de déclenchement,
c’est-à-dire la tension qu’un signal de déclenchement doit franchir pour déclencher un balayage horizontal. Dans la majorité
des modes Yt, le Readout affi che un symbole dont la position
verticale indique le point de déclenchement par rapport à la
trace. Dans les modes de fonctionnement où il n’existe aucune
relation directe entre le signal de déclenchement et le point de
déclenchement, le symbole de ce dernier est «rangé» sur la
deuxième ligne de la ligne en partant du bas. Le symbole du
déclenchement ne s’affi che pas.
Une modifi cation du réglage LEVEL en déclenchement normal
modifi e également la position du symbole du point de déclenchement dans le Readout. Il doit aussi exister un signal en
déclenchement automatique sur valeur de crête, car le symbole
du point de déclenchement et ainsi le point de déclenchement
ne peut être positionné qu’au sein de la valeur de crête du
signal.
30
Sous réserve de modifi cations

Éléments de commande et Readout
POWER
MENU
OFF
1 2 3 4 5 876
POWER
INTENS
!
FOCUS
TRACE
150 MHz
SAVE/
RECALL
AUTOSET
ANALOG
MENU
CURSOR
MEASURE
9
11
10
13
POSITION 1 POSITION 2
VOLTS / DIV
VAR
12
14
MENU
OFF
20 V 1 mV 20 V 1 mV
CH 1 CH 2 HOR MAG
VAR VAR VAR x1 0
CH 1 CH 2
X-INP
!
CAT I
CH 1/2
CURSOR
TRACE
SEP
AUTO
MEASURE
VERT/XY
INPUTS
1MΩII15pF
max
400 Vp
OSCILLOSCOPE
HM1500-2
VOLTS / DIV
VAR
MODE
FILTER
SOURCE
AUX
!
CAT I
LEVEL A/B
TRIGGER
TRIG ’ d
NORM
HOLD OFF
SETTINGS HELP
HORIZONTAL
X-POS
DELAY
TIME / DIV
VAR
0.5s 50ns
AUXILIARY INPUT
TRIG. EXT. / Z-INP.
1MΩ II
15pF
max
100 Vp
15
22
23
16
19
17
20
24
18
21
25
26
37
27 30 28 29 31 32
La modifi cation s’effectue dans le sens vertical. Pour éviter
que le symbole du point de déclenchement ne remplace
d’autres informations du Readout, sa zone d’affi chage est
limitée. Un changement de la forme du symbole indique la
direction dans laquelle le point de déclenchement a quitté la
grille de mesure.
Le bouton de réglage du point de déclenchement agit sur la
base de temps A ou B, suivant le mode de fonctionnement
de celle-ci. Le mode de fonctionnement de la base de temps
peut être sélectionné dans le menu «Base de temps» après
avoir appuyé sur la touche HOR VAR
26
. En mode «Recherche»
(bases de temps A et B alternées) et en mode base de temps
B seule, l’appareil conserve le dernier réglage LEVEL (bord
gauche de la grille) en rapport avec la base de temps A lorsque
la base de temps B passe en mode déclenché (menu Base de
temps: déclenchement B sur front montant ou descendant). Le
bouton de réglage LEVEL A/B sert ensuite à régler le point de
déclenchement de la base de temps B et un deuxième symbole de point de déclenchement s’affi che auquel est associée
la lettre B.
16
MODE – touche
Cette touche affi che le menu «Déclenchement» qui permet de
sélectionner les options Auto, Normal et Monocoup. «Front»
déclenche sur toutes les formes de signal. En mode «Vidéo», la
touche Filtre
17
offre des options de déclenchement spéciales
pour les signaux vidéocomposites qui se composent d’images
et d’impulsions de synchronisation.
Les touches MODE
16
, FILTER 17 et SOURCE 18 sont sans
effet en mode XY, car les représentations XY ne sont pas déclenchées.
33
16.1 Auto
Il y a déclenchement automatique lorsque NORM
20
n’est pas
allumé. En mode «Auto», le balayage horizontal est lancé périodiquement par le déclenchement automatique, et ce même
si aucun signal n’est présent ou si les réglages ne conviennent
pas pour un déclenchement. Les signaux dont la fréquence
est inférieure à la fréquence de répétition du déclenchement
automatique ne peuvent pas être représentés synchronisés.
Le déclenchement automatique a alors déjà démarré la base
de temps avant que le signal lent n’ait rempli les conditions de
déclenchement. Le déclenchement automatique peut avoir lieu
avec ou sans détection de la valeur de crête. Le bouton LEVEL
15
A/B
est actif dans les deux cas.
Avec le déclenchement sur valeur de crête, la plage de réglage
du bouton LEVEL A/B 15 est limitée par les valeurs des crêtes
négative et positive du signal de déclenchement. En l’absence
de déclenchement sur valeur de crête, la plage de réglage
LEVEL ne dépend plus du signal de déclenchement et le seuil
peut alors être réglé trop haut ou trop bas. Le déclenchement
automatique veille alors à ce qu’un signal soit toujours représenté, mais il n’est alors pas synchronisé.
L’activation ou non du déclenchement sur valeur de crête dépend du mode de fonctionnement et du FILTER (couplage de
déclenchement) sélectionné. La confi guration en présence est
reconnaissable par le comportement du symbole du point de
déclenchement en faisant tourner le bouton LEVEL.
16.2 Normal
La LED NORM
20
s’allume en déclenchement NORMAL. En
déclenchement normal, le déclenchement automatique et le
déclenchement sur valeur de crête sont tous deux désactivés.
Il n’y a pas de balayage horizontal en l’absence de signal de
déclenchement ou si le réglage LEVEL est incorrect.
Sous réserve de modifi cations
31

Éléments de commande et Readout
Contrairement au déclenchement automatique et du fait que
celui-ci soit désactivé, il est également possible d’obtenir
une représentation synchronisée de signaux à très basse
fréquence.
17
FILTER – touche (couplage de déclenchement)
Le menu qui s’affi che après avoir appuyé sur cette touche
dépend de l’option choisie dans MODE
touches MODE
16
, FILTER 17 et SOURCE 18 sont sans effet en
16
(Front ou Vidéo). Les
mode XY, car les représentations XY ne sont pas déclenchées.
17.1 Menu: Front
Le menu FRONT s’affi che en appuyant sur la touche FILTRE si
l’option FRONT est présente dans le menu «Déclenchement»
invoqué avec MODE
16
. Vous trouverez plus d’informations
dans la section Couplage de déclenchement [Menu: FILTRE]
sous la rubrique «Déclenchement et balayage horizontal» et
sur la fi che technique de l’oscilloscope. Vous pouvez choisir
l’une des options suivantes:
17.1.1 Filtre décl. (couplage de déclenchement)
– AC: Avec un couplage pour tension alternative, le signal de
déclenchement parvient du dispositif de déclenchement par
le biais d’un condensateur relativement grand afi n d’obtenir
une fréquence inférieure la plus basse possible.
Readout: «Tr: source, front, AC»
En position «Les deux», chaque front provoque le déclenchement et permet ainsi l’affi chage de «diagrammes en œil». En
acquisition monocoup, l’option «Les deux» permet de déclencher sur un événement indépendamment du sens du front.
17.2 Menu: Vidéo
Le menu VIDÉO s’affi che en appuyant sur la touche FILTRE si
l’option VIDÉO est présente dans le menu «Déclenchement»
invoqué avec MODE
16
. Vous trouverez plus d’informations
dans la section VIDÉO [déclenchement sur signal TV] sous la
rubrique «Déclenchement et balayage horizontal» et sur la
fi che technique de l’oscilloscope. Vous pouvez choisir l’une
des options suivantes:
17.2.1 Trame Ligne
Le déclenchement a lieu sur les impulsions de synchronisation
de trame ou de ligne, suivant le réglage courant. Les autres
options du menu changent en même temps que le mode.
Readout: «Tr: source, TV»
17.2.1.1 Trame
– Toutes: avec cette option, le démarrage de la base de temps
peut être déclenché par les impulsions de synchronisation
de chaque trame.
– Paires: seules les impulsions de synchronisation des trames
paires peuvent déclencher la base de temps.
– Impaires: seules les impulsions de synchronisation des
trames impaires peuvent déclencher la base de temps.
– DC: Couplage pour tension continue du signal de déclenche-
ment. Le déclenchement sur valeur de crête est désactivé.
Readout: «Tr: source, front, DC»
– HF: Couplage pour haute fréquence avec un condensateur
relativement petit, ce qui atténue les composantes à basse
fréquence. Du fait du couplage de déclenchement HF, la
trace et le signal de déclenchement ne sont plus identiques.
Par conséquent, le symbole du point de déclenchement est
«rangé» (mode numérique) dans une position Y fi xe et le
bouton LEVEL A/B
15
ne permet plus de le déplacer même
si le point de déclenchement change. Le symbole du point
de déclenchement n’est pas affi ché en mode analogique.
Comme le couplage de déclenchement BF et la suppression
du bruit (réduction des composantes à haute fréquence du
signal de déclenchement) sont sans objet en relation avec
le couplage de déclenchement HF, ces deux commandes
du menu ne sont pas affi chées.
Readout: «Tr: source, front, HF»
– BF: Couplage du signal de déclenchement par un fi ltre pas-
se-bas pour supprimer les composantes haute fréquence du
signal. Comme le couplage BF réduit de toute façon les composantes à haute fréquence du signal de déclenchement,
la fonction de suppression du bruit est automatiquement
désactivée (Off).
Readout: «Tr: source, front, AC ou DC, BF»
– Suppress. bruit: La suppression du bruit (Noise Reject =
NR) fi xe une fréquence limite supérieure plus basse de
l’amplifi cateur de déclenchement et permet ainsi de réduire
le bruit dans le signal de déclenchement.
Readout: «Tr: source, front, AC ou DC, NR»
17.1.2 Front
Le front choisi (SLOPE) détermine si le signal de déclenchement (tension de déclenchement) doit déclencher la base de
temps sur un front «Montant» ou «Descendant» lorsque le
signal atteint la tension de référence préalablement réglée
avec le bouton LEVEL A/B
15
.
17.2.1.2 Ligne
– Toutes: avec cette option, chaque impulsion de synchro-
nisation de ligne peut déclencher la base de temps.
– N° de ligne: Le bouton INTENS permet de déterminer le
numéro de ligne dont l’impulsion de synchronisation doit
déclencher la base de temps.
– Ligne mini.: Une pression sur cette touche active le plut
petit numéro de ligne.
17.2.2 Norme
La touche de fonction permet de sélectionner les signaux vidéo à
525 lignes et une fréquence d’image (de trame) de 60 Hz (par ex.
NTSC) ou à 625 lignes et une fréquence d’image (de trame) de
50 Hz (par ex. PAL). Le «N° de ligne» change automatiquement
en passant d’un format à l’autre.
17.2.3 Polarité
Les signaux vidéo peuvent se présenter avec une polarité
positive ou négative. Le terme polarité décrit la position du
contenu de l’image et de la ligne par rapport aux impulsions
de synchronisation. Ce paramètre est important pour le
déclenchement, car la base de temps ne doit pas être démarrée par le contenu de l’image, mais par les impulsions
de synchronisation qui, contrairement au contenu de limage,
ne changent pas.
Avec une polarité positive, les valeurs de la tension du contenu de l’image sont plus positives que celles de l’impulsion de
synchronisation et l’inverse avec une polarité négative. Si la
polarité est mal réglée, le signal n’est pas synchronisé, peut
ne pas apparaître ou ne pas être rafraîchi.
18
SOURCE – touche
Le menu qui s’affi che après avoir appuyé sur cette touche
dépend de l’option choisie dans MODE
Les touches MODE
16
, FILTER 17 et SOURCE 18 sont sans
16
(Front ou Vidéo).
effet en mode XY, car les représentations XY ne sont pas déclenchées.
32
Sous réserve de modifi cations

Éléments de commande et Readout
POWER
MENU
OFF
1 2 3 4 5 876
POWER
INTENS
!
FOCUS
TRACE
150 MHz
SAVE/
RECALL
AUTOSET
ANALOG
MENU
CURSOR
MEASURE
9
11
10
13
POSITION 1 POSITION 2
VOLTS / DIV
VAR
12
14
MENU
OFF
20 V 1 mV 20 V 1 mV
CH 1 CH 2 HOR MAG
VAR VAR VAR x1 0
CH 1 CH 2
X-INP
!
CAT I
CH 1/2
CURSOR
TRACE
SEP
AUTO
MEASURE
VERT/XY
INPUTS
1MΩII15pF
max
400 Vp
OSCILLOSCOPE
HM1500-2
VOLTS / DIV
VAR
MODE
FILTER
SOURCE
AUX
!
CAT I
LEVEL A/B
TRIGGER
TRIG ’ d
NORM
HOLD OFF
SETTINGS HELP
HORIZONTAL
X-POS
DELAY
TIME / DIV
VAR
0.5s 50ns
AUXILIARY INPUT
TRIG. EXT. / Z-INP.
1MΩ II
15pF
max
100 Vp
15
22
23
16
19
17
20
24
18
21
25
26
37
27 30 28 29 31 32
Le menu «Source décl.» permet de défi nir l’entrée d’où provient
le signal de déclenchement. Les options possibles dépendent
du mode de fonctionnement courant de l’oscilloscope.
18.1 Déclenchement Front/Vidéo
18.1.1 CH1
La voie 1 sert de source de déclenchement, et ce qu’elle soit
affi chée ou non. Après être passé par le couplage d’entrée et
l’atténuateur, le signal qui y est appliqué parvient au dispositif
de déclenchement.
Readout: «Tr: CH1, front, fi ltre»
18.1.2 CH2
La voie 2 sert de source de déclenchement, et ce qu’elle soit
affi chée ou non. Après être passé par le couplage d’entrée et
l’atténuateur, le signal qui y est appliqué parvient au dispositif
de déclenchement.
Readout: «Tr: CH2, front, fi ltre»
18.1.3 Alt. 1/2
Conditions: mode analogique, déclenchement «Front»
Déclenchement alterné avec les signaux des voies 1 et 2. Le
fonctionnement est décrit dans la section «Déclenchement
alterné» sous «Déclenchement et balayage horizontal».
En double trace (DUAL), le déclenchement alterné suppose
également l’inversion alternée des voies. Si l’appareil se trouve
en mode «choppé» (touche VERT/XY
28
>DUAL chop), il bascule
automatiquement en mode «DUAL alterné». L’appareil bascule
automatiquement en mode «DUAL choppé» ou peut être mis
dans ce mode lorsque «Alt.1/2» est désactivé.
Readout: «Tr:alt, front, fi ltre»
18.1.4 Externe
Le signal de déclenchement provient de l’entrée de déclenche-
33
ment externe de la AUXILIARY INPUT
33
).
Readout: «Tr:ext, front, fi ltre»
18.1.5 Secteur
En déclenchement secteur, le signal de déclenchement provient
de la tension secteur qui alimente l’oscilloscope.
Voir aussi «Déclenchement secteur» sous «Éléments de commande et Readout».
Readout: «Tr:Line, front»
19
TRIG‘d – indicateur (pas en mode XY)
Ce témoin s’allume lorsque la base de temps reçoit des signaux de déclenchement. Le mode d’allumage (clignotement
ou constant) du témoin dépend de la fréquence du signal de
déclenchement.
20
NORM – indicateur
Ce témoin s’allume en sélectionnant un déclenchement «Normal» ou «Monocoup» dans le menu «Déclenchement» (touche
16
MODE
). Le déclenchement automatique est alors désactivé et
le démarrage de la base de temps ou de l’acquisition du signal
n’a alors lieu qu’en présence d’un signal de déclenchement qui
remplit les conditions de déclenchement.
21
HOLD Off – indicateur
(mode analogique seulement)
Ce témoin s’allume lorsque la durée d’inhibition (HOLD Off)
est réglée à une valeur >0 %. Pour pouvoir modifi er la durée
d’inhibition avec le bouton INTENS, il faut préalablement affi cher le menu «Base de temps» avec la touche HOR VAR
26
.
Sous réserve de modifi cations
33

Éléments de commande et Readout
La durée d’inhibition ne concerne que la base de temps A. Vous
trouverez plus d’informations à ce sujet dans le paragraphe
«Réglage de la durée d’inhibition» de la section «Déclenchement et balayage horizontal».
22
X-POS DELAY – touche
Cette touche permet de modifi er la fonction du bouton
HORIZONTAL
23
qui lui est associé.
La touche indique la fonction courante correspondant à
l’inscription en face avant:
éteinte = réglage de la position horizontale de la trace
verte = réglage du temps de retard
22.1 X-POS
Lorsque la touche n’est pas allumée, le bouton HORIZONTAL
23
sert alors à régler la position horizontale de la trace.
Cette fonction est notamment intéressante en combinaison
avec l’expansion horizontale (MAG x10
25
). Contrairement à la
représentation sans expansion, avec la fonction MAG x10 seule
une section (un dixième) du signal est représentée sur 10 cm.
Le bouton HORIZONTAL
23
permet de sélectionner la partie de
la trace grossie qui doit être visible.
22.2 DELAY
Après avoir invoqué le menu «Base de temps» avec la touche
HOR VAR
26
et sélectionné «Rechercher» (mode bases de temps
A et B alternées) ou «B seule» (base de temps B), la fonction
du bouton HORIZONTAL
23
peut être permutée par une pression sur cette touche. Si la touche est allumée, le bouton sert
à régler le temps de retard. En mode bases de temps A et B
alternées (recherche), le temps de retard du démarrage de la
base de temps B par rapport à la base de temps A est affi ché
deux fois :
a) Dans le Readout avec Dt:... (Delay time = temps de retard).
Le temps indiqué se rapport au calibre de la base de temps
A.
disponibles sont compris entre 500 ms/div. et 50 ns/div. selon
une séquence 1-2-5. Le calibre est indiqué par le Readout (par
ex. «A:50ns») et il est calibré. Le signal est représenté avec
une vitesse de balayage plus ou moins élevée en fonction du
calibre sélectionné.
24.2 Réglage du calibre de la base de temps B
Cette fonction est disponible lorsque la fonction «Rechercher»
ou «B seule» est sélectionnée dans le menu «Base de temps»
26
(touche HOR VAR
) et que l’option «B variable» est désactivée
(Off).
Tournez le bouton vers la gauche pour augmenter le calibre de
la base de temps B, vers la droite pour le réduire. Les calibres
disponibles sont en principe compris entre 20 ms/div. et 50 ns/div.
(sans MAG x10) selon une séquence 1-2-5. Le calibre est indiqué
par le Readout (par ex. «B:50ns») et il est calibré. Le signal est
représenté avec une vitesse de balayage plus ou moins élevée
en fonction du calibre sélectionné.
La base de temps B doit permettre une représentation expansée dans le temps des portions du signal que la base de temps
A représente non expansées. Cela veut dire que la vitesse
de balayage horizontale de la base de temps B doit toujours
être supérieure à celle de la base de temps A. À l’exception
de la position 50 ns/div., la base de temps B ne peut pas se
trouver sur le même calibre que la base de temps A, mais
au moins un calibre plus bas (par ex. A:500 ns/div., B:200
ns/div.).
Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans le paragraphe «Base de temps B (2
ème
base de temps) / déclenchement
retardé (mode analogique)» de la section «Déclenchement et
balayage horizontal».
24.3 Réglage (fi n) variable
Le bouton TIME/DIV-VAR peut également faire offi ce de vernier
de réglage fi n du coeffi cient de balayage horizontal. Dans ce cas,
«VAR» s’allume dans la touche HOR VAR
26
et signale ainsi la
fonction vernier du bouton.
b) L’intervalle entre le début de la base de temps A et le début
du secteur clair sur la trace de la base de temps A.
Avec l’option «B seule», seule la base de temps B est affi chée
et, de ce fait, uniquement le temps de retard mentionné au
point a).
23
HORIZONTAL – bouton
Ce bouton possède différentes fonctions qui dépendent du
mode de fonctionnement et qui sont décrites au point
22
X-POS
DELAY – touche.
24
TIME/DIV-VAR – bouton
Ce bouton permet de sélectionner calibre de la base de temps
et possède plusieurs fonctions qui dépendent du mode de fonctionnement. Ce bouton est désactivé en mode XY analogique.
24.1 Réglage du calibre de la base de temps A
Cette fonction est disponible lorsque la fonction «A seule» est
sélectionnée dans le menu «Base de temps» (touche HOR VAR
26
) et que l’option «A variable» est désactivée (Off).
Tournez le bouton vers la gauche pour augmenter le calibre de
la base de temps A, vers la droite pour le réduire. Les calibres
Cette fonction de vernier peut être activée dans le menu «Base
de temps» invoqué avec la touche HOR VAR
26
. L’option affi chée
«A variable On Off» ou «B variable On Off» dépend de la base
de temps sélectionnée (A ou B) et peut être activée (On) ou
désactivée (Off) avec la touche de fonction.
Lorsque la fonction «VAR» est disponible, la base de temps n’est
pas calibrée et le Readout affi che le calibre avec un caractère
« > » à la place de «: » (par ex. «A>500ns» et «B>200ns»). Les
résultats des mesures du temps ou de la période au curseur
sont eux aussi identifi és.
25
MAG x10 – touche
Une pression sur cette touche active ou désactive l’expansion
horizontale x10, mais uniquement en mode analogique. Aucun
menu ne s’affi che.
x10 qui s’allume dans la touche MAG indique l’expansion horizontale x10 de la trace. Les calibres applicables de la base de
temps sont alors affi chés en haut à gauche dans le Readout.
L’expansion horizontale x10 agit comme suit, suivant le mode
de fonctionnement de la base de temps:
25.1 A seule (Base de temps)
Le calibre de la base de temps est divisé par 10 et la trace subit
simultanément une expansion x10 dans le sens horizontal.
34
Sous réserve de modifi cations

Éléments de commande et Readout
POWER
MENU
OFF
1 2 3 4 5 876
POWER
INTENS
!
FOCUS
TRACE
150 MHz
SAVE/
RECALL
AUTOSET
ANALOG
MENU
CURSOR
MEASURE
9
11
10
13
POSITION 1 POSITION 2
VOLTS / DIV
VAR
12
14
MENU
OFF
20 V 1 mV 20 V 1 mV
CH 1 CH 2 HOR MAG
VAR VAR VAR x1 0
CH 1 CH 2
X-INP
!
CAT I
CH 1/2
CURSOR
TRACE
SEP
AUTO
MEASURE
VERT/XY
INPUTS
1MΩII15pF
max
400 Vp
OSCILLOSCOPE
HM1500-2
VOLTS / DIV
VAR
MODE
FILTER
SOURCE
AUX
!
CAT I
LEVEL A/B
TRIGGER
TRIG ’ d
NORM
HOLD OFF
SETTINGS HELP
HORIZONTAL
X-POS
DELAY
TIME / DIV
VAR
0.5s 50ns
AUXILIARY INPUT
TRIG. EXT. / Z-INP.
1MΩ II
15pF
max
100 Vp
15
22
23
16
19
17
20
24
18
21
25
26
37
27 30 28 29 31 32
25.2 Rechercher (bases de temps A et B alternées)
La trace représentée avec la base de temps A et le calibre de
cette dernière ne change pas. Le calibre de la base de temps
B est divisé par 10 et la trace de celle-ci subit une expansion
x10 dans le sens horizontal.
25.3 B seule (Base de temps)
Le calibre de la base de temps est divisé par 10 et la trace subit
simultanément une expansion x10 dans le sens horizontal.
26
HOR VAR – touche
Une pression sur cette touche affi che le menu «Base de temps»
dont le contenu dépend du mode de fonctionnement courant.
26.1 A seule
Seule la base de temps A est en fonctionnement. Le Readout
affi che alors seulement «A…» en haut à gauche et le bouton
TIME/DIV-VAR n’agit que sur la base de temps A. La touche MAG
25
x10
permet d’appliquer une expansion horizontale de la trace,
c’est-à-dire de réduire le calibre de la base de temps.
Si vous passez du mode base de temps A en mode «Rechercher»
ou base de temps «B seule», tous les réglages concernant la base
de temps A, y compris le déclenchement, sont conservés.
26.2 Rechercher
Les bases de temps sont alternées dans ce mode de fonctionnement. Le Readout affi che alors les calibres des deus bases de
temps (« A… » et « B… ») et le bouton TIME/DIV-SCALE-VAR
n’agit que sur la base de temps B.
33
ainsi «DELAY». Le calibre de la base de temps B détermine la
largeur du secteur éclairci. Les portions de signal représentées
dans ce secteur sont affi chées sur toute la largeur de l’écran
avec la base de temps B, c’est-à-dire avec une expansion
horizontale.
La position verticale du signal représenté est indépendante de
la base de temps A ou B, ce qui a pour conséquence que les
représentations alternées (alternance des bases de temps A et
B) sont diffi ciles à analyser, car les deux traces sont affi chées
à la même position verticale.
Ce problème peut être résolu en modifi ant la position verticale
de la trace de la base de temps B. Pour ce faire, affi chez le menu
«Pos./Échelle» avec la touche CH1/2-CURSOR-TRACE SEP
11
et
appuyez sur la touche «TBB» pour attribuer au bouton POSITION
1 la fonction de séparateur de traces (voir 9.1.2 Position Y – 2
ème
base de temps). Comme la séparation de traces n’est nécessaire
qu’en mode «Rechercher», cette fonction n’est proposée que
dans ce mode de fonctionnement de la base de temps.
L’expansion horizontale MAG x10 est également possible en mode
«Rechercher», mais elle n’agit que sur la base de temps B.
26.3 B seule
Seule la base de temps B est affi chée. Le Readout affi che alors
seulement «B…» en haut à gauche et le bouton TIME/DIV-SCALE-VAR n’agit que sur la base de temps B.
La touche MAG x10
25
permet d’appliquer une expansion
horizontale de la trace, c’est-à-dire de réduire le calibre de la
base de temps.
En mode bases de temps alternées, une portion de la trace de
la base de temps A apparaît plus claire. La position horizontale
du secteur éclairci peut être modifi ée avec le bouton HORIZONTAL
23
si la touche X-POS DELAY 22 est allumée et affi che
26.4 Décl. B Front /
Lorsque cette fonction est sélectionnée, la base de temps B ne
démarre pas automatiquement après écoulement du temps
de retard réglé, mais seulement en présence d’un signal de
Sous réserve de modifi cations
35

Éléments de commande et Readout
déclenchement approprié, dans ce cas un signal présentant
un front montant.
15
Le bouton LEVEL A/B
(déclenchement) agit alors sur le dispositif du déclenchement de la base de temps B. Les paramètres
par défaut sont ici Déclenchement normal et Couplage DC. Les
paramètres de déclenchement sélectionnés pour la base de
temps A (réglage LEVEL, déclenchement automatique ou normal, sens du front et couplage) sont mémorisés et conservés.
En plus du temps de retard («Dt:…»), le Readout affi che le
déclenchement B activé (BTr: front, DC).
Si la base de temps est en mode «Rechercher» et le déclenchement B est réglé sur un front, un symbole d’un point de
déclenchement apparaît alors, lequel est précédé de la lettre
«B». Le symbole du point de déclenchement indique le temps
de retard et le niveau de déclenchement.
En cas de modifi cation continue du temps de retard, le secteur
clair «saute» de front en front si plusieurs fronts sont présents.
En mode bases de temps alternées, si le symbole du seuil de
déclenchement B se trouve à l’extérieur de la trace de la base de
temps A, la base de temps B ne sera pas déclenchée. Pas conséquent, il n’y a aucune représentation de la base de temps B. Le
comportement est identique en mode base de temps B (seule).
26.5 Décl. B Front \
À l’exception du sens du front (descendant au lieu de montant),
l’oscilloscope se comporte de manière identique à la description
du point 26.4.
27
CH1 VAR – touche
Cette touche affi che le menu «CH1» qui contient les commandes
suivantes, lesquelles se rapportent à l’entrée de la voie 1 (CH1
30
) ou à la trace du signal qui y est appliqué:
27.1 AC DC
Une pression sur cette touche permet de modifi er le couplage du signal de la voie 1 (couplage d’entrée) de AC en DC ou
inversement. Le réglage courant est affi ché par le Readout à
la suite des calibres par le symbole ~ (tension alternative) ou
= (tension continue).
27.1.1 Couplage d’entrée DC
Toutes les composantes du signal (alternatives et continues)
sont transmises par liaison galvanique de la borne intérieure
de la prise BNC
30
à l’amplifi cateur de mesure en passant par
l’atténuateur (réglage du calibre) et il n’existe pas de fréquence
limite inférieure. L’atténuateur est conçu pour que, quelle que
soit sa position, la résistance d’entrée de l’oscilloscope au courant continu soit de 1 MΩ entre la borne intérieure de la prise
30
BNC
et la borne de masse de celle-ci (borne extérieure).
27.1.2 Couplage d’entrée AC
La tension d’entrée est acheminée de la borne intérieure de
la prise BNC
30
à l’atténuateur (réglage du calibre) et ensuite
à l’amplifi cateur de mesure par le biais d’un condensateur.
Le condensateur et la résistance d’entrée de l’oscilloscope
forment un fi ltre passe-bas (différentiateur) dont la fréquence
de coupure est d’environ 2 Hz. À proximité de la fréquence de
coupure, ce différentiateur infl uence la forme ou l’amplitude
du signal représenté.
26.6 Décl. B Off
La base de temps B démarre dès qu’un temps de retard réglé
est écoulé (base de temps B «Roue libre»). Les modifi cations du
temps de retard apparaissent sous la forme d’un changement
continu de la position du secteur clair («Rechercher») ou du
début de la trace.
Comme le dispositif de déclenchement de la base de temps B
est sans effet, les éléments de commande agissent sur celui
de la base de temps A.
26.7 A Variable – On Off
Lorsque cette fonction est activée (On), le bouton TIME/DIV-
24
VAR
sert de vernier de réglage fi n pour la base de temps
A. Cette fonction n’apparaît dans le menu qu’en mode base de
temps «A seule».
Vous trouverez un descriptif complet dans la section «24.3
Réglage (fi n) variable».
26.8 B Variable – On Off
Lorsque cette fonction est activée (On), le bouton TIME/DIV-VAR
24
sert de vernier de réglage fi n pour la base de temps B. Vous
trouverez un descriptif complet dans la section «28.3 Réglage
(fi n) variable».
26.9 Durée d’inhibition … % Hold Off
Le bouton INTENS permet de régler la durée d’inhibition entre
0 et 100 %. Les valeurs supérieures à 0 % augmentent le temps
d’attente pendant lequel aucun nouveau balayage horizontal
ne peut être déclenché après le retour de trame. L’indicateur
HOLD Off
21
est en même temps allumé. La durée d’inhibition
ne concerne que la base de temps A.
Les tensions continues ou les composantes continues des
signaux mesurés ne franchissent pas le condensateur de
couplage. Les variations de tension continue entraînent des
décalages de la position en raison de la décharge du condensateur. La position initiale du signal est rétablie une fois que le
condensateur a été chargé à la nouvelle tension.
27.2 Masse (GND) On Off
Chaque pression sur la touche active ou désactive l’entrée de
la voie 1. Lorsque l’entrée est désactivée (GND = masse), le
Readout affi che le symbole de la terre derrière le calibre, là
où apparaissait précédemment le couplage d’entrée. Le signal
appliqué à l’entrée est alors déconnecté et seule apparaît une
ligne horizontale (en déclenchement automatique) non déviée
dans le sens vertical et qui peut servir de ligne de référence
de masse (0 volt).
Le Readout affi che cependant aussi un symbole (
) qui représente la position de référence (0 volt). Celui-ci se trouve approximativement au centre de l’écran. L’amplitude d’une tension
continue peut être déterminée en se basant sur la position
0 V préalablement déterminée. Pour ce faire, il faut reconnecter l’entrée et effectuer la mesure avec un couplage d’entrée
DC.
27.3 Inversion On Off (non disponible en mode XY)
Une pression sur cette touche de fonction permet de basculer
entre la représentation inversée et non inversée du signal de la
voie 1. Lorsque la représentation est inversée, le Readout affi che
un tiret au-dessus de l’indicateur de voie (CH1) et le signal
représenté est retourné de 180°. Le signal de déclenchement
«interne» dérivé du signal mesuré n’est pas inversé.
Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans le paragraphe «Réglage de la durée d’inhibition» de la section «Déclenchement et balayage horizontal».
36
Sous réserve de modifi cations
27.4 Variable On Off
La touche CH1 VAR
27
est allumée en position «On». Le bou-
ton VOLTS/DIV–SCALE–VAR (12) de CH1 sert alors de vernier

Éléments de commande et Readout
POWER
MENU
OFF
1 2 3 4 5 876
POWER
INTENS
!
FOCUS
TRACE
150 MHz
SAVE/
RECALL
AUTOSET
ANALOG
MENU
CURSOR
MEASURE
9
11
10
13
POSITION 1 POSITION 2
VOLTS / DIV
VAR
12
14
MENU
OFF
20 V 1 mV 20 V 1 mV
CH 1 CH 2 HOR MAG
VAR VAR VAR x1 0
CH 1 CH 2
X-INP
!
CAT I
CH 1/2
CURSOR
TRACE
SEP
AUTO
MEASURE
VERT/XY
INPUTS
1MΩII15pF
max
400 Vp
OSCILLOSCOPE
HM1500-2
VOLTS / DIV
VAR
MODE
FILTER
SOURCE
AUX
!
CAT I
LEVEL A/B
TRIGGER
TRIG ’ d
NORM
HOLD OFF
SETTINGS HELP
HORIZONTAL
X-POS
DELAY
TIME / DIV
VAR
0.5s 50ns
AUXILIARY INPUT
TRIG. EXT. / Z-INP.
1MΩ II
15pF
max
100 Vp
15
22
23
16
19
17
20
24
18
21
25
26
37
27 30 28 29 31 32
de réglage fi n et permet de varier continuellement le calibre
sur toute la plage et ainsi l’amplitude du signal représenté. En
position non calibrée, le Readout affi che le symbole « > » avant
le calibre et «:» en position calibrée. Les résultats des mesures
automatiques et de la tension sont eux aussi identifi és.
Après avoir appuyé sur la touche de fonction pour basculer de
«Variable On» à «Variable Off», le bouton VOLTS/DIV–SCALE–
12
VAR
de CH1 est de nouveau calibré et permet de sélectionner
le calibre selon la séquence 1-2-5.
27.5 Sonde
Le contenu du menu dépend du type de sonde connectée : avec
ou sans détection automatique du rapport d’atténuation. Les
paramètres courants sont pris en compte lors de l’affi chage
des mesures de tension.
27.5.1 Si la sonde connectée est un modèle HAMEG avec détection automatique du rapport d’atténuation, le terme «Sonde» est
affi ché avec une luminosité normale et le facteur d’atténuation
(par ex. «*10») apparaît au-dessous.
27.5.2 Si la sonde connectée ne permet pas la détection du
rapport d’atténuation et que vous affi chez le menu «CH1», le
terme «Sonde» apparaît avec le dernier facteur d’atténuation
réglé ainsi que le symbole du codeur rotatif. Une pression sur
la touche de fonction correspondante affi che «Sonde» avec
une luminosité accrue et la touche FOCUS/TRACE/MENU
3
s’allume en continu. Vous pouvez alors sélectionner le facteur
d’atténuation qui correspond à celui de la sonde connectée à
l’aide du bouton INTENS
28
VERT/XY – touche
2
.
33
fonctionnement ainsi que la bande passante de l’amplifi cateur
de mesure.
28.1 CH1
Avec l’option «CH1», l’appareil fonctionne en mode Yt (base
de temps) et seule la voie 1 est représentée. Cela s’applique
également aux paramètres affi chés par le Readout (calibre,
inversion, calibrage et couplage d’entrée).
Bien que la voie 2 ne soit pas représentée, elle peut servir
d’entrée pour un signal de déclenchement «interne». Les éléments de commande en rapport avec celle-ci sont opérationnels
même s’ils ne sont pas affi chés dans le Readout.
28.2 CH2
Avec l’option «CH2», l’appareil fonctionne en mode Yt (base
de temps) et seule la voie 2 est représentée. Cela s’applique
également aux paramètres affi chés par le Readout (calibre,
inversion, calibrage et couplage d’entrée).
Bien que la voie 1 ne soit pas représentée, elle peut servir
d’entrée pour un signal de déclenchement «interne». Les éléments de commande en rapport avec celle-ci sont opérationnels
même s’ils ne sont pas affi chés dans le Readout.
28.3 DUAL alt chop
En mode DUAL (double trace), les deux voies sont affi chées
et leurs calibres apparaissent dans le Readout. Le mode
d’affi chage des deux voies est indiqué entre les calibres: «alt»
correspond à la commutation alternée et CHP choppée des
voies. Le mode de commutation des voies est prédéfi ni automatiquement par le calibre de la base de temps, mais il peut
également être modifi é avec la touche de fonction (mode choppé
de 500 ms/div. à 500 μs/div. et mode alterné entre 200 μs/div. et
50 ns/div., sans expansion horizontale MAG x10).
Une pression sur cette touche affi che ou masque le menu
«Vertical» dans lequel vous pouvez sélectionner les modes de
En mode choppé, les deux voies 1 et 2 sont permutées continuellement, indépendamment du calibre de la base de temps,
Sous réserve de modifi cations
37

Éléments de commande et Readout
et les deux signaux semblent apparaître simultanément du fait
de la fréquence de permutation élevée.
En mode alterné, une seule voie est représentée pendant un
cycle de balayage horizontal et la voie suivante pendant le cycle
suivant. La vitesse de balayage horizontal donne lieu à une
fréquence de permutation tellement élevée que les deux voies
semblent être affi chées simultanément.
28.4 ADD
En mode addition (Add), les signaux des voies 1 et 2 sont additionnés ou soustraits et le résultat (somme ou différence
algébrique) est représenté sous la forme d’un seul signal. La
trace peut être déplacée à l’aide du bouton POSITION 1 ou
POSITION 2, mais un seul symbole «O volt» (k) est affi ché.
Ce mode est indiqué par le symbole de l’addition « + » entre les
calibres des voies 1 et 2.
Le résultat des mesures de tension au curseur n’est juste que
si les calibres verticaux des deux voies sont identiques. Le cas
contraire, l’indication «CH1<>CH2» s’affi che à la place du résultat de la mesure lors d’une mesure de tension au curseur.
Les mesures automatiques de tension sont en principe impossibles à réaliser en mode addition. Par conséquent, l’indicateur
de valeur mesurée affi che «s/o» pour «sans objet».
Comme il n’existe, en mode addition, aucune relation entre
l’amplitude du signal représenté et le niveau de déclenchement, le symbole du point de déclenchement ne s’affi che pas
en mode analogique, et ce malgré que le bouton LEVEL A/B
15
soit opérationnel.
28.5 XY
En mode XY, les calibres des voies sont affi chés d’après la fonction de celles-ci: «CHX...» au lieu de CH1 et «CHY…» au lieu de
CH2. Cela veut dire que le signal appliqué à la voie 1 provoque
une déviation horizontale (X) alors que le signal appliqué à la
voie 2 provoque une déviation dans le sens vertical (Y).
Comme la représentation n’est pas en mode Yt, le calibre de la
base de temps n’est pas affi ché. Il en résulte que le dispositif
de déclenchement est lui aussi désactivé et les informations
correspondantes ne s’affi chent pas dans le Readout. La fonction
MAG x10
25
est elle aussi désactivée. Les symboles «0 volt»
sont affi chés sous forme de «triangles» sur le bord droit de la
grille et au-dessus des calibres.
Les boutons HORIZONTAL
23
et POSITION 1 13 permettent de
changer la position horizontale de la trace alors que la position
verticale est modifi ée avec le bouton POSITION 2.
primer les composantes aux fréquences supérieures du
signal (par exemple les bruits). Le Readout affi che alors
«BWL» (bandwidth limit = limitation de la bande passante)
et, en mode Yt, celle-ci agit sur les deux voies quel que soit
le mode de fonctionnement (analogique ou numé-rique).
En mode XY numérique, l’appareil se comporte comme en mode
Yt. En mode XY analogique, la limitation de la bande passante
s’applique uniquement à la voie 2.
29
CH2 – touche
Cette touche affi che le menu CH2 qui contient les commandes
suivantes, lesquelles se rapportent à l’entrée de la voie 2 (CH2
31
) ou à la trace du signal qui y est appliqué:
29.1 AC / DC
Une pression sur cette touche permet de modifi er le couplage du signal de la voie 2 (couplage d’entrée) de AC en DC ou
inversement. Le réglage courant est affi ché par le Readout à
la suite des calibres par le symbole ~ (tension alternative) ou
= (tension continue).
29.1.1 Couplage d’entrée DC
Toutes les composantes du signal (alternatives et continues)
sont transmises par liaison galvanique de la borne intérieure
de la prise BNC
31
à l’amplifi cateur de mesure en passant par
l’atténuateur (réglage du calibre) et il n’existe pas de fréquence
limite inférieure. L’atténuateur est conçu pour que, quelle que
soit sa position, la résistance d’entrée de l’oscilloscope au courant continu soit de 1 MΩ entre la borne intérieure de la prise
31
BNC
et la borne de masse de celle-ci (borne extérieure).
29.1.2 Couplage d’entrée AC
La tension d’entrée est acheminée de la borne intérieure de
la prise BNC
31
à l’atténuateur (réglage du calibre) et ensuite
à l’amplifi cateur de mesure par le biais d’un condensateur.
Le condensateur et la résistance d’entrée de l’oscilloscope
forment un fi ltre passe-bas (différentiateur) dont la fréquence
de coupure est d’environ 2 Hz. À proximité de la fréquence de
coupure, ce différentiateur infl uence la forme ou l’amplitude
du signal représenté.
Les tensions continues ou les composantes continues des
signaux mesurés ne franchissent pas le condensateur de
couplage. Les variations de tension continue entraînent des
décalages de la position en raison de la décharge du condensateur. La position initiale du signal est rétablie une fois que le
condensateur a été chargé à la nouvelle tension.
Le signal appliqué à la voie 1 ne peut pas être inversé. La
commande correspondante n’apparaît pas dans le menu CH1
invoqué avec la touche CH1 VAR
24
est désactivé.
27
. Le bouton TIME/DIV-VAR
28.6 Bande passante 20 MHz Pleine
Une pression sur cette touche permet de basculer entre la
bande passante réduite de 20 MHz et la pleine bande passante
des amplifi cateurs de mesure.
– Pleine:
Avec l’option «Pleine», la bande passante disponible est
celle indiquée dans les caractéristiques techniques en
fonction des conditions de fonctionnement.
– 20 MHz
En présence de conditions de fonctionnement où la totalité
de la bande passante est disponible, la fonction 20 MHz
permet de réduire la bande passante de mesure à environ
20 MHz (–3 dB). Il est ainsi possible d’atténuer ou de sup-
38
Sous réserve de modifi cations
29.2 Masse (GND) On Off
Chaque pression sur la touche active ou désactive l’entrée de
la voie 2.
Lorsque l’entrée est désactivée (GND = masse), le Readout
affi che le symbole de la terre derrière le calibre, là où apparaissait précédemment le couplage d’entrée. Le signal
appliqué à l’entrée est alors déconnecté et seule apparaît une
ligne horizontale (en déclenchement automatique) non déviée
dans le sens vertical et qui peut servir de ligne de référence
de masse (0 volt).
Le Readout affi che cependant aussi un symbole qui représente
la position de référence. Celui-ci se trouve approximativement
au centre de l’écran. L’amplitude d’une tension continue peut
être déterminée en se basant sur la position 0 V préalablement
déterminée. Pour ce faire, il faut reconnecter l’entrée et effectuer la mesure avec un couplage d’entrée DC.

Éléments de commande et Readout
POWER
MENU
OFF
1 2 3 4 5 876
POWER
INTENS
!
FOCUS
TRACE
150 MHz
SAVE/
RECALL
AUTOSET
ANALOG
MENU
CURSOR
MEASURE
9
11
10
13
POSITION 1 POSITION 2
VOLTS / DIV
VAR
12
14
MENU
OFF
20 V 1 mV 20 V 1 mV
CH 1 CH 2 HOR MAG
VAR VAR VAR x1 0
CH 1 CH 2
X-INP
!
CAT I
CH 1/2
CURSOR
TRACE
SEP
AUTO
MEASURE
VERT/XY
INPUTS
1MΩII15pF
max
400 Vp
OSCILLOSCOPE
HM1500-2
VOLTS / DIV
VAR
MODE
FILTER
SOURCE
AUX
!
CAT I
LEVEL A/B
TRIGGER
TRIG ’ d
NORM
HOLD OFF
SETTINGS HELP
HORIZONTAL
X-POS
DELAY
TIME / DIV
VAR
0.5s 50ns
AUXILIARY INPUT
TRIG. EXT. / Z-INP.
1MΩ II
15pF
max
100 Vp
15
22
23
16
19
17
20
24
18
21
25
26
37
27 30 28 29 31 32
29.3 Inversion On Off
Une pression sur cette touche de fonction permet de basculer
entre la représentation inversée et non inversée du signal de la
voie 2. Lorsque la représentation est inversée, le Readout affi che un tirer au-dessus de l’indicateur de voie (CH2) et le signal
représenté est retourné de 180°. Le signal de déclenchement
«interne» dérivé du signal mesuré n’est pas inversé.
29.4 Variable On Off
La touche CH2 VAR
VOLTS/DIV–VAR
29
est allumée en position «On». Le bouton
13
de CH1 sert alors de vernier de réglage fi n et
permet de varier continuellement le calibre sur toute la plage et
ainsi l’amplitude du signal représenté. En position non calibrée,
le Readout affi che le symbole « > » avant le calibre et « : » en
position calibrée. Les résultats des mesures automatiques et
de la tension sont eux aussi identifi és.
Après avoir appuyé sur la touche de fonction pour basculer de
«Variable On» à «Variable Off», le bouton VOLTS/DIV–VAR
13
de
CH2 est de nouveau calibré et permet de sélectionner le calibre
selon la séquence 1-2-5.
29.5 Sonde
Le contenu du menu dépend du type de sonde connectée: avec
ou sans détection automatique du rapport d’atténuation. Les
paramètres courants sont pris en compte lors de l’affi chage
des mesures de tension.
29.5.1 Si la sonde connectée est un modèle HAMEG avec détection automatique du rapport d’atténuation, le terme «Sonde» est
affi ché avec une luminosité normale et le facteur d’atténuation
(par ex. «*10») apparaît au-dessous.
29.5.2 Si la sonde connectée ne permet pas la détection du
rapport d’atténuation et que vous affi chez le menu CH2, le
terme «Sonde» apparaît avec le dernier facteur d’atténuation
réglé ainsi que le symbole du codeur rotatif. Une pression sur
33
la touche de fonction correspondante affi che «Sonde» avec
une luminosité accrue et la touche FOCUS TRACE MENU
3
s’allume en continu. Vous pouvez alors sélectionner le facteur
d’atténuation qui correspond à celui de la sonde connectée à
l’aide du bouton INTENS
30
INPUT CH1 – prise BNC
2
.
Cette prise BNC sert d’entrée signal pour la voie 1, laquelle sert
d’entrée Y en mode Yt (base de temps) et d’entrée X en mode
XY. La borne extérieure de la prise est reliée galvaniquement
à toutes les parties conductrices de l’oscilloscope ainsi qu’à la
terre du secteur.
Aucune tension ne doit être appliquée sur la surface conductrice
circulaire qui entoure la prise. Elle sert à détecter le facteur
d’atténuation des sondes avec identifi cation.
31
INPUT CH2 – prise BNC
Cette prise sert d’entrée signal pour la voie 2, laquelle sert
d’entrée Y. La borne extérieure de la prise est reliée galvaniquement à toutes les parties conductrices de l’oscilloscope
ainsi qu’à la terre du secteur.
Aucune tension ne doit être appliquée sur la surface conductrice
circulaire qui entoure la prise. Elle sert à détecter le facteur
d’atténuation des sondes avec identifi cation.
32
AUX – Touche
Cette touche permet d’entrer dans le sous menu de l’entrée
auxiliaire et d’en affi cher le mode de fonctionnement actuel.
32.1 L’entrée auxiliaire est utilisée pour l’entrée d’un signal de
déclenchement externe lorsque cette fonction a été choisie par
Sous réserve de modifi cations
39

Éléments de commande et Readout
COMP.
TESTER
POWER
PROBE
ADJ
ANALOGSCOPE
Instruments
MENUMENU
OFFOFF
l’appui de la touche SOURCE 18 et que la fonction «externe»
a été validée dans le Menu «Source Trig.» (source de déclenchement).
32.2 Si le déclenchement n’est pas externe, le menu «Entrée Z»
s’affi che et la touche de fonction permet alors de sélectionner
le couplage d’entrée (AC DC) et de commander l’entrée Z (On
33
Off). OFF indique que l’entrée AUXILIARY INPUT
n’a aucune
fonction. Si elle est activée ON, elle sert d’entrée d’allumage
du spot pour les signaux au niveau TTL. La trace en mode Yt
(base de temps) et en mode XY n’est plus visible (sombre) en
présence d‘une tension continue supérieure à 1 V environ et
avec le couplage DC. Le comportement est le même avec le
couplage AC.
33
AUXILIARY INPUT – prise BNC (Entrée auxiliaire)
Cette prise BNC sert d’entrée pour un signal de déclenchement
externe ou pour la modulation d’intensité du faisceau par un
signal externe (Modulation de Wenhelt).
La borne extérieure de la prise est reliée galvaniquement à
toutes les parties conductrices de ‘l’oscilloscope ainsi qu’à la
terre du réseau.
Aucune tension ne doit être appliquée sur la surface circulaire
conductrice entourant la prise, celle-ci n’a pas de fonction
pour cette prise.
35.2 Calibreur
Le réglage détermine la fréquence du signal rectangulaire
de compensation des sondes présent sur la prise PROBE ADJ
34
: 1 kHz ou 1 MHz.
35.3 Info
Cette touche de fonction affi che un menu qui contient des
informations diverses sur le modèle, le logiciel, le matériel et
l’interface si elle est installée.
36
COMPONENT TESTER – prises
Ces deux prises de 4 mm servent d’entrée de mesure pour le
contrôle bipolaire des composants électroniques. Vous trouverez une description complète dans la section «Testeur de
composants».
37
MENU OFF touche
Touche pour fermer les menus ou pour passer au niveau de
menu supérieur.
34
PROBE ADJ – prise
Cette prise délivre un signal rectangulaire dont l’amplitude est
de 0,2 V
et qui permet de régler la compensation en fréquence
cc
des sondes atténuatrices 10:1. La fréquence du signal peut être
détermine dans le menu «Divers» après avoir appuyé sur la
touche «PROBE ADJ»
35
.
Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans le paragraphe «Utilisation et compensation des sondes» de la section
«Mise en route et préréglages».
35
PROBE ADJ – touche
Une pression sur cette touche affi che le menu «Divers» qui
contient deux commandes.
35.1 Testeur COMP On Off
Lorsqu’il est activé ON, l’appareil est en mode analogique et
affi che une trace et le Readout indique «Component Tester».
Dans ce mode de fonctionnement, les prises bananes de 4 mm
marquées COMPONENT TESTER servent d’entrée de mesure.
Voir aussi «Testeur de composants». «Off» rétablit les dernières
conditions de fonctionnement.
40
Sous réserve de modifi cations
36 35 34 37

Sous réserve de modifi cations
41

42
Sous réserve de modifi cations

Sous réserve de modifi cations
43

Oscilloscopes
Analyzeurs de spectre
Alimentations
Appareils modulaires
Serie 8000
Appareils programmables
Serie 8100
distributeur
41- 1500-02F0
www.hameg.com
HAMEG Instruments France
Sous réserve de modifi cations Parc Tertiaire de Meudon
41-1500-02F0 (3) 10122009 9/11 rue Jeanne Braconnier
© HAMEG Intruments GmbH F-92366 MEUDON LA FORET CEDEX
A Rohde & Schwarz Company Tel 01 41 36 11 60
DQS-Certifi cation: DIN EN ISO 9001:2000 Fax 01 41 36 10 01
Reg.-Nr.: 071040 QM hameg.france@hameg.com
 Loading...
Loading...